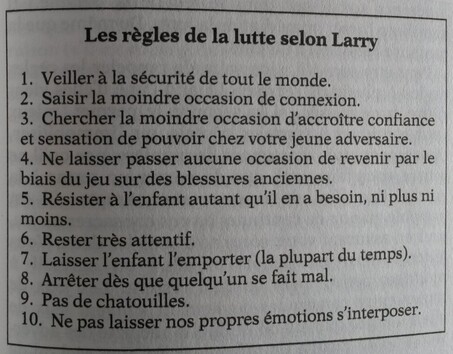-
Par vaeeje le 12 Décembre 2015 à 10:53
article issu de : http://www.revistadepsicomotricidad.com/2013/10/corps-emotion-et-affect-chez-lenfant.html
Corps, émotion et affect chez l’enfant.
Bernard AUCOUTURIER
 CONGRES FNARENTOURS - 08 JUIN 2013C’est avec beaucoup d’émotion que je suis ici au Vinci et dans ma ville, et je remercie l’AREN de m’avoir donné l’occasion de me faire vivre à nouveau un moment fort de ma vie professionnelle.Il est vrai que je reste toujours proche de vous, d’autant plus que j’ai participé à la formation des rééducateurs à Tours pendant 35 années. Certains d’entre vous se souviennent peut-être encore de la formation personnelle qui était une originalité de la formation du centre de Tours.Au cours de ma carrière, j’ai aidé beaucoup d’enfants en difficulté plus ou moins grave à être mieux dans leur peau, mieux à l’école, dans leur famille, enfin, je l’espère, mieux dans la vie.En fonction du thème du congrès « Emotion, affect, apprentissage », je m’en tiendrai à des concepts qui vous intéressent au premier chef quand il s’agit de l’enfant en difficulté à l’école et je ferai référence à d’autres concepts qui soutiennent vos pratiques. Ainsi, je vous proposerai la sécurité de l’enfant, la colère, les peurs, ordinaires et primitives, l’angoisse, l’originaire dans la genèse psycho-affective, l’affect, le désir, les rêves et les fantasmes, l’importance du plaisir dans le jeu spontané et dans l’apprentissage.A la fin, j’illustrerai mon propos d’extraits d’une séance avec un enfant de 4 ans en grande difficulté à l’école maternelle.Au cours de mon intervention, je vous proposerai de brefs arrêts pour échanger avec les collègues proches de vous.
CONGRES FNARENTOURS - 08 JUIN 2013C’est avec beaucoup d’émotion que je suis ici au Vinci et dans ma ville, et je remercie l’AREN de m’avoir donné l’occasion de me faire vivre à nouveau un moment fort de ma vie professionnelle.Il est vrai que je reste toujours proche de vous, d’autant plus que j’ai participé à la formation des rééducateurs à Tours pendant 35 années. Certains d’entre vous se souviennent peut-être encore de la formation personnelle qui était une originalité de la formation du centre de Tours.Au cours de ma carrière, j’ai aidé beaucoup d’enfants en difficulté plus ou moins grave à être mieux dans leur peau, mieux à l’école, dans leur famille, enfin, je l’espère, mieux dans la vie.En fonction du thème du congrès « Emotion, affect, apprentissage », je m’en tiendrai à des concepts qui vous intéressent au premier chef quand il s’agit de l’enfant en difficulté à l’école et je ferai référence à d’autres concepts qui soutiennent vos pratiques. Ainsi, je vous proposerai la sécurité de l’enfant, la colère, les peurs, ordinaires et primitives, l’angoisse, l’originaire dans la genèse psycho-affective, l’affect, le désir, les rêves et les fantasmes, l’importance du plaisir dans le jeu spontané et dans l’apprentissage.A la fin, j’illustrerai mon propos d’extraits d’une séance avec un enfant de 4 ans en grande difficulté à l’école maternelle.Au cours de mon intervention, je vous proposerai de brefs arrêts pour échanger avec les collègues proches de vous.
La sécurité affective, un véritable besoin comme celui de se nourrir, de se mouvoir, de jouer, de communiquerLe plus beau des cadeaux que les parents peuvent offrir à leur enfant est l’affection, la tendresse et un cadre de vie aussi régulier que possible afin qu’il vive un sentiment de sécurité indispensable pour se développer dans les meilleures conditions et progressivement s’ouvrir au monde de la réalité.Dès la naissance, le bébé a besoin d’être protégé contre les agressions internes et externes. Les parents aiment leur enfant, aussi lui assurent-ils une qualité de soin et de présence qui se répètent autant que faire ce peut en un même lieu, un même temps avec un même rythme associé à des paroles ajustées au corps et aux émotions de l’enfant.L’attitude attentive, les manipulations régulières, les contacts, le regard, la solidité du soutien postural sont comme des paroles de tendresse qui ouvrent la voie au dialogue tonico-émotionnel et à la qualité des interactions.Le bébé vit alors dans un cadre maternant sécurisant qui lui permet de mémoriser des sensations agréables comme des bons objets qui reviennent avec régularité par la qualité des interactions tout en atténuant les sensations désagréables inévitables comme celles d’attendre les réponses à ses besoins.La mère, comme le père, malgré leurs différences de tonicité, de contact, de regard, de voix, de rythmes, de soutien, de paroles, assurent avec une certaine permanence les rituels de soins et de présence affectueuse.L’enfant s’autoritualise, il se vit protégé de l’intérieur et aimé. Alors, il acceptera d’autant mieux et sans crainte l’autorité des parents.L’enfant en sécurité affective s’attache à ses parents et s’en détachera d’autant mieux malgré des aléas toujours possibles.Plus tard, l’enfant appréciera que les événements quotidiens, le réveil, la toilette, les repas, le coucher, l’histoire avant de dormir, se déroulent selon certains rituels qu’il connait et qu’il peut anticiper et dont il peut penser le retour pour atténuer des peurs toujours possibles et surtout celles d’un non-retour.Malgré ces rituels qui sécurisent l’enfant, celui-ci demande toujours la sécurité donnée par l’autre car il est parfois envahi par la peur de perdre ses parents, une peur vécue dans le corps sous forme de tensions inhibitrices des fonctions somatiques et psychiques.Lorsque les parents donnent à l’enfant l’affection dont il a tant besoin pour se développer sans oublier l’autorité (des règles de vie pour lui et les autres) : c'est-à-dire lorsque les parents sont là pour lui dire « non », un « non » qui contient ses pulsions et ses décharges émotionnelles excessives, l’enfant trouve la confiance en lui-même parce qu’il a confiance en ses parents qui l’aident à grandir. L’enfant se sent protégé, il est plus sûr de lui, il progresse sans crainte dans la vie malgré les difficultés, voire des moments douloureux, alors il n’a pas peur de s’éloigner de ses parents, d’aller vers les autres, d’établir d’autres relations, de trouver d’autres plaisirs tels que le plaisir de découvrir, d’apprendre le monde actuel, il est vrai si difficile à vivre aujourd'hui.Mais, si les parents ne donnent ni l’affection, ou trop d’affection, ni l’autorité, ou trop d’autorité, l’enfant ne trouve pas dans sa famille les supports rassurants, sécurisants nécessaires à son développement : alors il régresse, agresse, oscille entre l’inhibition et la révolte, et nous savons tous que ces manifestations d’insécurité peuvent avoir des conséquences désastreuses sur le plan relationnel et cognitif.Mais, alors l’école ne pourrait-elle pas être un antidote à l’insécurité de l’enfant ? La sécurité affective de l’enfant à l’école n’est-elle pas un prérequis basique autant que les prérequis cognitifs nécessaires aux apprentissages ?L’école ne pourrait-elle pas rendre l’enfant disponible à la famille ? Mais, peut-être vais-je trop loin sur la fonction de l’école ?
Un enfant heureux à l’écoleUn enfant pour lequel la sécurité affective donnée par une famille qui l’aime, le comprend, le contient, ainsi que celle donnée par la crèche et l’école est un enfant heureux. Cette sécurité lui permet d’atténuer ses peurs et ses angoisses qui limitent son développement et particulièrement celui des apprentissages scolaires.Un enfant heureux à l’école, c’est un enfant spontané, bien dans son corps, qui joue et qui peut exprimer ses émotions sans retenue. C’est un enfant heureux de vivre qui affirme ses désirs sans hésitation, sans culpabilité, c’est aussi un enfant qui vit le plaisir de donner et de recevoir.Un enfant heureux à l’école est un enfant qui échappe à l’emprise des adultes tout en acceptant leur autorité, nécessaire à son grandissement. C’est aussi un enfant qui a le désir de grandir et de s’ouvrir à la réalité de la connaissance et du savoir. C’est un enfant qui s’exprime avec facilité, qui communique avec ses pairs et les adultes sans hésitation.Enfin, un enfant heureux à l’école est un enfant en quête de demande avec toutes les personnes de son entourage. Il est curieux de tout découvrir et de tout savoir.Il est toujours impatient de venir à l’école pour apprendre, participer avec ses partenaires et retrouver l’enseignant qu’il estime.
Un autre besoin, exprimer ses émotions.L’enfant exprime sans restriction son bien-être ou son mal-être par des décharges tonico-émotionnelles. L’expression émotionnelle est indispensable à son équilibre psychologique et à son développement harmonieux, mais si l’enfant ne vit pas ses émotions, ne les verbalise pas, il souffre et risque d’être « malade » de vivre. Il est vrai que notre présence au monde est faite de sensations, d’émotions et d’actions.Je rappelle que les émotions sont issues de l’histoire évolutive des espèces afin de faire face à des exigences vitales comme la peur et la colère qui sont une réponse d’autoprotection face à un environnement menaçant ou restrictif.La colèreLa colère est une explosion émotionnelle chez la fille comme chez le garçon dont nous connaissons tous les manifestations.La colère est assez banale, l’enfant semble dépassé par ce qu’il ressent, par ce qui se passe en lui et qu’il ne comprend pas. La colère lui permet d’exprimer momentanément son mal-être. La colère lui permet de dévoiler son intériorité de sujet qu’il manifeste ainsi à autrui et à lui-même. La colère est la manière d’être la plus authentique mais aussi la plus difficile à accepter par l’entourage.La colère n’est pas un état permanent car elle est brève et donne l’apparence d’une crise interne, d’un coup de folie, une crise interne en réponse à une crise externe, en réaction à une répression ou à une menace de l’entourage, répression d’une action, répression d’un plaisir à vivre immédiatement, et peut-être une crise insuffisamment comprise de la part des parents et des éducateurs. La colère est une émotion vraie issue d’un rejet visant autrui comme un mauvais sujet à éliminer.La colère s’atténue vers 4 ou 5 ans par la maturation des lobes préfrontaux du système nerveux central, mais perdure chez d’autres enfants insécurisés. Elle s’atténue lorsque les enfants maîtrisent le langage et trouvent les paroles pour exprimer leur mécontentement.La colère saurait-elle être salutaire ?Oui, s’il s’agit de colères brèves et peu fréquentes. En effet, une décharge émotionnelle est toujours accompagnée d’une réduction de tension tonique libérant la musculature des organes de la vie végétative et celle de la vie des organes de la relation. La colère apaise le corps et la pensée. La décharge émotionnelle signifie l’authenticité de l’enfant d’être avant tout un être d’émotions, c’est une manière pour lui d’exister, certes violemment mais d’exister et de ressentir intensément son environnement.Alors, nous devrions nous inquiéter si l’enfant n’exprime aucune colère face à la frustration de l’adulte : cette rétention émotionnelle risque d’avoir de graves conséquences somatiques ainsi que de graves conséquences psychologiques : blocages de la pensée imaginaire, de la pensée cognitive et du raisonnement logique ainsi que la limitation de l’expression verbale. La rétention émotionnelle peut être destructrice.Par la colère, l’enfant touche, bouscule les parents pour obtenir une réponse en sa faveur. C’est une manière de les attaquer. La colère n’est-elle pas alors une manière violente très particulière de provoquer la communication ? Ne serait-elle pas un moyen pour l’enfant de capter l’attention des parents et de leur dire : « J’existe. ». C’est peut-être là le paradoxe de la colère. Elle semble séparer les uns des autres alors qu’elle les rapproche, elle semble couper l’enfant de son environnement alors qu’elle permet une compréhension vive, à chaud du monde externe à son égard. La colère est peut-être aussi un appel à la fermeté, au besoin d’être contenu. Enfin, la colère ne serait-elle pas un appel à être mieux écouté, à être plus attentif à lui ? N’est-ce pas une manière de dire : « J’ai besoin de vous. »Il semble que les colères chez certains enfants d’aujourd'hui soient plus fréquentes, plus intenses et surtout se prolongent bien au-delà de la 5ème année. Fait nouveau, elles se déclenchent non pas face à la frustration mais à propos de n’importe quel fait qui nous semble dérisoire. « C’est la goutte qui fait déborder le vase. »Ces colères répétées violentes face à des faits dérisoires se rencontrent principalement chez des enfants fragiles, c'est-à-dire insécurisés pour ne pas avoir vécu les premiers repères stables au cours de la petite enfance.La peurTous les enfants, tous les individus vivent la peur, il s’agit d’une réaction normale qui surgit en présence d’un objet dangereux, d’une situation dangereuse ou d’une pensée qui évoque le danger d’être attaqué dans son intégrité corporelle et psychique. La peur est donc une réponse vitale à un évènement menaçant, elle est une émotion intensément vécue qui mobilise, comme la colère, des ressources neurovégétatives (décharge d’adrénaline, augmentation de la fréquence cardio-vasculaire, du rythme respiratoire, de la tension artérielle, du tonus musculaire, de la consommation de glucose) et provoque une intense activité biologique.La peur survient par surprise, dans ce cas, elle inhibe les facultés de penser ou survient dans l’attente et dans ce cas elle stimule les représentations mentales liées à ce mauvais objet qui crée la peur.La peur est une décharge tonico-émotionnelle douloureuse qui déstabilise la personne en devenir de l’enfant, et lui fait perdre ses capacités d’adaptation à l’entourage. La réaction face à la peur pour échapper au danger est soit la fuite soit l’immobilisation (la peur glace, pétrifie le corps et la pensée).La peur mobilise donc des actions d’autoprotection en éloignant un événement menaçant. En ce sens, la peur a un aspect salutaire évident, alors on peut s’interroger si on se trouve face à un enfant qui n’a jamais peur !Sans la peur, l’espèce humaine existerait-elle aujourd'hui ?L’enfant vit des peurs que nous connaissons tous : la peur d’une personne inconnue, la peur de l’obscurité, la peur de la nouveauté qui déstabilise les repères de sécurité, la peur de rester seul, la peur du médecin, la peur des animaux, la peur d’être agressé. Ce sont des peurs ordinaires pour chaque enfant, cependant des parents attentifs et sensibles aux émotions de leur enfant sont à coup sûr les meilleurs agents pour le sécuriser en lui donnant les moyens de se réassurer, en lui donnant la possibilité de se sécuriser lui-même par la découverte du plaisir de jouer, de parler la peur, voire même de la ridiculiser.Il est vrai que pour se sécuriser de situations quelquefois douloureuses, l’enfant les joue et les rejoue avec insistance. La distance émotionnelle est prise par la représentation corporelle des faits réels.Précocement, l’enfant est capable de transformer la réalité vécue pour se protéger et se sécuriser par la magie du plaisir de jouer. La plupart des enfants en sont capables, mais d’autres tardent à trouver un tel processus de sécurisation, alors ils perdurent dans l’émotion de la peur sans pouvoir la dépasser.Des peurs primitivesAu cours des premières années, l’enfant vit des moments difficiles à cause de ses peurs et de son insécurité affective. J’ai évoqué la peur de l’obscurité qui éveille des images fantasmagoriques, la peur d’être abandonné qui naît précocement à partir du moment où le bébé vit la perte de l’attachement à la mère, la peur de la nouveauté qui déstabilise ses repères de sécurité, mais en deçà de ces peurs ordinaires, le bébé est dès les premiers mois soumis à des peurs primitives qui peuvent avoir :
Ÿ soit de graves conséquences sur son développement futur si celles-ci ne sont pas suffisamment contenues ,
Ÿ soit avoir des conséquences tout à fait positives si celui-ci vit une enveloppe maternante protectrice de qualité qui le protège des agressions internes et externes, conséquence positive lui permettant de développer toutes ses fonctions dans les meilleures conditions.En effet, le bébé risque de vivre des peurs envahissantes, tenaces s’il est insuffisamment protégé contre des agressions internes et externes par son environnement. Il se sentira menacé lorsqu’il a faim ou soif, lorsqu’il a trop chaud ou froid, lorsqu’il doit attendre d’être soulagé, menacé par des manipulations brusques et répétées, quelquefois violentes, par des contacts agressifs, des bruits excessifs ou bien se sentira menacé par l’absence de solidité d’un soutien, alors il risquera d’éprouver la peur de tomber dans le vide et de se désunir.Si le bébé vit la répétition de cette « maltraitance », tout son corps est en tension excessive, des tensions douloureuses de toutes les fonctions corporelles développées et en voie de développement, ces tensions douloureuses sont vécues comme une agression interne continue, un agresseur corporel non identifié. Cet état tensionnel permanant des premiers mois est à l’origine d’un état permanent de peur, se manifestant par des pleurs, des gesticulations excessives, le refus de s’alimenter, et voire des insomnies. Ce sont là, des faits d’avertissement d’un dysfonctionnement du principe de plaisir, d’une souffrance psychique à venir.Ainsi, au cours des premiers mois, le bébé risque de vivre un état permanent de tension corporelle à l’origine d’une intense angoisse-tension.L’angoisse-tension est un concept qu’il est nécessaire de mettre en évidence comme étant l’angoisse de tous les dangers ou l’angoisse de tous les espoirs.L’angoisse-tension, l’angoisse de tous les dangersEn effet, l’intensité de l’angoisse-tension est à l’origine des angoisses archaïques de perte du corps, telles que les angoisses de chute, de morcellement, d’éclatement, de liquéfaction qui aggravent l’apparition de l’unité du corps et limitent largement le développement des fonctions instrumentales (sensation, tonicité, motricité, équilibration, latéralisation).D’ailleurs, on est en droit de penser que les troubles psychosomatiques (troubles digestifs, respiratoires) renvoient presque toujours à des angoisses des premiers mois qui n’ont pas été dépassées. Les somatisations du jeune enfant, voire de l’adulte, seraient-elles alors des voies de résolution des tensions excessives du corps ?L’angoisse-tension qui perdure, induit l’échec d’une dynamique de plaisir, ayant pour conséquence de limiter gravement les formations psychologiques futures (affects, désirs, rêves, fantasmes) comme je l’évoquerais plus avant. Dans ce cas, c’est le corps agitation qui fonctionne.A ce propos, il est important de rappeler que le développement instrumental, affectif, cognitif et intellectuel dépend d’un vécu narcissique à une période de développement de l’enfant où celui-ci est encore indifférencié, et où s’ébauche son individuation (vers 6/8 mois). Ainsi, toute perturbation à cette période risque de retentir en même temps sur les aspects instrumental, affectif, cognitif et intellectuel, et avoir des conséquences futures graves dans tous ces aspects à la fois.L’échec d’un vécu narcissique de plaisir risque d’être catastrophique pour le devenir de certains enfants. C’est le cas de ces enfants atypiques, dans le cadre scolaire, qui ont besoin alors d’une aide soutenue. C’est le cas des enfants qui ont vécu dès la naissance, voire même avant de naître, une carence d’interactions précoces à cause d’un entourage absent, brutal, rejetant voire intrusif.Et, j’insiste : ce sont les perturbations au niveau du corps en relation (la carence des interactions précoces qui constituent le dénominateur commun de tous les blocages du développement de l’enfant). Ce qu’il convient de retenir, c’est le lien entre les traumatismes d’un vécu précoce et le blocage des fonctions instrumentales, le blocage de la capacité à symboliser et l’échec des premiers apprentissages scolaires.Ces enfants qui ont vécu la faillite de leur environnement, dont les interactions ont été si pauvres, sont dominés par des tensions internes douloureuses, ils sont plein de rage et de colère et risquent d’être violents sadiques et persécuteurs, leur haine envers l’adulte est supérieure à leur amour, le mauvais objet interne est plus fort que le bon objet, l’affect de déplaisir est plus fort que l’affect de plaisir. L’ambivalence affective de ces enfants est intense, ils sont envahis par la recherche d’un lien d’amour, aussi peuvent-ils s’attacher affectivement, sans retenue, à certaines personnes et soudainement les agresser, les insulter comme s’ils désiraient les détruire. Comment peuvent-ils dans ce cas, vivre la sécurité nécessaire à une approche sereine de la réalité, de la connaissance et du savoir.Je crois que vous connaissez assez bien ces enfants.La peur primitive permanente qui actualise l’angoisse-tension, dans le présent, qui taraude ces enfants, est à l’origine de la peur d’être abandonné issue de la séparation avec le parent. La peur de l’abandon est vécue aussi dans le corps comme un autre état tensionnel, comme un autre danger, celui d’être « laissé tomber affectivement ». Nous n’imaginons pas les douleurs, les souffrances que peuvent vivre certains enfants. Bien heureusement, ils restent l’exception.Qu’en est-il de l’angoisse-tension de tous les espoirs ?L’angoisse-tension de tous les espoirsEn effet, les parents, par leur attitude attentive, répondent le plus justement possible aux besoins de l’enfant et à sa sécurité affective. Ainsi, au cours de la période archaïque de son développement, celui-ci vit des expériences primaires agréables vécues en relation avec les parents, telles que des sensations végétatives agréables liées à la nutrition, à l’évacuation ou encore des sensations proprioceptives comme le bercement, le portage dans les bras, le déshabillage, les caresses. Ces expériences primaires libèrent la dopamine, l’hormone cérébrale du plaisir ; mais l’enfant vit aussi des expériences primaires désagréables inévitables dues à l’attente des soins, à des douleurs digestives, à des positions douloureuses, à des mouvements trop brusques, des vêtements trop serrés, des contacts corporels trop appuyés, il vit alors un certain degré d’angoisse-tension.Malgré l’attitude attentive des parents, perdure un degré d’angoisse mais qui s’avère nécessaire au développement psychologique de l’enfant. Il s’agit d’un degré d’angoisse qui crée une dynamique de recherche, de résolution pour dépasser les tensions du corps.En effet, les expériences primaires agréables et désagréables sont engrammées car elles correspondent à des modifications neurobiologiques et hormonales cérébrales. Ces expériences engrammées forment « la mémoire implicite ».Cette mémoire est très sollicitée par l’enfant car elle est à l’origine des affects de plaisir, des affects de déplaisir, des désirs, des rêves et des fantasmes archaïques issus des expériences corps à corps vécues et partagées avec l’objet maternant.L’enfant pour s’abstraire de l’angoisse-tension, source de douleurs et de souffrances, imagine, invente à partir de ses sensations agréables vécues avec autrui, le plaisir, le désir, le rêve, le fantasme, une large dimension psychoaffective.Ainsi :Ÿ l’affect de plaisir est une énergie positive issue d’une sensibilité organique végétative et proprioceptive partagé avec l’objet maternant. De ce fait, l’affect de plaisir garde son aspect pulsionnel et relationnel (la pulsion orale, la pulsion motrice).
L’affect de plaisir renvoie à la genèse du psychisme. Le plaisir ouvre au monde, alors que l’affect de déplaisir ferme cette ouverture.Ÿ le rêve comme production métaphorique est nécessaire à l’éloignement de la douleur et de la souffrance.Ÿ le désir est désir de renouvellement de plaisir. Il est aussi désir de grandir (un concept trop oublié).Ÿ c’est à partir du désir de plaisir que l’enfant se constitue des scénarii imaginaires : les fantasmes archaïques.- fantasmes issus de l’oralité, du contact, tels que les fantasmes d’incorporation, de dévoration, de destructivité, de fusionalité, d’omnipotence.- fantasmes issus de la mobilisation du corps dans l’espace tels que ceux d’oscillation de giration, d’élévation, de chute, d’immobilisation, de rythmesAutant de fantasmes que l’enfant agira dans la réalité d’une manière pulsionnelle et répétitive par le jeu spontané comme puissant processus de réassurance profondeL’enfant est donc créateur d’une vaste création originaire qui formerait selon certains psychanalystes « l’inconscient originaire non refoulé ».L’enfant est créateur de ses pensées imaginaires, à l’origine de la pensée permettant plus tard de se penser et de penser le monde.Ÿ Cette source originaire donne une place prépondérante à l’expressivité du corps, au jeu créatif et spontané de l’enfant, à la création artistique de l’adulte comme le dessin, la peinture, la sculpture, la danse, le rythme, le chant. Cette création de l’adulte est source d’un plaisir pulsionnel sans limite où le mouvement, le rythme, la voix et tous les matériaux de la création sont les satisfactions sensuelles qui apaisent l’angoisse. Cette expressivité du corps sur fond de fantasmes archaïques est source de représentation de soi, de symbolisation d’événements lointains, ils sont des moyens de sécurisation, de réassurance profonde qui ouvrent la voie à d’autres développements.Ÿ Il est possible maintenant d’avancer que l’angoisse-tension est le catalyseur qui facilite la transformation du besoin biologique satisfait - du biologique humanisé - en affect de plaisir, en désir et en fantasme. On peut dire que l’angoisse fonde l’humain. Ainsi, l’angoisse-tension est-elle dépassée, apaisée et ouvre-t-elle la voie à l’énergie du plaisir qui favorise le développement psycho-affectif, cognitif et instrumental du jeune enfant.Ÿ Mais, l’angoisse-tension risque de ressurgir et de s’intensifier lorsque l’enfant vit un grave choc émotionnel, drame, rupture familiale, abandon affectif anéantissant l’énergie du plaisir et bloquant tous les aspects du développement somatique et psychique. C’est, je crois, le cas de nombreux enfants que vous aidez.A partir des propos précédents, il est possible alors de concevoir des pistes d’aide à l’enfant qui souffre à la condition de se souvenir : que l’affect n’apparait que si des représentations du passé, l’originaire, ressurgissent au travers de la symbolisation de fantasmes issus du corps, comme la dévoration, la destructivité, la persécution, la fusionalité, l’omnipotence et la mobilisation du corps dans l’espace. Toutes ces symbolisations permettent à l’enfant d’évacuer ses peurs primitives, sa souffrance et de libérer l’énergie de l’affect de plaisir.Mais, comment favoriser la résurgence de l’originaire ?Les résonances tonico-émotionnelles réciproques existent dans la relation d’aide à l’enfant, celles-ci doivent vivre car elles sont la condition de l’émergence de l’originaire c'est-à-dire des fantasmes archaïques. Toute implication corporelle, émotionnelle, partagée avec un enfant libère l’affect de plaisir de la période originaire.Il n’y a pas d’aide possible pour l’enfant qui souffre, sans un vécu émotionnel partagé avec le spécialiste de l’aide.Le jeu spontané de l’enfant est un vrai besoinLe jeu spontané est la forme d’expression privilégiée de l’enfant et simultanément un puissant processus de réassurance profonde car ce qui est exprimé dans le jeu créatif et spontané est toujours quelque chose du passé, de l’enfance, de l’originaire.De ce fait, on peut dire que l’enfant qui joue est joué par son originaire.Jouer librement est vital pour l’enfant car jouer, c’est vivre un plaisir compulsif de la représentation de soi, de la symbolisation, un plaisir compulsif de la répétition, jouer pour l’enfant, c’est vivre une étape psychologique de son développement avant que celui-ci ne s’installe dans le monde de la réalité des adultes.Alors, ne le précipitons pas dans des exigences qui ne correspondent pas à sa maturation affective, car il doit épuiser son omnipotence magique pour se sentir en sécurité et être prêt à opérer. Observons-le jouer avec beaucoup d’attention pour le penser et partageons avec lui le plaisir qu’il vit lorsqu’elle ou il :Ÿ se balance au bout d’une corde, roule, chute, saute, glisse, grimpe,Ÿ s’enveloppe dans un tissu, se cache dans un coffre,Ÿ lorsqu’elle ou il est cavalier, conducteur, guerrier, danseuse, chanteuse princesse, papa, maman, bébé,Ÿ est loup, crocodile, dragon, sorcière, le héros omnipotent du dessin animé,Ÿ lorsqu’elle ou il construit, détruit, dessine, joue avec les mots.Tous ces jeux sont des jeux symboliques qui apparaissent spontanément dans la pratique d’aide.Ainsi, je conçois que la pratique d’aide réside fondamentalement dans le recherche du plaisir amalgamé à des représentations imaginaires, plaisir qui a fait tant défaut à l’enfant et a limité très précocement une dynamique d’investissement affectif des productions les plus sensorielles, corporelles et intellectuelles.Alors, spécialistes de l’aide à l’enfant :Laissons-nous aller à notre propre sensibilité émotionnelle, à notre attitude chaleureuse d’accueil et d’accompagnement qui transforment la souffrance de l’enfant parce que les personnes qui aident ne sont pas comme les autres.Laissons-nous aller à notre propre plaisir d’être là pour l’enfant, pour lui, mais pas avec lui, en oubliant tout de lui, de son histoire familiale douloureuse et scolaire.Laissons-nous aller à jouer sans aucune arrière-pensée d’aide cognitive, mais est-ce possible de vivre cette liberté dans une institution qui risque de vous presser par ses exigences ?Aider un enfant qui souffre demande de la part du spécialiste de l’aide de se vivre libre, sans culpabilité d’être loin de l’apprentissage, mais au plus près de l’enfant. Aider un enfant qui souffre demande de ne pas rechercher son changement car moins nous le rechercherons, plus le changement arrivera, et l’enseignant vous dira :« Qu’avez-vous fait ? Il s’intéresse, il parle, il est un autre enfant, un autre élève. »Et pour conclure,Au congrès de Reims, il y a cinq années, j’avais déjà évoqué l’affect de plaisir de l’enfant comme étant un facteur qui accroit le désir de l’élève d’apprendre et rend l’apprentissage plus efficace.Je martèle toujours ce principe depuis des dizaines d’années, et aujourd'hui mon propos n’a pas changé. Cependant, il ne suffit pas de décréter « plaisir d’apprendre » car si le plaisir d’apprendre est conditionné à l’action, à l’expérience, à la création, à la recherche individuelle et collective en deçà de ces conditions pédagogiques, le plaisir d’apprendre est conditionné à une relation, celle d’être estimé par l’enseignant, d’être reconnu dans ses potentialités et ses compétences même les plus réduites. L’enfant découvre le plaisir d’apprendre si l’enseignant apprécie, stimule ce que celui-ci sait faire et s’abstient de mettre en évidence ce qu’il ne sait pas faire.Le plaisir d’apprendre suppose donc une pédagogie centrée sur l’enfant afin que celui-ci soit au centre du dispositif éducatif (une idée qui a disparu aujourd'hui) soutenu par une enseignante, un enseignant de qualités personnelle et professionnelle indiscutables.Au centre du dispositif éducatif, utopie me direz-vous ? Non, il s’agit d’un choix de formation philosophique, psychologique et pédagogique, tout simplement un choix humain pour un devenir plus harmonieux des enfants à l’école. votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 12 Décembre 2015 à 10:46
exemple d'un mémoire : Les Liens d’Attachement : un tremplin pour la Vie Regard singulier du psychomotricien en Protection Maternelle et Infantile.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
-
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 13:03
article issu de : http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/FamilyandPeerRelations/AttachmentandEmotions/Pages/Angermanagement.aspx
Qu'est-ce que la colère et pourquoi faut-il la maîtriser?
La colère est une émotion humaine normale. Cependant, la colère non maîtrisée peut mener à des comportements agressifs. Cela peut provoquer des problèmes physiologiques ainsi que des comportements dangereux.
Les comportements agressifs se manifestent tout d'abord au cours de la petite enfance. C'est à cette période que les enfants sont naturellement plus agressifs que tout autre groupe d'âge. L'incapacité de parler pourrait expliquer pourquoi les comportements agressifs apparaissent à cet âge.
Les jeunes enfants doivent apprendre à maîtriser leurs émotions. Des comportements agressifs qui se produisent fréquemment peuvent, au fil du temps, engendrer des problèmes à l'école, à la maison et avec les amis et la famille. Une étude a révélé que, parmi les enfants qui connaissent des épisodes de comportements agressifs tôt dans la vie et dont la fréquence augmente avec l’âge, 1 sur 7 est plus susceptible de connaître :
- des échecs scolaires;
- le chômage à l'âge adulte;
- la violence physique;
- des maladies mentales.
La maîtrise de la colère aide un enfant à apprendre de meilleures façons pour composer avec ses sentiments de colère.
Maîtriser la colère
La maîtrise de la colère vise à réduire les sentiments négatifs que l’on éprouve. Cela peut atténuer les changements physiologiques négatifs qu'entraîne la colère. Comme les autres émotions, la colère peut provoquer des changements physiologiques, tels qu'une augmentation de la pression artérielle et une augmentation des hormones liées à l'énergie, comme l'adrénaline
Il y a trois principales méthodes que votre enfant peut utiliser pour composer avec ses sentiments de colère :
- exprimer sa colère;
- réprimer sa colère;
- apaiser sa colère.
Exprimer la colère, comprendre ses émotions
Plus un enfant exprime sa colère, moins il aura tendance à s’emporter. Afin d'exprimer sa colère, il doit communiquer. Il doit être en mesure de commencer des phrases en disant « Je suis fâché parce que… » « Je me sens en colère parce que… ». Les enfants doivent exprimer leurs besoins. Ils doivent savoir exprimer ce dont ils ont besoin sans blesser les autres. Les parents peuvent aider leurs enfants à comprendre leurs émotions en leur demandant comment ils se sentent lorsqu'ils sont calmes et heureux. Ils peuvent leur demander comment ils se sentent lorsqu'ils sont en colère. Il pourrait également être utile de faire remarquer à l’enfant les émotions ou les sentiments des autres personnes, comme « cet homme à la télévision semble en colère ».
Réprimer la colère : l’accepter et la rediriger
On peut réprimer la colère et la convertir en une autre émotion. Pour ce faire, votre enfant doit porter son attention sur autre chose, une chose positive. C'est une bonne technique pour les enfants plus âgés et pour les adolescents.
La technique a pour objet d’aider votre enfant à reconnaître sa colère puis à la convertir en quelque chose de positif et de constructif. Vous pouvez demander à votre jeune enfant de dessiner ce qu'il ressent. Un enfant plus âgé peut écrire ce qu'il ressent. Il pourrait confronter ce qui est à la source de sa colère en offrant une autre solution au problème.
Cependant, cette technique comporte un danger. Si votre enfant ne convertit pas la colère, la colère inexprimée peut être nuisible pour sa santé. La colère inexprimée peut faire augmenter la pression artérielle ou provoquer la dépression.
Cependant, il ne faut pas accepter des comportements inacceptables pour autant. Les enfants qui sont « récompensés » pour leurs crises de colère continuent d'en faire. Les crises inacceptables devraient avoir des conséquences naturelles et logiques qui sont imposées calmement. Par exemple, si l'enfant brise un jouet alors qu'il est en colère, vous ne devriez pas remplacer ce jouet. S'il brise un objet qui appartient à l'un des membres de la famille, il devrait payer pour cet objet avec son argent de poche ou en faisant des tâches supplémentaires.
Se calmer, prendre un temps de repos
Chaque enfant doit apprendre à se calmer. Cela l’aide à contrôler son comportement extérieur. Voici des exercices utiles :
- prendre des respirations profondes;
- faire une marche à l'extérieur;
- passer du temps seul;
- faire du yoga, des arts martiaux ou d'autres formes d'exercice.
À quel moment faut-il obtenir de l’aide médicale?
Si vous croyez que la colère de votre enfant est réellement hors de contrôle et si elle se répercute sur ses interactions avec la famille et les amis, consultez un médecin. Votre médecin de famille pourrait vous diriger vers un psychologue ou un autre professionnel autorisé de la santé mentale. Ils peuvent travailler avec votre enfant et avec votre famille. Ils peuvent développer un plan pour modifier les façons de penser et les réactions de votre enfant. Cela peut aider à améliorer son comportement.
Comment vous pouvez aider votre enfant
Voici quelques conseils que vous pouvez partager avec votre enfant. Ils peuvent aider votre enfant à contrôler sa colère :
Se mettre « hors-jeu »
Allez dans une autre salle. Demandez-lui de faire une pause par rapport à la situation qui le met en colère. Donnez le temps aux émotions de se calmer.
Apprendre comment communiquer sa colère
Une fois que votre enfant est calme, encouragez-le à exprimer sa frustration sans chercher la confrontation. Par exemple, demandez à votre enfant de terminer la phrase : « Je suis en colère car… ».
Pratiquer des techniques de relaxation
Certains enfants réagissent bien à des classes qui inculquent la discipline. Cela comprend le karaté ou d'autres types d'arts martiaux. D'autres enfants réagissent bien à des classes qui encouragent la relaxation. Cela comprend le yoga et la méditation. Ils mettent l'accent sur la respiration et les étirements. D'autres enfants ont tout simplement besoin de passer du temps seul.
À retenir
- La colère est une émotion normale. La colère non maîtrisée peut mener à des comportements agressifs.
- La maîtrise de la colère peut aider un enfant à apprendre de meilleures façons de composer avec des sentiments de colère.
- Un psychologue peut vous aider à mettre au point des méthodes pour modifier les façons de penser et les réactions de votre enfant.
- Vous pouvez aider votre enfant en l'encourageant à exprimer sa colère verbalement, en l'aidant à convertir sa colère en une autre émotion.
- Certains enfants réagissent bien à des classes de karaté ou d'autres types d'arts martiaux. D'autres réagissent bien au yoga et à la relaxation.
Mark Feldman, MD, FRCPC
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 13:00
article issu de : http://www.ensemblenaturellement-leblog.com
LA COLÈRE A QUOI CA SERT? COMMENT L'EXPRIMER? COMMENT AIDER NOS ENFANTS?
Lorsque notre enfant éprouve une émotion intense, telle que la colère, la question est "Que puis-je faire pour l'aider?"
Qu'est ce qu'une émotion?
Les émotions sont des sources d’informations précieuses dans toutes les situations de notre vie quotidienne et il est dangereux de les ignorer.Beaucoup de gens pensent que « gérer ses émotions » veut dire arriver enfin à les dompter, à les contrôler, les refouler et surtout ne plus les ressentir! A cause de ce désir de contrôle absolu, ces personnes font la « cocotte minute ». Elles se contiennent le plus qu’elles peuvent, font monter la pression, puis explosent en cris, larmes ou bouffées de panique…
Lorsqu’on réprime et qu’on nie ses émotions, elles prennent le pouvoir et exercent un contrôle négatif sur nos vies.
Les émotions ne surgissent pas dans nos vies sans raison. Chaque émotion a une fonction, une information utile à nous transmettre sur notre vécu. C’est pourquoi « gérer ses émotions » n’implique pas de les contrôler et de les combattre mais au contraire, de savoir les accueillir et tenir compte du message qu’elles véhiculent.
Qu'est ce que la colère?
la colère est une émotion saine, qui apparait en réponse à une frustration, et qu'en tant que réaction normale, elle doit être respectée et entendue.
La colère est la garante du respect de soi (besoin entravé). C’est pourquoi elle est indispensable pour défendre son territoire et ses valeurs.
Il y a plusieurs degrés de colère, elle va du premier frémissement d’agacement à la fureur dévastatriceLa colère est différente de la rage, vous pouvez maintenant cesser d’en avoir peur et la réhabiliter. Bien gérée c’est une émotion positive et constructive. Cependant agissez tôt dès les 1er frémissements d’agacement.
Le coussin de la colère, pour ou contre?
Isabelle Filliozat propose d'inviter l'enfant à "taper" sur un coussin de colère. L'enfant peut ainsi évacuer, faire sortir sa colère. L'enfant est accompagné lorsqu'il évacue sa colère.
Au contraire, Rosenberg dans "Les ressources insoupçonnée de la colère" affirme qu'en frappant sur un oreiller, ne font qu'amener la colère plus près de la surface et augmentent la probabilité que ces gens l'expriment plus tard d'une manière dangereuse pour eux-mêmes et pour les autres."
Thich Nhat Hanh, maître boudhiste vietnamien, dans son ouvrage "la colère, transformer son energie en sagesse" ajoute que cette décharge émotionnelle permet de croire que la colère a disparu, mais c'est une erreur: nous sommes simplement fatigué pour éprouver la moindre émotion. "Si vous taper tous les jours dans un coussin, la graine de la colère ne cessera de se développer en vous. Il ne sert à rien de cogner sur un coussin pour libérer son agressivité. C'est dangereux. Non seulement cela n'évacue pas l'energie de la colère, mais cela la renforce."
Il n'y a pas de solution miracle, le coussin de colère conviendra à certains enfants mais pas à d'autres.
Exprimer ses emotions
D'après Rosenberg, la colère est à l'origine d'un besoin insatisfait. Posez vous la question "Quel besoin a été entravé et qui m'a provoqué cette colère?" besoin de calme? besoin d'être seul?...
Pour Thich Nhat Hant "le secret de la réussite réside dans la pratique continue de la respiration et de la marche conscientes, qui génère l'énergie de la Pleine Conscience, seule capable de maîtriser la colère."
Rosenberg dit "qu'il suffit de se taire, de ne pas se mettre à critiquer la personne sur le moment et de n'entreprendre aucune action visant à la punir. Arrête-toi et contente-toi de respirer."Respirer serait donc la solution pour gérer la colère?
Thich Nhat Hanh nous invite à "prendre soin de votre colère avec beaucoup de tendresse. Elle n'est pas votre ennemie, elle est votre bébé. Quand vos poumons ou votre estomac sont atteints d'un trouble quelconque, vous n'envisagez pas de vous débarrasser de ces organes. Il en est de même pour cette émotion. Acceptez-la parce que vous savez que vous pouvez la transformer en une énergie positive.
Le jardinier biologique ne jette jamais les déchets ; il les transforme en engrais, qu'il utilisera ensuite pour faire pousser des laitues, des concombres, des radis ou des fleurs. Si vous découvrez la présence de déchets en vous – peur, désespoir, haine etc – ne paniquez pas. Comme un bon jardinier biologique, vous pouvez faire face à la situation. « C'est vrai, il y a des déchets en moi. Je vais les transformer en un engrais efficace qui fera renaître l'amour. »
Dès qu'elle se manifeste, abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire, car votre tâche la plus importante est de revenir en vous et de prendre soin de votre colère tel un bébé. Rien n'est plus urgent. Posez une main sur vous, inspirez, expirez (comme une maman qui berce son bébé)
Quand votre calme intérieur sera revenu, vous serez en mesure d'exprimer votre frustration avec douceur et amour.
Comment aider nos enfants?
Beaucoup de gens ont peur de leurs émotions parce qu’ils subissent passivement et douloureusement. Mais les émotions ne font souffrir que parce que nous les comprimons et que nous les refoulons. C’est exactement comme lorsqu’on s’empêche d’aller aux toilettes.
La douleur vient du fait de se retenir. Lorsqu’on s’abandonne enfin à ses fonctions organiques, on ressent un soulagement quasi immédiat. Il en va de même avec les émotions.
Pour effectuer une bonne éducation des émotions, il faut:
1- connaître toutes les émotions et leur fonction.
2- savoir mettre des mots sur les ressentis de l’enfant
Un enfant tombe
Allons ce n’est rien! Tu n’as pas mal. Arrête de pleurer à Tu as du être surpris, Et puis sûrement, ça t’a fait mal. Et peut être que tu as eu peur… Et c’est possible aussi que tu sois vexé qu’on t’ait vu tomber.à proposer des mots, pas les imposer. Dés que les bons mots sont venus se poser sur le bon ressenti, l’enfant dit « ouiiiiiiiiiii » et se calme instantanément.
Quand l’enfant aura grandit, il sera capable de verbaliser ce qu’il ressent.3- Il faut distinguer « émotions » et « comportement »
«Tu as bien le droit de…(émotion); pour autant, cela ne t’autorise pas à … (comportement) »
Colère / coup de râteau; rage / tout casser…4- Aider l’enfant à retrouver son calme intérieur
Les parents doivent apprendre à l’enfant comment retrouver son calme.
- en respirant lentement et profondément
- en regardant vers le haut
- un espace d’intimité pour se reprendre (attention, il ne s’agit pas de punition ou une mise à l’écart!) « Je te laisse un petit moment à toi pour que tu puisses te calmer. Viens me dire quand tu te sens mieux ». votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 12:55
article issu de : https://laptitesylvia.wordpress.com/2013/08/02/la-morsure-en-creche/
La morsure en crèche …
Voici un article que j’ai en « brouillon » depuis quelques mois et je profite des vacances pour le terminer et ainsi le publier. C’est un sujet qui me tient à coeur, car j’y suis confrontée quotidiennement dans mon travail…
Les enfants mordent et c’est un fait. Néanmoins, c’est une véritable épreuve pour l’enfant mordu, les parents et nous, professionnelles.
Tout d’abord, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les enfants mordent.
Au cours de la première année, les enfants commencent à faire leurs dents et parfois le simple fait de mordre ou d’exercer une pression sur la gencive, permet de soulager la douleur.
C’est à ce moment-là, que l’on voit apparaître, les anneaux de dentition.Par la suite, les enfants mordent pour :
* Expérimenter différentes choses, comme le goût des choses, leur texture, etc…
* Un mode d’expression quand l’enfant n’a pas acquis le langage.
* Attirer l’attention des adultes.
* Se défendre en cas de menace.
* Imiter d’autres enfants, faire connaissance avec eux …
* C’est un moyen efficace d’obtenir ce qu’ils veulent (jeu, jouet etc.)Sachez également, que les enfants peuvent être agressifs, quand ils sont fatigués, frustrés, surexcités …
En tant qu’EJE, comment j’interviens.
Quand je suis dans une situation de morsure, avant tout, je console et soigne l’enfant qui a été mordu. Ensuite, je me mets à l’écart avec l’enfant qui a mordu, je le mets sur une chaise (chaise d’enfant) ou sur le coussin de la colère, je me mets à sa hauteur et je lui parle clairement, mais fermement : « C’est interdit de mordre ! Regarde, tu lui as fait mal et maintenant il pleure. » S’il est plus petit, je lui dis « on ne mord pas ! ». Et je lui demande de « réfléchir » à son comportement. Après quelques minutes, je retourne le voir et je lui donne une brève explication, sur un ton calme : » Tu as le droit d’être en colère, mais on ne fait pas mal. On ne mord pas ».
J’avoue, personnellement, que j’ai du mal avec cette attitude face au comportement agressif des enfants… Je me suis donc documentée et suite à la lecture d’un article très intéressant ICI (Pour résumer : Lorsque nous demandons à l’enfant de réparer son tort, nous faisons appel à sa bonté, à ce qu’il y a de meilleur en lui. Alors que lorsque nous punissons ou plaçons l’enfant en retrait de façon répétitive, il développe parfois le sentiment d’être un enfant méchant et il se comporte comme tel avec ses poupées ou avec les autres.) Je décide de changer mon attitude face à l’agressivité et souhaite essayer cette « méthode » qui me correspond plus. Le lendemain matin, j’imprime l’article et je le donne en lecture à mes collègues. Nous en parlons et au même moment, se produit un comportement agressif… Je vais voir les 2 petits garçons et je les emmène dans la salle de bain… Je réconforte celui qui pleure et je dis à celui qui a mordu « regarde, tu lui as fait mal. Maintenant, c’est toi qui vas le soigner pour qu’il arrête de pleurer ». Je prends son doigt et mets de la crème. Au début, il me dit non .. Je lui dis : » il a besoin que tu le soignes, car tu lui as fait mal » et tout doucement, il lui met de la crème… Il n’y a plus eu de morsures venant de sa part, pendant la journée et les jours qui ont suivi. Coïncidence ??
Il se peut que l’enfant, morde de nouveau, dans ce cas-là, l’observation est très importante. Bien souvent, il suffit de répondre à ces quelques questions : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ?
Cela permet de réfléchir à la situation et de comprendre ce qui a déclenché ce comportement et d’agir rapidement. Si le comportement persiste, il est nécessaire d’aller plus loin. Que savons-nous de lui, de ce qui se passe avec ses parents, de ce qui se joue dans sa famille ? Qu’est-ce que nous observons dans la journée ? Quand cela a-t-il commencé ? Est-ce constant ou cela varie-t-il dans le temps, ou encore selon la relation avec certains adultes de référence ?
Tous les enfants finissent par apprendre à ne pas mordre, mais certains mettent plus de temps que d’autres. Faites preuve de patience et de fermeté et soyez direct. Plus facile
-à dire-,à écrire, qu’à faire.Mais voilà, il y en a pour qui ça ne passe pas… En effet, dans la structure où je travaille, l’équipe et moi-même, sommes dépassés par un enfant, qui semble souffrir intérieurement… Cela fait plus d’un an que ça dure. Cet enfant, âgé de 2 ans et 8 mois, parle « assez bien » et son seul comportement ou moyen de communication face aux autres enfants, c’est l’agressivité. Il mord, pince, frappe, enfants et adultes, etc.. Néanmoins, individuellement, il peut être : calme, posé, coopératif, etc.. Mais en crèche, il est difficile de se dégager des moments individuels avec chaque enfant.
Suite aux réunions et à une journée péda, nous avons mis en place, le coussin de la colère avec comme outils, le livre « Grosse colère« . Avec l’aide de la psychologue, nous avons réfléchi à nos pratiques professionnelles, nos interventions en lien avec son comportement, etc … Mais rien ne fonctionne, cela n’a aucun impact… Nous, c’est-à-dire : L’équipe, la psychologue, la psychomotricienne et moi-même, sommes entrés en relation avec les parents, nous leur avons donné nos observations, nos ressentis, nous les avons orientés etc… Des démarches ont été faites… Ce que je peux vous dire, c’est qu’à notre niveau et avec nos compétences, nous avons mis en place tout ce que nous pouvions. Même si je sais que cela dépasse mes compétences, j’aurais aimé l’accompagner avec des spécialistes, afin de contribuer -ne serait-ce qu’un peu- à son bien-être. Et surtout, j’avais besoin d’obtenir des réponses et rien que l’idée de ne pas savoir, me frustre énormément. Car j’ai vécu des choses difficiles avec lui, j’ai eu beaucoup de doutes, de remises en question et personnellement, je vis mon accompagnement envers lui comme un échec. Ceci est un résumé d’une situation difficile et délicate et par confidentialité je ne peux en dire plus.
Pour moi, un enfant qui adopte ce comportement et que celui-ci dure dans le temps, c’est un enfant qui traduit un mal-être. Et celui-ci, doit être entendu. Néanmoins, ce comportement agressif représente un danger pour lui et pour les autres enfants. Il est donc nécessaire de protéger le reste du groupe. Mais que faire ? Malheureusement, je n’ai pas la réponse à cette question …. Quoique … j’ai bien une idée mais cela est impensable, inimaginable…
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 12:49
article issu de : https://www.colibris-lemouvement.org/changer/eduquer/laccompagnement-emotionnel-de-lenfant
L'accompagnement émotionnel de l'enfant
Nous portons une responsabilité face à nos enfants : les aider à acquérir suffisamment de confiance en eux, de sécurité intérieure et d’autonomie. Dans ce monde en mutation, les enfants ont plus que jamais à construire une identité forte. Nous le savons aujourd’hui, angoisse, dépression, comportements violents, dépendance relationnelle, addictions diverses sont des conséquences de manques, de blessures relationnelles, d’échecs de communication.
Accueillir et encourager les émotions de son enfant, l’écouter, lui donner la permission de libérer ses tensions, c’est lui permettre de se constituer une personnalité solide, une sécurité intérieure stable afin qu’il aille, serein et assuré, sur son propre chemin et, plus tard, sorte grandi des difficultés de la vie. Et comme les parents ne sont pas les seuls éducateurs, demandons qu’au programme des écoles figure un cours de « compétences sociales » car elles ne sont pas plus innées que les mathématiques ou la géographie. Il est urgent de prendre en compte le développement des intelligences émotionnelle (ce qui se passe à l’intérieur de nous) et relationnelle (ce qui se passe entre les personnes) dans l’éducation de nos enfants, adultes de demain.
En résumé, l’accompagnement émotionnel de l’enfant, c’est :
- D’abord accueillir son émotion par le regard. Être présent à lui avec notre respiration, dans notre attitude intérieure ;
- Mettre des mots sur le ressenti de l’enfant : « tu es très fâché ! »
- Permettre à l’émotion d’aller jusqu'à sa résolution ;
- Quand la respiration de l’enfant est redevenue calme, place à la parole.
Accompagner les émotions de l’enfantLorsqu’un enfant éprouve une émotion, la question est : « Comment puis-je l’aider à avoir conscience de ce qui se passe en lui ? ».
Mettez des mots sur son ressenti : « Je vois que tu es en colère !». Ou aidez-le à mettre des mots dessus. Laissez-lui de l’espace pour s’exprimer. Nous avons tendance à consoler. Ecoutez-le plutôt avant de le consoler : « Je vois que tu as mal ! ». S’il s’est fait très mal, encouragez-le même à pleurer : « Pleure mon amour, pleure fort, serre-moi et pleure, ça fait mal ! ».
En lieu et place de l’habituel « Pourquoi ? », tentez : « Qu’est-ce qui se passe ? » ou : « Qu’est-ce que tu ressens ? », des questions qui accompagnent le vécu intérieur.Encourager l’expression des émotions
Nos émotions sont utiles. Ce sont elles qui nous donnent notre conscience d’Être.
Les pleurnicheries pour un oui ou pour un non d’un plus grand peuvent être des tentatives de trouver un moyen de pleurer vraiment. Des affects sont bloqués, il a besoin d’une occasion de les libérer. L’enfant cherche une permission, un prétexte pour laisser sortir larmes ou colère. Même l’enfant plus grand qui a accès à la verbalisation, même l’adulte, ont besoin de pleurer, de crier, de trembler, pour se libérer d’émotions fortes.
Toutefois, il y a des pleurs qui guérissent et d’autres qui entretiennent le problème. Les pleurs inutiles partent du haut de la poitrine, et peuvent être sans larmes. Sentiments de substitution, ils servent la répression émotionnelle et non la libération. Les pleurs de libération sont accompagnés de sanglots et de larmes.
Serrez l’enfant contre vous avec fermeté et tendresse jusqu’à la libération de l’émotion contenue. Il va souvent commencer par se débattre, puis se mettra à sangloter. Permettez à l’émotion d’aller jusqu'à sa résolution. Quand la respiration de l’enfant est redevenue calme, place à la parole.L’écoute empathique
L’écoute empathique consiste à refléter ce que vous entendez dans ce que vient de dire l’enfant, en retenant les aspects signifiants, c’est à dire l’émotion, le sentiment ou le désir. Il ne s’agit pas tant d’écouter les mots que d’entendre ce qui les sous-tend.
Centrez-vous sur le mouvement intérieur de l’enfant plutôt que sur les faits. Accompagnez votre enfant et non les événements extérieurs.
S’il dit : « Je n’ai pas envie de dormir ! », répondez : « Tu n’as pas envie du tout ! » plutôt que : « Il faut bien que tu dormes pour être en forme demain ».
Vous pouvez continuer par quelque chose comme : « Tu as le droit de ne pas avoir envie, c’est vrai. Tu préférerais continuer à jouer, je peux comprendre ça », tout en continuant à le coucher.Une émotion, c’est quoi ?
Une émotion est une réponse physiologique à une stimulation, à une modification de l’environnement. Tandis qu’un sentiment est déclenché par les pensées, et est donc « psychologique ». Les émotions sont à exprimer, les sentiments à décoder pour permettre à l’émotion sous-jacente de s’exprimer.
L’émotion a une double fonction biologique : réguler l’état interne de l’organisme et produire la réaction adaptée à la situation. Une émotion est donc un processus biologiquement déterminé qui dépend de dispositifs cérébraux mis en place au terme d’une longue histoire évolutionnaire. Une émotion dure quelques minutes au plus et se déploie en trois temps : charge, tension, décharge.Prenons pour exemple la peur :
- Charge : libération d’adrénaline, accélération cardiaque, afflux de sucre et d’oxygène là où le besoin s’en fait sentir.
- Tension : l’organisme mobilise le maximum d’énergie pour faire face à la situation.
- Décharge : c’est le retour au calme ! Une fois le danger écarté, le corps a besoin de revenir à son équilibre de base. Le système nerveux parasympathique entre en jeu, les tensions se relâchent, créant pleurs et tremblements.
Les émotions sont donc là pour éviter la perte de l’intégrité. Elles veillent à notre conservation et orientent notre croissance.
Les émotions, à quoi ça sert ?
Joie, colère, amour, tristesse, dégoût… Les émotions sont au cœur du sentiment de soi. Elles sont l’expression de la vie en soi. C’est pourquoi il est essentiel de les exprimer, au contraire des sentiments !
La peur aide à se préparer et à se protéger ; la tristesse accompagne les deuils ; la joie est expansion, elle nous dynamise, nous guide et favorise l’apprentissage ; la colère définit nos limites, nos droits, notre espace, notre intégrité, elle est réaction à la frustration ; l’amour nous relie à autrui.
Pleurer, crier, trembler sont des remèdes aux inévitables tensions de la vie. L’existence d’un petit enfant est pleine de frustrations, de questions, de peurs, de colères… Tous les bébés ont besoin de pleurer, aussi bien accompagnés soient-ils. L’émotion permet de se récupérer, de se reconstruire après une blessure.Libérez les émotions !
Un événement blessant, un accident, une épreuve, une injustice ne deviennent traumatismes que si on ne laisse pas libre cours à l’expression des émotions qu’ils suscitent.
Réprimer ses émotions conduit en effet à des répétitions douloureuses, à la dépression, l’angoisse et peut engendrer des symptômes physiques. Il est donc urgent d’apprendre à identifier, à nommer, à comprendre, à exprimer, à utiliser positivement ses émotions sous peine d’en rester esclaves.
Et pour se libérer d’une émotion désagréable, à condition qu’elle soit authentique, rien de plus facile : il suffit de la laisser s’exprimer ! Mais si vous êtes en colère, inutile de frapper la personne qui a déclenché votre ire, préférez un coussin ! Attention, exprimer un sentiment parasite, c’est à dire une réaction émotionnelle disproportionnelle ou inadaptée à la situation, ne libère pas !
L’expression d’une émotion libère, l’expression d’un sentiment le renforce !Respecter les émotions de l’enfant
Respecter les émotions de l’enfant, c’est lui permettre de sentir qui il est, de prendre conscience de lui-même ici et maintenant, de percevoir son « aujourd’hui » en relation avec « hier » et « demain ». C’est le placer en position de sujet, le considérer comme une personne qui a le droit de désirer et non comme un objet. C’est l’autoriser à se montrer différent de nous. C’est lui donner la possibilité de répondre à sa manière très particulière à la question : « Qui suis-je ? », à construire son sentiment d’identité et de personnalité propre. C’est aussi l’aider à se réaliser, à être conscient de ses ressources, de ses forces comme de ses manques, à se percevoir avançant sur un chemin, son chemin.
Interdire à un enfant d’exprimer son émotion, c’est le laisser en tension. Empêcher un réel retour au calme. Les émotions seront alors réprimées, non dépassées.Laisser l’enfant exprimer ses émotions
Un adulte se sent « libéré » après avoir pleuré. Pourtant, il se précipitera sur son tout petit et lui dira : « Ne pleure pas, ne pleure pas ! ». Aucun parent n’aime voir souffrir son enfant. Malgré notre expérience personnelle, nous continuons d’imaginer que l’enfant qui pleure souffre. Alors qu’il est au contraire en train de se soulager de sa souffrance.
C’est vrai, il n’est pas toujours facile d’écouter les émotions des enfants. Elles nous remuent et menacent aussi notre sentiment d’être une « bonne mère » ou un « bon père ». Elles nous insécurisent : « Que dois-je faire ? ». Elles mettent en échec notre rôle de protecteur, nous confrontent à notre fonction de pourvoyeur. Osons le dire, nous aimerions parfois que nos enfants restent tranquilles, ne pleurent pas, ne crient pas, ne se roulent pas par terre. Nous préférerions qu’ils n’aient pas tant d’émotions ! Seulement voilà, les affects des enfants sont ce qu’ils ont de plus précieux. Là réside leur sentiment d’identité, la sensation de leur existence propre.Accueillir les émotions de l’enfant
Le petit enfant est prisonnier de l’immédiateté de sa réponse émotionnelle, sans médiation de la pensée pour relativiser les choses ou hiérarchiser les enjeux. Il est facilement envahi par ses affects et a donc besoin de nous pour l’aider à trouver la sortie.
D’autre part, il cherche bien naturellement à donner sens à ce qu’il vit. Il le fait avec les moyens du bord. Il organise et interprète ses perceptions à sa manière, à la lumière des informations, souvent incomplètes, parfois déformées, dont il dispose. Ce qui peut donner lieu à des réactions émotionnelles incompréhensibles pour les parents.
Par exemple, Arnaud est agressif, il fait de grosses colères « pour des riens ». Inutile de permettre à Arnaud d’exprimer ses colères, ce sont des sentiments parasites. Ses parents se sont séparés. Dans sa tête, il s’est dit : « Papa est parti, c’est donc qu’il ne m’aime pas parce que je suis un méchant enfant ». Par ses colères, tout à la fois il exprime sa souffrance et justifie le départ de son papa. Derrière cette agressivité parasite, Arnaud réprime une autre colère et beaucoup de peurs et de tristesse. Ce sont ces émotions-là qu’il est utile d’aider Arnaud à exprimer.
Bénédicte, elle, est triste, elle ne participe pas en classe, elle ne joue pas avec les autres enfants. Elle a du mal à trouver sa place. Elle se sent de trop partout. Ses parents se disputent beaucoup. Elle s’est dit : « Papa et maman se fâchent à cause de moi. Si je n’avais pas été là, ils ne se disputeraient pas. C’est ma faute ». La tristesse de Bénédicte est donc parasite et cache sa colère et ses peurs. Bénédicte a besoin d’entendre : « Je te vois triste. C’est vrai que c’est triste d’avoir des parents qui se disputent et tu as surtout le droit d’être en colère contre nous, parce que ce n’est pas juste. Et puis peut-être parfois tu as peur… Parle-moi de combien tu as peur… ».
Quand l’enfant exprime une émotion appropriée, accueillez-la non verbalement, par le regard. Soyez présent dans votre respiration, dans votre attitude intérieure. Éventuellement, selon l’âge de l’enfant, prenez-le dans vos bras.Quelques livres
- « Au Cœur des émotions de l’enfant » d’Isabelle Filliozat, éd. Marabout.
- « Il n’y a pas de parent parfait » d’Isabelle Filliozat, éd. JC Lattès.Questions... suggestions... réactions...
Si vous avez des questions, des suggestions, des réactions sur la page, n'hésitez pas nous contacter !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 12:46
article issu de : http://apprendreaeduquer.fr/comment-gerer-les-grosses-crises-colere-enfants-en-bienveillance/
Comment accompagner en bienveillance les colères des enfants ?
Il existe deux phases dans l’accompagnement des crises de colère :
- accompagner les colères quand elles se présentent,
- prévenir les grosses crises de colère des enfants avec des solutions préventives.
1. Accompagner les colères des enfants
La colère réparatrice
Tout d’abord, je tiens à préciser que la colère n’est pas en soi une émotion à bannir à tout prix. Elle a une valeur réparatrice face à une frustration : c’est ce qu’Isabelle Filliozat appelle la colère réparatrice. Vous pouvez accompagner les colères de votre enfant avec des paroles qui témoignent de votre reconnaissance de ce que vit l’enfant :
« Je comprends que tu sois frustré, tu avais envie de ce bonbon/ jouet ».
Pour autant, frapper, casser, insulter ne sont pas acceptables
« Tu as le droit d’être en colère mais pas de taper. »
« Les gens ne doivent pas se faire mal. Je ferai toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour t’empêcher de te faire du mal ou de faire mal aux autres. »
Un endroit pour se calmer
L’idée est de proposer aux enfants un espace de retour au calme plutôt qu’un isolement au coin.
Cet espace serait agrémenté de :
- coussins,
- peluches,
- crayons et feuilles pour dessiner la colère,
- livres,
- une boîte à émotion (voir cet article : La boîte à émotions pour accompagner les émotions négatives)
- une roue de la colère (voir cet article : Un outil pour aider les enfants à reconnaître leurs émotions et trouver une solution d’expression) grâce auxquels ils auront à disposition des moyens de se calmer par eux-mêmes.
L’adulte pourrait alors demander à l’enfant :
« J’ai l’impression que tu as besoin d’un temps calme. Est-ce que cela t’aiderait d’aller dans l’espace de retour au calme ? Si tu veux, je peux t’y conduire/ t’accompagner ».
Ainsi, l’enfant dispose des moyens de se calmer et ne sent pas exclu. Le temps de retour au calme est structurant et éducatif.
Et quand il ou elle tape, je fais quoi ?
Il ou elle a le droit d’être en colère mais que ça ne lui donne pas pour autant le droit de taper. Taper, c’est interdit car taper fait mal et ceci est valable tout le temps pour toutes les personnes et même les animaux. Il faut que l’enfant comprenne que taper est moins efficace que demander calmement pour obtenir quelque chose ou faire passer un message. Taper ne lui permettra jamais d’obtenir quoique ce soit de qui que ce soit.
« Tu peux dire les choses avec des mots. »
Mettez-vous à genoux à sa hauteur pour lui passer ce message mais refusez de :
- rabaisser votre enfant (« méchant, tu devrais avoir honte »),
- piquer des colères d’exaspération vous-même (allez plutôt vous isoler quitte à appliquer à vous-même la méthode du coussin de la colère ou de la feuille de papier jetée !),
- frapper votre enfant.
Les enfants apprennent de nos gestes plutôt que de nos paroles et ils reproduisent les exemples de leurs premiers modèles : leurs parents
 !
!N’attendez pas la crise, anticipez les prémisses annonciateurs
Quand vous sentez les premiers signes d’une grosse colère pointer le bout de leur nez, n’attendez pas que votre enfant s’énerve. Par exemple, s’il s’agace sur un puzzle qu’il n’arrive pas à terminer ou sur ses pâtes qu’il n’arrive pas à piquer avec sa fourchette, aidez-le : « je parie que cette pièce va ici » ou « qu’est-ce que ça donnerait si tu faisais comme ça ?« . L’idée n’est pas de faire à sa place mais de le débloquer et de le laisser terminer son activité en autonomie. Il sera alors doublement fier : fier de faire tout seul et fier d’accepter l’aide des autres.

A ce moment-là, valorisez sa maîtrise de lui-même et encouragez-le : « Bravo, tu l’as fait tout seul« , « C’est agréable pour toute la famille quand tu restes calme et concentré. » Vous pouvez aussi lui dire que vous comprenez ses sentiments : « Je comprends ce que tu ressens quand tout ne marche pas comme tu veux et je suis vraiment fier(e) de voir que tu es capable de garder ton calme« . Vous donnerez alors des outils à votre enfant pour affronter ses colères et ses frustrations.
Un câlin, pas de raisonnement pendant les colères !
Quand la crise de colère est vraiment forte, il est inutile de raisonner ou d’expliquer quoi que ce soit à votre enfant. Vous pouvez regarder la vidéo sur le fonctionnement du cerveau pour comprendre les mécanismes à l’œuvre : ici.
En gros, lorsque nous sommes en colère, nous sommes comme déconnectés de notre capacité à prendre des décisions logiques. Nous sommes en prises directes avec notre stress et plus rien ne joue le rôle de modérateur des émotions. Ceci est valable pour les adultes… alors imaginez pour les enfants dont le cerveau est en cours de développement
 !
!Non seulement l’enfant est incapable de penser et de se dominer pendant sa crise mais votre attention physique et verbale encourage l’enfant en lui donnant un public. Dans son livre « J’ai tout essayé », Isabelle Filliozat conseille plutôt dans ce cas d’accompagner la colère par un gros câlin à votre enfant afin qu’il se recharge en ocytocine, hormone du bien-être.
2. Solutions préventives
Exprimer sa frustration et gérer sa colère, ça s’apprend
Montrez à votre enfant qu’il existe des manières de s’exprimer sans agresser ni hurler et encore moins taper.
Vous pouvez lui apprendre des techniques pour exprimer sa colère, notamment en utilisant une feuille de papier qu’il ou elle met en boule en imaginant y mettre toute sa colère puis qu’il ou elle jette de toutes ses forces.
Vous pouvez visionner cette vidéo de sophrologie ludique pour plus de détails (la position du karaté pour jeter la colère hors de soi est fortement recommandée dans ce cas
 ).
).Un tableau des émotions pour communiquer sur l’humeur du moment
J’ai rédigé un article sur le tableau des émotions : il est disponible à ce lien. Le tableau des émotions ou tableau des humeurs est un outil alternatif aux punitions et préventif des colères car l’enfant peut l’utiliser pour définir son humeur du moment et vous la communiquer afin que vous la preniez en compte.
Savoir reconnaître ses émotions et les calmer, ça s’apprend aussi

Tant que le cerveau n’a pas atteint sa pleine maturité (pas avant 20 ans, certains chercheurs affirmant même vers 30 ans), les processus de gestion des émotions ne sont pas totalement fonctionnels. L’enfant a alors des difficultés à contrôler et maîtriser ses réactions émotionnelles. L’enfant n’est pas en mesure de gérer l’ensemble des émotions qui affluent en lui du fait de l’incomplétude de ses réseaux neuronaux.
L’apprentissage du langage et du vocabulaire des émotions aura alors sur l’enfant un impact sur son comportement social, et notamment sa capacité à surmonter le stress, à gérer son agressivité et à exprimer ses affects. Voir cet article : 7 étapes pour apprendre à (re)connaître ses émotions.

La pleine conscience peut aider les enfants en ce sens. Je vous propose de découvrir 3 exercices de méditation de pleine conscience pour apprendre aux enfants à retrouver leur calme : 3 exercices pour apprendre aux enfants à retrouver leur calme.
Des livres pour enfants pour aborder le thème de la colère dans les moments calmes
Retrouvez ma sélection de livres qui peuvent servir de médiateurs pour parler de la colère avec les enfants :
Et à l’extérieur ?
Il est toujours difficile de gérer des crises d’opposition à l’extérieur de la maison et de surcroît en public. Pourtant, il suffit de peu pour passer d’une grosse scène de pleurs aux rires : l’imagination, le détournement d’attention et les questions sont bénéfiques dans ce cas.
Si votre enfant vous réclame un jouet/ un bonbon… dans un magasin et que vous n’êtes pas disposé à lui accorder, faites glisser subtilement la discussion sur un autre terrain. Par exemple, si votre fille veut que vous achetiez une poupée au magasin (c’est du vécu !),
- demandez-lui ce qui lui plait dans cette poupée,
- posez-lui des questions sur ce qu’elle vous décrit et donnez votre propre avis,
- dites-lui que ce n’est pas le moment des cadeaux mais qu’en revanche, elle peut garder cette idée dans sa tête pour la mettre sur sa liste de Noël ou d’anniversaire,
- conseillez-lui de bien la regarder pour se souvenir de tous les détails à répéter au Père Noël qui ne devra pas se tromper !
Pour plus d’astuces, je vous invite à (re)lire cet article sur le détournement d’attention au supermarché !

En mesure préventive, Isabelle Fiiliozat conseille dans « J’ai tout essayé » de donner des responsabilités avant les courses (par exemple, chargez votre enfant de choisir et peser les fruits et de trouver le rayon des pâtes). Vous pouvez aussi avertir votre enfant avant de quitter la maison que vous allez en courses mais que vous n’achèterez que ce qui est prévu sur la liste et rien d’autre, il ne devra donc pas exiger de bonbons ou de jouets. Quitte à lui en acheter en d’autres occasions quand vous l’aurez décidé et que cela vous fera plaisir.
Essayez au maximum de vous mettre dans une bulle avec votre enfant pour devenir hermétique aux jugements ou regards en coin des passants. Ça se passe entre votre enfant et vous, pas avec les clients qui se trouvent par hasard dans le rayon boucherie du supermarché. Ils ne vous connaissent ni vous ni votre enfant, ne savent rien de la journée que vous venez de passer (la fatigue des uns et des autres est un démultiplicateur puissance 1000 des scènes) et encore moins de la raison de cette crise. Vous n’avez pas à vous justifier ni à vous sentir coupable !
Et l’option du câlin est toujours valable dans le cas des colères hors de la maison :-).
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 09:53
article issu de : http://soutienpsy.canalblog.com/archives/2009/09/20/15139426.html
Comment poser des limites à un enfant de 0 à 3 ans?
POSER DES LIMITES, C'EST QUOI ?
- Poser des limites à un enfant, c’est :
- Une autorité exercée dans l’intérêt de l’enfant
- Un acte éducatif, apprendre quelque chose à l’enfant
- Répondre aux besoins de l’enfant et lui permettre d’intégrer des limites pour lui-même
- Participer à son bon développement psychique, et au final à son autonomie- Poser des limites, ce n’est pas :
- Une autorité exercée au profit de l’adulte
- Une relation de pouvoir, une question de soumissionIl n’existe pas de recettes miracles, mais seulement des enfants qui réagissent différemment en fonction de leur personnalité propre et de leur niveau de développement.
LES LIMITES, POUR QUI ?
Souvent, on pose des limites aux enfants en fonction de ses propres limites de tolérance (par rapport au bruit, au refus de finir son assiette, au refus de s’endormir, ...etc), et non en fonction de l'intérêt de leur développement. Quelques conseils :
- Se poser les bonnes questions
Il n’existe pas de réponse toute faite : il s’agit de s’adapter à chaque situation, en fonction du niveau de développement et de la personnalité de l’enfant, en se posant les bonnes questions :
- Pourquoi je pose des limites ?
Suis-je en mesure de l’expliquer à l’enfant afin de lui apprendre quelque chose ? Cela représente-il un intérêt pour le développement de l’enfant ?
- Comment je pose des limites?- Réfléchir à son rapport personnel aux limites
Outre les différences culturelles, chacun a un rapport personnel aux limites, chacun a reçu une éducation particulière. Etre dans la position de mettre des limites à un enfant nous renvoie à celles que nous avons reçu nous-mêmes. Certains répètent le mode éducatif de leurs parents, d'autres peuvent adopter une attitude complètement opposée.
Il apparaît donc important de prendre conscience de la manière dont on a vécu l’autorité dans l'enfance. Il s'agirait de se demander ce qu'on reproduit, ce qu'on ne reproduit pas, et pourquoi.
Ai-je reçu une éducation stricte, laxiste ? Comment ai-je vécu les limites imposées par mes parents dans mon enfance ? Comment cela influe-t-il sur ma manière de poser des limites aux enfants ? Suis-je en train de reproduire certains comportements de mes parents? Ai-je véritablement envie de reproduire ces comportements ou ai-je l'impression que cela dépasse ma volonté?
Autant de questions à se poser pour se "libérer" de l'influence de votre propre enfance sur votre comportement actuel à l'égard de vos enfants.
POSER DES LIMITES, POURQUOI ?
Poser des limites, pour…
- Favoriser l'autonomie
En cherchant des limites à l’extérieur, l’enfant témoigne de sa volonté d’apprendre à se contrôler, d'intégrer des limites pour lui-même. Il sollicite ainsi l'intervention de l'adulte pour lui donner des limites extérieures, qu’il intériorisera peu à peu. En posant des limites à un enfant, l'adulte favorise son autonomie.
L'enfant répètera le comportement jusqu’à ce qu’il ait intégré les limites. Cela prend du temps, et demande de la patience à l’adulte, pour réitérer les explications.- Contribuer à la sécurité psychique
Les jeunes enfants ont besoin de trouver des limites à l’extérieur, surtout lorsqu’ils se sentent en insécurité.
Ils ont besoin de s’assurer de la solidité des adultes, de tester leurs limites. En cherchant à dépasser les limites, l'enfant vous demande : "Es-tu assez fort, assez solide pour que je puisse compter sur toi?".
Si les adultes réagissent sereinement en posant des limites dans l’intérêt de l’enfant, en lui expliquant pourquoi, alors les enfants se sentiront rassurés, en confiance.Certains enfants particulièrement anxieux (insécurité) peuvent répéter ces comportements longtemps, manifestant ainsi un besoin de réassurance constant.
Si l’adulte perd le contrôle de lui-même (cris, violence physique), alors il apparaît moins solide à l’enfant. Celui-ci risquera alors de renforcer son comportement, son sentiment d’insécurité persistera.- Instaurer des repères
L’enfant doit apprendre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, cela lui donne des repères pour se construire et apprendre à vivre avec les autres.
- Apprendre à tolérer la frustration
Il est primordial de mettre des limites aux désirs de toute-puissance des enfants. Il faut leur apprendre à tolérer la frustration.
Si on dit "oui" à tout, on risque d'en faire des « enfants-rois » qui ne connaissent alors aucune limite à leurs désirs et ne tolèrent aucune frustration. Cela peut entraîner de lourdes conséquences sur leur bien-être psychique ainsi que sur leur relations sociales futures.- Apprendre à vivre en société
L’enfant doit intégrer les limites pour intégrer les règles de vie sociale, et pouvoir vivre en société. Donner des limites à un enfant, c'est aussi lui apprendre à se socialiser et vivre avec les autres.
POSER DES LIMITES EN FONCTION DE L'AGE DE L'ENFANT
L’enfant doit franchir 3 étapes, avec l’aide de l’adulte, pour parvenir à intégrer les limites
- Expérimentation des limites par l’exploration (première année)
L’enfant explore le monde qui l’entoure et se confronte aux limites de l’adulte. Il est très important de laisser les enfants explorer leur environnement pour qu’ils puissent se développer.
Au départ, l’enfant ne comprend pas les limites, n'en a aucune conscience. Il répètera le comportement "interdit" par l'adulte jusqu'à ce qu'il comprenne et intègre les limites à l'intérieur de lui-même. Il s'agira alors d'expliquer à chaque fois à l'enfant pourquoi on pose des limites.
De plus, l’enfant expérimente un certain pouvoir sur l’adulte : celui de le faire réagir. Il peut alors répéter son comportement pour attirer l'attention de l'adulte sur lui.Souvent, on observe que l’enfant regarde l’adulte avant de franchir un interdit : il témoigne qu’il a conscience de l’interdit mais surtout qu’il a besoin de limites. Il faut bien prendre conscience que l’enfant ne sait pas se limiter lui-même, il ne contrôle pas ses pulsions : il a besoin de l’adulte qui lui pose des limites pour apprendre petit à petit à se limiter lui-même.
Quelques Conseils :
- Supprimer ce qui est dangereux de son environnement, ne pas donner l’occasion à l’enfant de se confronter à un interdit si on peut l’éviter. Il doit avant tout pouvoir explorer le monde et apprendre par son expérience.
- Poser des limites pour les choses importantes, pour qu’elles aient du poids. Si on pose des limites à tout, les limites perdent leur sens pour l’enfant.
- Se mettre d’accord sur les « choses importantes » en équipe.- Recherche active de limites pour comprendre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas (à partir 2ème année)
Poser des limites devient très important dans la 2ème année. L’enfant cherche à explorer ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Cela est une étape nécessaire, une phase d’apprentissage.
Le fait qu’un enfant devienne volontaire et opposant fait partie du développement normal. C’est une étape fondamentale pour son autonomie psychique, il apprend à s’opposer à l’adulte et aux autres, à dire « non » : il affirme son autonomie.
Cette phase est assez éprouvante pour les adultes qui s’occupent de l’enfant, mais tellement nécessaire pour son bon développement. Un enfant qui ne s’oppose jamais entre 2 et 3 ans doit, au contraire, poser question.- Intégration des limites : c’est l’objectif final !
COMMENT POSER DES LIMITES ?
Comment poser des limites tout en laissant à l’enfant la possibilité à l’enfant de s’exprimer, d’explorer son environnement, de se développer ?
L’enfant a besoin d’explorer les limites et la tolérance avec les différents adultes qui l’entourent. Il se comporte différemment avec chaque adulte.
- Principes
- S’adapter au niveau de développement de l’enfant (cf partie précédente)
- S’adapter aux personnalités et sensibilités individuelles de chaque enfant.
Les enfants se distinguent entre autres par leur "niveau d'agressivité". L’agressivité, à comprendre dans le sens « d’activité », est essentielle dans la vie. Elle permet à l’enfant de dire non, de s’affirmer, de se séparer, de devenir autonome…
Il peut être souhaitable de soutenir « l’agressivité » parfois (dans les jeux par exemples, mais pas envers les autres!), lorsque l'enfant en semblent dépourvu (trop passif, trop sage, triste…).
Tenir fermement l’autorité face à un enfant qui franchit sans cesse les interdits est important, à partir du moment où il en a conscience (à partir de la 2ème année)! L'enfant nous montre ainsi qu’il a besoin de limites, qu’il a besoin de tester la solidité des adultes pour savoir s’il peut avoir confiance en eux.- Savoir pourquoi on dit "non" à un enfant, afin de poser des limites de manière cohérente et d'être en mesure de lui expliquer avec un langage adapté.
- Conseils sur l'attitude à tenir
- Attitude calme mais ferme, être déterminé (donc convaincu de l’utilité de poser des limites).
- Intervenir immédiatement après le comportement, s’approcher de l’enfant, se mettre à sa hauteur et expliquer pourquoi on ne peut pas faire ça.
- Témoigner son affection quand tout est terminé, pour signifier à l'enfant que lui poser des limites n'est pas une preuve de désamour à son égard.
- Réserver l’autorité pour les choses importantes. Quand on dit trop souvent « non », et parfois sans réellement savoir pourquoi, les règles deviennent inefficaces.
- Adopter des règles communes et partagées par les parents ou adultes charge de l'enfant. L'enfant doit pouvoir recevoir un message clair et cohérent des différents adultes qui l'éduquent, afin de trouver des repères stables et intégrer des limites claires pour lui-même.
RISQUES ET ECUEILS- Perdre son sang froid (violences verbales, phsyiques)
Il est difficile de poser des limites, surtout lorsqu’il s’agit de répéter d’innombrables fois la même chose à un enfant pour qu’il puisse les intégrer pour lui-même.
Il peut arriver de perdre son sang froid parce qu’on est fatigué, parce qu'on se sent impuissant, parce qu’on est humain.Lorsqu’on perd son sang froid, on dépasse ses propres limites : on n'est plus en mesure de poser des limites de manière constructive pour le bon développement de l’enfant.
- Le simple fait de crier fort (différent de hausser le ton avec fermeté) est signe que nos limites sont dépassées : l’enfant comprend alors que l’adulte a perdu son sang froid, il comprend que l’adulte croit en « l’agression » pour résoudre les conflits, il comprend qu’il a réussi à atteindre l’adulte qui n’est pas si solide que cela.
L’enfant ne comprendra pas les explications si elles sont criées ou accompagnées de gestes violents. Au « mieux », il arrêtera par peur. Et il ne recommencera pas par peur.- Dire « tu es méchant ». Non, un enfant n’est pas méchant. Par contre, il a eu un « mauvais comportement ». C’est l’acte qui est répréhensible, pas l’individu qui le commet.
Un enfant qui s’entend dire qu’il est méchant risque bien de le devenir réellement et de rester fixer dans cette phase d’opposition. Un jeune enfant se construit, entre autres, à travers le regard que l’adulte lui porte.- Tirer violemment un enfant par le bras…etc.
Le châtiment corporel signifie pour l’enfant qu’on perd notre sang-froid et qu’on croit au pouvoir de l’agression physique pour résoudre les conflits. S’ils ces gestes violents sont répétés, l’enfant risquera de répéter ces comportements lors de situations conflictuelles avec d’autres: il répétera l’agression sur d’autres pour avoir le pouvoir.- Ne pas oser, être hésitant
L’enfant répètera son comportement si l'adulte est hésitant, il aura même tendance à l'intensifier pour faire réagir l’adulte, lui témoignant ainsi son besoin de limites.
Il est important de se demander pourquoi on est hésitant dans la manière de poser des limites : peut-être n’y a-t-il pas de bonne raison à poser des limites, peut-être se sent-on « mauvais » ou « coupable ».
Dans ce dernier cas, il faut bien se rappeler que poser des limites est un acte de bienveillance, dans l'intérêt de l'enfant. A l’inverse, ne pas poser des limites à un enfant en plein développement qui en a besoin, pourrait être considéré comme un acte de négligence.
- Baisser les bras devant un enfant opposant
Cette attitude survient souvent lorsqu’on se sent fatigué de répéter toujours la même chose, avec l’impression que l’enfant n’entend rien. Certains enfants ont tellement peu de sécurité interne qu’ils cherchent les limites sans cesse. Les limites rassurent l'enfant.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 09:44
article issu de : http://rased-en-lutte.net/2009/12/albert-ciccone-les-enfants-qui-poussent-a-bout/
Albert Ciccone : les enfants qui poussent à bout

Intervention
Merci de votre invitation, même si vous venez de briser une illusion : je pensais que c’était pour moi que les gens s’étaient déplacés, mais c’est pour le thème. Je suis impressionné par la foule !
Pour me présenter, je vais juste dire que je suis psychologue, psychanalyste, professeur à Lyon II. J’ai beaucoup travaillé sur le lien tyrannique. Cela fait un certain nombre d’années que je m’intéresse à la question du lien tyrannique, aux logiques, au développement, à la genèse, aux liens tyranniques de cette relation particulière à l’objet et cela à partir d’une clinique importante d’enfants tyrans que j’appelle les enfants qui poussent à bout. C’est la thématique qui vous a été annoncée. Les enfants qui poussent à bout : quelle réponse à l’école ?
Je suis un peu ennuyé parce que, d’une part, je ne suis pas l’École, je ne travaille pas à l’école et je me garderai bien de donner des conseils sur les réponses apportées à l’école. De plus, je ne suis pas pédagogue, je suis psychologue. C’est bien connu, les psychologues ne donnent pas de réponses, ils posent des questions ». Vous connaissez la célèbre formule : « la réponse, c’est le malheur de la question. Je vous laisserai trouver vos propres réponses. Je vais tout de même vous donner quelques indications qui vous permettront, je l’espère, de commencer à élaborer un certain nombre de réponses.
Je me suis intéressé aux liens tyranniques ; à vrai dire, je suis passé à autre chose ces derniers temps et, comme on m’invite toujours sur cette question-là – de façon tyrannique ! –, je suis obligé d’y revenir.
Cela dit, il n’est pas mal de revenir, avec un peu de distance, sur un objet de recherche que l’on a un peu laissé. Cela permet de voir les choses autrement, de proposer d’autres hypothèses. Si j’avais lâché l’objet de recherche quelque temps, je n’ai bien sûr pas lâché la clinique ; je suis toujours fortement sollicité pour ce type de situation, même si, comme j’ai assez de travail, j’ai tendance à orienter de plus en plus ces enfants et ces familles vers des collègues, de préférence vers mes ennemis. C’est bien connu, ce sont des enfants particulièrement insupportables !
Je me suis donc demandé d’où vient la tyrannie, comment fabrique-t-on un tyran ou comment se fabrique un enfant tyran ?
Je vais faire une rapide description pour dégager quelques caractéristiques communes chez ces enfants. On peut d’abord dire que l’enfant tyran est un enfant roi. C’est un enfant roi, comme le dit l’expression populaire courante, mais c’est aussi un enfant roi selon la conception du tyran dans la Grèce antique. Vous savez que le tyran dans la Grèce est un roi. C’est un roi illégitime puisqu’il est élu par le peuple. Il n’est pas de descendance royale : il usurpe donc le pouvoir et il l’exerce en maître absolu et tout-puissant. L’enfant tyran est un roi illégitime, puisqu’il règne de sa place d’enfant, frauduleusement adulte, et il règne en maître absolu et tout-puissant. L’enfant tyran est donc plus qu’un roi.
Ces enfants tyranniques à partir desquels j’ai élaboré quelques réflexions que je vais vous livrer, je les désigne comme des enfants qui poussent à bout. Je reprends l’expression qui est fréquemment employée par les parents, qui se plaignent de la tyrannie qu’ils subissent, ou qu’ils imaginent subir, de la part de leurs enfants : « Ils me poussent à bout, je n’en peux plus Docteur, faites quelque chose ! »
Les situations, auxquelles je me réfère, concernent de jeunes enfants, des situations différentes qu’il faudrait appréhender dans leur singularité. Je vais essayer de dégager quelques enjeux suffisamment communs qui concerneront ces enfants mais aussi des enfants très jeunes, des bébés, voire des enfants plus âgés, des adolescents. On verra comment les logiques peuvent se retrouver à tous les âges de la vie de l’enfant.
Je ne vais pas m’attarder sur la description de ces enfants. Vous les connaissez, vous en avez certainement plein autour de vous, dans vos pratiques, dans vos familles. Je vais juste souligner quelques caractéristiques communes. Il s’agit toujours d’enfants instables, agités, qui prennent des crises de rage à la moindre contrariété, à la moindre frustration. Ils sont parfois violents, ils frappent les autres enfants à l’école, souvent les plus petits. « Il pourrait tuer un enfant », disait une mère de son fils. Ils sont toujours provocateurs. Les provocations sont diverses. Par exemple, lors d’une consultation, un enfant demande un bonbon. Sa mère dit : « Non, ce n’est pas le moment de manger des bonbons ». L’enfant se sert dans son sac pendant que la mère m’explique la situation. Il prend un bonbon ; il le mange ; il crache les morceaux sur mon bureau ; ensuite, il les écrase avec jouissance.
Autre exemple : toujours dans une consultation, un enfant prend des feutres et les casse. Je lui dis : « Tu pourrais dessiner ! » Il dessine ; il déborde ; il dessine sur le bureau. Je luis dis : « Tu pourrais dessiner sur la feuille ! » Il commence à dessiner de façon très agressive, violente. Je lui dis : « Tu pourrais dessiner un bonhomme ! » Il dessine un bonhomme : la tête, le nez, la bouche, les yeux, en me regardant, en transperçant la feuille. On assiste à tout un tas de provocations. Ces enfants présentent souvent, à l’observation, des interactions particulières avec leurs parents. Par exemple, après une provocation, ils vont venir chercher le contact. Ils vont se lover sur les genoux de leur mère, sucer leur pouce, s’entourer des bras maternels.
Un enfant venait, par exemple, se lover dans les bras maternels et, en plus, appuyer sa tête contre la tête de la mère, comme s’il voulait entrer à l’intérieur de la tête maternelle après avoir mis en colère sa mère. Ils viennent chercher le contact après la provocation. Ils peuvent aussi souvent refuser le contact, surtout si celui est demandé par l’autre, par le parent, par l’adulte. Ils refusent les câlins, ce dont se plaignent souvent les parents déçus. « Ça le brûle », disait une mère. « Ça le brûle quand on veut lui faire un câlin ». Il dit : « J’ai chaud ; pousse-toi ! »
Le lien qui unit l’enfant à ses parents est quasiment toujours plus ou moins incestuel. C’est un lien incestuel. L’enfant est possessif : il veut la mère pour lui tout seul. Les rivalités fraternelles sont souvent terribles. L’enfant exclut souvent le père qui, d’ailleurs, s’exclut lui-même, tout seul, avec la complicité de la mère. Par exemple, les troubles du sommeil sont fréquents, justifiant que l’enfant dorme avec la mère avec, parfois, un lien particulièrement sexualisé.
Autre exemple : une mère est déçue par son fils ; elle voulait une fille pour réparer le manque d’une mère aimante, qu’elle n’a pas eue. L’enfant développe un comportement tyrannique, avec un lien très érotisé à la mère. Un jour, alors que l’enfant a quatre ans, la mère dit : « Il veut un bébé, il veut une fille ». Elle explique sans pudeur que, lorsqu’il entend un rapport sexuel, même si on fait attention, il frappe à la porte et dit : « Cela ne sert à rien, s’il n’y a pas de bébé ». À un moment, la mère présente une aménorrhée pendant trois mois et « l’enfant en est très heureux », dit-elle. Malheureusement, elle n’était pas enceinte. L’enfant était très en colère contre son père qu’il a insulté : « Tu es nul, tu n’es même pas capable de lui faire une fille », a-t-il dit à son père (à quatre ans). La relation est incestuelle, voire incestueuse, entre ces enfants et leurs parents. Ces enfants poussent à bout, selon l’expression fréquemment employée par les parents, c’est-à-dire qu’ils poussent les parents à des actes extrêmes :
– Frapper, utiliser la violence : « Arrête, je vais te tuer », disait un père.
– Partir : le parent parfois s’en va. Le père, ne supportant plus la tension des foyers, avait pris un travail très loin, ne rentrant plus qu’un week-end sur deux, voire une fois par mois.
– Rejeter l’enfant : une mère, par exemple, mit ses deux enfants dehors la nuit avec un sac à dos avec plein de nourriture tellement elle n’en pouvait plus. L’un lui a dit : « Je vous aime, j’ai besoin de vous, je veux rester » et l’autre s’est simplement demandé comment il allait faire pour voir la nuit dans le noir. Il ne dit jamais : « Je vous aime », dit la mère, « cela lui arrache le cœur ». Quand il le dit, c’est dans un cri d’arrachement. On voit bien sûr que les problèmes avec l’autorité seront majeurs chez ces enfants.
Autre caractéristique : dans le milieu familial, on observe souvent des épisodes dépressifs dans l’histoire. Le contexte familial est souvent un contexte dépressif, ou qui était dépressif dans la petite enfance, avec des déménagements, des séparations, des deuils. Un père, par exemple, était parti à la naissance de l’enfant, laissant la mère seule avec trois enfants. Elle fait une dépression importante. Elle se décrit comme un robot pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant. L’enfant développe une anorexie du nourrisson. La mère a vite réagi, se ranime, sort de son état dépressif quand l’enfant a six mois et l’enfant se développe. La relation avec cette mère était d’une grande proximité : la mère, en effet, se sentait coupable d’avoir abandonné le bébé pendant six mois, de ne pas être là, de n’être qu’un robot ; elle soignait aussi sa dépression avec son bébé en le surinvestissant. Deux ans plus tard, la mère perd son propre père et ce deuil est particulièrement dramatique.
Autre exemple : la naissance d’un enfant est très décevante parce que la mère attendait une fille, ce qui lui avait été annoncé dans les différentes échographies. Arrive un garçon, rouquin aux yeux bleus, alors qu’« elle a horreur des rouquins », dit-elle. Elle a d’ailleurs pensé que ce n’était pas son fils et qu’on s’était trompé de bébé à la maternité. Elle a fait une dépression ; elle a été anorexique ; elle est d’ailleurs toujours déprimée. « J’ai besoin que l’on s’occupe de moi ; j’ai besoin que l’on me dise tout le temps, tous les jours, que l’on m’aime », disait cette mère et c’est cette demande qu’elle adressait à son enfant à laquelle, évidemment, celui-ci ne pouvait pas répondre. On pourrait donner beaucoup d’exemples comme ceux-ci.
On peut dire d’un tel enfant, tyrannique, qui pousse à bout, qu’il est à la fois un grand enfant omnipotent et un gros bébé immature : il est les deux en même temps. Lorsqu’il est le tyran qui impose sa loi, il fait taire le bébé. Il écrase le bébé en détresse, comme il tape souvent les petits à l’école qui représentent sa propre partie « bébé », sa propre partie « bébé dépendant » dont il essaie de se défaire pour être un grand, fort, tout-puissant qui contrôle le monde. On peut dire qu’un tel enfant va souvent développer une sensibilité aiguë à l’égard de l’humeur parentale, de l’humeur maternelle. Il s’oppose de manière tyrannique pour faire réagir la mère, pour ne pas qu’elle déprime. Par son comportement, l’enfant fait exister une mère, à l’intérieur de laquelle il peut entrer, comme cet enfant qui voulait entrer dans la tête de la mère ; une mère qui peut le contenir, une mère qui peut l’accueillir. On peut dire qu’il cherche à créer la mère qu’il a perdue, dont il a manqué, parce qu’elle était elle-même abandonnée, déprimée. Il cherche à vérifier que sa mère est bien là, qu’elle est bien vivante afin qu’elle puisse rester vivante à l’intérieur de lui.
On peut comprendre aussi la difficulté du parent pour mettre des limites à l’enfant, comme inhérente au fait qu’il projette en lui son propre sentiment d’abandon. Le parent ne peut pas mettre des limites parce qu’il se sent coupable. Ces limites imposent un sentiment de frustration, imaginé par lui comme l’équivalent d’un abandon qui, effectivement, le frustre. « Si je lui dis non, je le frustre, je l’abandonne : il va se sentir abandonné ».
Souvent le parent ne supporte pas que l’enfant pleure. On peut dire, par ailleurs, que le parent cherche à se consoler de son expérience de manque avec son enfant, lui demandant, en quelque sorte, d’être une mère pour lui : « Sois une mère pour moi. Fais-moi vivre un bon sentiment gratifiant, consolateur. Fais-moi dire que je suis un bon parent d’un bon enfant ». Le parent est alors en contact avec un enfant imaginaire et cela ne peut que laisser l’enfant réel abandonné à ses propres besoins infantiles de consolation, devant toute épreuve de manque et de frustration.
Le parent ne peut pas donner une limite qu’il contient parce qu’il demande à l’enfant d’être un parent qui ne pleure pas devant la frustration et qui l’aide, lui, « parent-enfant », à ne pas pleurer devant sa propre détresse. L’enfant va alors se développer dans l’omnipotence et dans l’exigence tyrannique. On voit ainsi comment le besoin narcissique de l’enfant va rencontrer le propre besoin narcissique parental, le parent étant lui-même un bébé qui a besoin d’être consolé, aimé, rassuré, comme cette mère qui disait : « Dis-moi que tu m’aimes. Il faut toujours que l’on me dise que l’on m’aime ».
Ces besoins narcissiques partagés entre le parent et l’enfant vont infiltrer des conflictualités plus œdipiennes. Celles-ci aussi, celles du parent comme celles de l’enfant, étant entremêlées, se télescoperont et cela va produire une atmosphère fortement incestuelle, voire incestueuse, avec une faillite de la fonction paternelle. L’enfant est souvent soumis à l’excitation parentale qui le chauffe, qui le brûle, comme cette mère qui disait à son enfant, à chaque fois qu’elle voulait lui faire un câlin : « J’ai chaud, pousse-toi ! » Le câlin chauffe, brûle ; l’excitation brûle et l’enfant réagit, pourrait-on dire, à la séduction parentale incestuelle.
Je vais maintenant essayer de dégager quelques modèles afin de comprendre quels sont les enjeux de ces liens tyranniques développés par un enfant.
Une première série d’hypothèses concerne la quête de l’objet, la quête de l’autre : l’enfant est confronté à la nécessité de retrouver un objet perdu, au sens psychanalytique du terme : c’est un objet d’investissement et d’attachement. On dit souvent, à propos des enfants qui poussent à bout, que l’enfant cherche la limite : il teste la limite. On peut dire en fait que l’enfant qui pousse à bout cherche à savoir ce qu’il y a au bout. Il n’est pas sûr de ce qu’il y a au bout. Il n’est pas sûr de trouver, au bout du compte, une mère vivante, tendre, aimante. Tout semble se passer comme si l’enfant n’était pas convaincu, qu’au bout du compte, l’adulte tienne vraiment à lui, l’investisse vraiment. L’adulte, bien sûr, peut être lui-même convaincu de son intérêt, de son attachement, de son amour, de son investissement pour l’enfant, mais l’enfant, lui, n’est pas convaincu. Tout le problème posé sera celui des conditions à partir desquelles l’enfant pourra acquérir une conviction suffisante pour pouvoir renoncer à son comportement perturbateur, tyrannique, violent.
Pour comprendre une telle situation et son aspect fondamentalement paradoxal, on peut évoquer une notion que vous connaissez peut-être, la notion de tendance antisociale, développée par Winnicott. Si vous ne la connaissez pas, il faut absolument lire ce texte de Winnicott qui date de 1956 : « la tendance antisociale ».
Qu’est-ce que la tendance antisociale ? Elle recouvre un ensemble de comportements qui va de la mauvaise conduite ordinaire des enfants jusqu’à la délinquance, la criminalité. Winnicott explique cette tendance antisociale par la perte qu’a subie le sujet enfant, perte de quelque chose de bon, perte d’une bonne relation, quelque chose qui a été positif jusqu’à une certaine date, et qui a été retiré à l’enfant, ce retrait ayant dépassé la durée pendant laquelle l’enfant peut en garder le souvenir vivant. La perte de cet objet, de cette expérience, fait vivre à l’enfant l’expérience selon laquelle c’est lui, c’est sa destructivité qui a détruit l’objet. L’objet, l’autre, n’a pas survécu à la destructivité du sujet. Cela conduit au déploiement de ce qu’on appelle le paradoxe de la destructivité : le sujet va répéter la destruction. Il va répéter la destruction non pas pour détruire, mais il va la répéter pour vérifier que l’objet peut survivre. Autrement dit, la tendance antisociale est l’expression d’un espoir, paradoxalement, espoir de trouver un objet qui, enfin, va résister à la destructivité. L’objet survit lorsqu’il peut tolérer les nombreuses mises à l’épreuve, les répétitions nécessaires pour que le sujet puisse acquérir la conviction de la résistance de l’objet.
Que veut dire tolérer ? Tolérer ne veut pas dire laisser faire, tolérer signifie ne pas laisser tomber ; ce n’est pas la même chose ! Lorsque l’objet se retire, qu’il laisse tomber ou bien lorsqu’il est trop blessé, trop anéanti, trop effondré, ou bien encore lorsqu’il exerce une rétorsion, il confirme la destruction. « J’ai bien raison de penser que je t’ai détruit puisque tu exerces une rétorsion, puisque tu me laisses tomber, puisque tu es complètement effondré, anéanti ». Chaque fois que l’objet se retire, qu’il est trop blessé, qu’il exerce une rétorsion, il confirme la destruction. Il pousse l’enfant à répéter la destruction pour vérifier qu’un jour, cela va résister.
Si l’objet résiste, si l’environnement résiste suffisamment à la destructibilité du comportement antisocial, alors il pourra avoir accès au désespoir. Derrière cette quête incessante de l’objet, cette quête sous-tendue dans l’espoir de le retrouver vivant et entier, espoir qui est souvent répétitivement déçu, on va effectivement laisser tomber. On va dire : « Ce n’est pas pour nous ; je n’en veux plus ; c’est pour quelqu’un d’autre. Il faut le placer, il faut le changer d’institution, d’école ; il faut le mettre ailleurs ; il faut le changer de famille ». Répétitivement, l’enfant fait l’expérience qu’il a bien détruit l’environnement mais, derrière cette quête de l’objet qui est sous-tendue par l’espoir de le retrouver vivant, il y a toujours un profond noyau de désespoir. On peut dire que, par le maintien et l’entretien d’une relation d’objet tyrannique, le sujet se défend d’une expérience de désespoir parce que c’est un désespoir traumatique, agonistique. Rappelons-nous ce bébé qui n’a affaire qu’à une mère robot et qui se laisse aller dans l’anorexie, c’est-à-dire dans la mort, dans le désespoir absolu.
Si l’enfant met à l’épreuve, par la répétition, la résistance de l’environnement, de l’objet, on peut dire que la répétition lui permet aussi de mettre en scène une tentative de réanimation de l’objet. En effet, de nombreux enfants poussent leurs parents à bout pour venir eux-mêmes ensuite se faire consoler, câliner, ou bien pour consoler l’objet, pour consoler la mère : l’enfant va essayer de faire exister un parent consolateur chez le parent ou chez lui-même. Il va essayer de faire exister une scène consolatrice.
On peut aller un peu plus loin dans cette direction en faisant appel non pas à la tendance antisociale, mais à la notion de contrat masochiste. Il y a bien quelque chose du masochisme dans ces liens. On sait que dans le scénario masochiste, au sens sexuel du terme, au sens de Sacher-Masoch, le sujet doit être traité comme un enfant méchant, par une maîtresse-bourreau qui a le droit de vie et de mort sur lui. Le masochiste est le véritable maître de la situation, ce n’est pas le bourreau : il fabrique lui-même son bourreau. Gilles Deleuze, un philosophe lyonnais, qui avait étudié en détail le scénario et la mise en scène du comportement sexuel masochiste, avait mis en évidence la manière dont le masochiste va fabriquer son bourreau, l’éduquer, le dresser, le former et l’entraîner à une place suprême de détenteur de la loi absolue puisque la femme-bourreau a le droit de vie et de mort sur lui. Cette imago maternelle du masochiste, telle que l’a décrite Deleuze, est un point tout à fait intéressant pour nous. « Cette imago maternelle du masochiste est une imago froide », dit-il, « à la sentimentalité congelée et cruelle ». La femme idéale du masochiste est une femme à la fois froide, maternelle et sévère, une femme glacée, sentimentale et cruelle. « Ce froid est une sentimentalité supra sensuelle congelée », dit-il, « protégée par la fourrure », souvent présente dans les fantasmes masochistes, comme si la fourrure, le cuir, protégeaient cette sentimentalité supra sensuelle congelée. Si on considère l’aspect sexuel dans le masochisme comme une simple version, un contexte particulier du masochisme, on peut relier ces comportements masochistes avec des vues primaires de détresse et on peut dire que le masochiste cherche aussi, derrière ce bourreau froid et cruel qui a le droit de vie et de mort sur lui, la mère dont la sentimentalité a été congelée, a été perdue. Tout se passe comme si l’enfant, confronté à une telle imago, une telle image de la mère – cruellement indifférente comme la mère robot –, était condamné à organiser un scénario qui allait tenter d’offrir un démenti à cette expérience originaire de détresse, à cette expérience d’agonie primaire, à cette expérience de meurtre accompli dans et par l’indifférence.
Le masochiste se met dans une situation extrême, dans une position où l’autre a le droit de vie et de mort et cela pour faire l’expérience que l’autre n’a pas de désir meurtrier à son égard, sinon il n’est pas sûr. En même temps qu’il fait l’expérience du démenti de sa propre annihilation dans le désir de l’autre, le masochiste fait aussi l’expérience du démenti de sa propre destruction de l’objet. On retrouve la tendance antisociale. En effet, on peut penser que l’indifférence de cette mère froide est vécue par l’enfant comme une non-résistance de la mère à la destructivité de l’enfant. Si la mère est froide et indifférente, c’est parce que je l’ai détruite. Si je mets ma vie entre ses mains et qu’elle ne me tue pas, je fais l’expérience, d’une part, que je ne l’ai pas détruite, d’autre part, qu’elle n’a pas de désir meurtrier à mon égard. Je suis obligé de mettre ma vie en jeu pour être sûr et convaincu qu’il n’y a pas de désir de mort derrière cette indifférence froide.
On voit comment le contrat masochiste peut aider à comprendre de nombreux contrats implicites qui sont du même type, mais sans la composante sexuelle, sans le recours aux comportements sexuels. Ils concernent les liens tyranniques, en particulier les liens entre un parent et un enfant. Par exemple, une mère souffre du comportement tyrannique de sa fille qui la provoque sans cesse, l’épuise, la pousse à bout, jusqu’à se faire battre, répétitivement. Cette mère a un comportement violent, sadique avec sa fille, à qui elle impose des exigences éducatives très rigides et cruelles. Cette mère a souffert d’un manque affectif de la part de sa propre mère, décédée, dont elle n’a pas pu faire le deuil. Cette mère n’a jamais d’expression de tendresse envers son enfant. « Elle ne sait pas faire, elle ne peut pas le faire », dit-elle. Exprimer la tendresse, dire à son enfant qu’elle l’aime, c’est pour cette mère prendre contact avec son propre manque, avec l’expérience interne que l’amour d’une mère peut manquer, ce qui est trop douloureux et trop insupportable pour elle. Ce que demande la mère à l’enfant, c’est : « Ne me montre pas que ma mère me manque. Ne sois pas en demande d’amour envers moi ». Cela est donc une exigence qui va écraser la personnalité de l’enfant, qui va produire chez lui un sentiment persécutoire, coupable, d’être foncièrement mauvais, de ne pouvoir créer qu’une mère hostile ou indifférente. Aussi, lorsque l’enfant provoque, lorsqu’il se fait battre, il pousse sa mère jusqu’au bout, parce qu’il ne sait pas ce qu’il y a au bout. Derrière cette attitude froide, exigeante, indifférente de la mère, y a-t-il une sentimentalité congelée, comme chez le bourreau du masochiste ? L’enfant n’a pas suffisamment fait l’expérience qu’au fond de la mère, il n’y a pas de la haine à son égard. Il pousse à bout pour se convaincre de l’absence de désir de mort pour faire l’expérience qu’au bout du compte, le parent ne va pas le tuer. On peut dire que l’enfant qui pousse à bout cherche, par son comportement tyrannique, omnipotent, à retrouver l’objet aimé, la mère aimante et consolatrice qu’il a perdue, pour échapper à un éprouvé de détresse catastrophique.
Donald Meltzer, un psychanalyste anglais, qui avait écrit un texte fondateur quant à l’approche psychanalytique de la tyrannie, datant de 1968 et qui s’appelle « La tyrannie », avait développé l’idée de la tyrannie comme défense contre la terreur inconsciente et contre les angoisses dépressives. Meltzer décrivait la manière de se soumettre à la tyrannie dans le monde externe, comme dans le monde interne. Le tyran est lui-même soumis à un tyran à l’intérieur de lui ; l’enfant tyran est soumis à un tyran interne. Se soumettre à un tyran dans une relation inter subjective ou se soumettre à un tyran à l’intérieur de soi, c’est une manière de se soumettre à un objet. Cette soumission prend la place d’une relation de dépendance. C’est comme cela que se vit la dépendance, lorsque la dépendance envers les objets secourables est impossible. Il n’y a pas de dépendance possible envers un objet secourable : on va se soumettre à un tyran.
La soumission à la tyrannie est une manière d’échapper au fait d’éprouver une terreur, d’échapper au désespoir, mais une telle soumission est elle-même source d’effroi, l’effroi étant ressenti face à la perspective de perdre la protection illusoire contre la terreur, illusion de protection que donne le tyran ou la partie tyrannique omnipotente et omnisciente du sujet. Le tyran fait régner la terreur. Il fait surtout régner l’illusion de protéger contre la terreur. C’est pour cette raison que l’esclave reste, se soumet et qu’il ne part pas : il a l’illusion de la protection et la crainte de perdre cette protection s’il sort de cette relation tyrannique. La tyrannie, que ce soit dans les peuples, dans le social ou que ce soit dans la relation familiale, est toujours une réponse à une situation dépressive, à une angoisse dépressive, à une crainte d’une situation dépressive catastrophique.
Parallèlement à cette quête de l’autre, de l’objet, l’enfant cherche aussi autre chose. Il cherche à soulager la culpabilité qui est issue du sentiment d’avoir lui-même détruit l’objet ou d’avoir lui-même produit la haine. Les parents des enfants qui poussent à bout disent toujours que l’enfant cherche la fessée. L’enfant est content quand il a la fessée parce qu’il cherche à soulager un sentiment inconscient de culpabilité. On est dans la logique masochiste d’un enfant méchant qui va être puni pour sa méchanceté, comme disent Freud et Mélanie Klein à propos de ce qu’ils appellent « le criminel par sentiment de culpabilité ». Un article de Freud, intitulé « Criminel par sentiment de culpabilité », explique que le criminel ne se sent pas coupable parce qu’il a commis un crime ; il commet un crime parce qu’il se sent coupable. La culpabilité est première. Il commet un crime pour apaiser un sentiment inconscient de culpabilité, pour donner une forme, une raison à ce sentiment inconscient de culpabilité. D’ailleurs les parents disent souvent, quand ils donnent la fessée : « Si tu ne savais pas pourquoi tu pleures, maintenant, tu le sais ! » Le sentiment de culpabilité a une forme dans cette expérience.
De la même façon, l’enfant ne se sent pas coupable parce qu’il se fait punir, il se fait punir parce qu’il se sent coupable. La punition apaise la culpabilité et l’expérience de perte de l’objet, de perte de l’autre, confirme son sentiment de culpabilité d’avoir détruit l’objet qu’il aime : « Si maman est indifférente, c’est parce que je l’ai détruite. » Perdre son objet pousse l’enfant à se faire punir par son objet perdu. Nous voyons le cercle infernal dans lequel il se trouve : plus l’enfant perd l’autre, plus il va se faire punir par celui qu’il a perdu. Il se sent responsable de cette perte, il se sent responsable d’avoir détruit l’amour de l’autre, d’avoir détruit l’autre.
Cette quête de l’objet et ce besoin de punition sont, par ailleurs, infiltrés de jouissance. Cela va complexifier le lien. Cette jouissance provient d’abord du sentiment de triomphe sur l’objet que développe le sujet : l’enfant développe un sentiment de triomphe sur le parent. Les parents s’étonnent souvent que leur enfant, qui est très perturbateur en classe, qui se met toujours au centre de l’attention du groupe et des adultes du fait de ses transgressions, de ses actes provocateurs, ne manifeste aucune réaction de culpabilité, de honte, de remords aux punitions qu’il accumule, alors qu’il en comprend la légitimité et est même d’accord avec les sanctions. En effet, si la quête de l’objet perdu et le besoin de punition pour avoir détruit cet objet peuvent conduire à provoquer, à transgresser de façon répétitive, la jouissance immédiate de triompher de l’objet, d’être au centre de l’attention et de l’intérêt, est plus forte que la crainte de perdre à nouveau par la punition. Il ne regrette pas, il n’y a pas à nouveau la crainte de perdre par la punition parce que la jouissance est encore plus forte, il va donc recommencer à transgresser, à se mettre au centre de la scène par ses transgressions et ses provocations.
Cette jouissance provient du triomphe mais concerne aussi tout particulièrement le sentiment de vengeance qu’éprouve le sujet, l’enfant, devant le désarroi de l’objet, de l’adulte, du fait de la tyrannie qu’il lui impose et qui le met à l’épreuve. Une séquence illustre cette idée dans un texte de Kundera où il est question d’un enfant pris dans un lien tyrannique avec son professeur de violon. L’enfant fait des fausses notes, le professeur de violon le réprimande, l’enfant fait à nouveau des fausses notes, le professeur de violon se met en colère, l’enfant fait encore des fausses notes, le professeur devient fou, il prend l’enfant, il le jette par la fenêtre. L’enfant tombe et, pendant sa chute, il se réjouit à l’idée que son professeur va être accusé de meurtre. La jouissance est plus forte que la perte, l’angoisse ou la détresse.
C’était une première série d’hypothèses : la quête de l’objet perdu, le sentiment de culpabilité d’être à l’origine de cette perte de l’objet et la jouissance qui va infiltrer cette quête et entretenir le lien tyrannique.
Deuxième perspective, autre façon de comprendre les enjeux de ces liens, autre modèle qu’on peut proposer : on peut dire que la configuration de l’enfant qui pousse à bout, de l’enfant tyran, est aussi celle un enfant qui résiste devant l’héritage imposé par le parent. Quel est cet héritage imposé par le parent ? Il est constitué par les besoins infantiles du parent, qui n’ont pas été suffisamment reconnus, pris en compte, traités dans l’histoire infantile du parent et dans son histoire actuelle, ou par des besoins infantiles qui ont été particulièrement réveillés, réchauffés à l’occasion d’événements traumatiques. Ces besoins infantiles des parents vont infiltrer le lien à l’enfant, le parent demandant à l’enfant, dans sa mission réparatrice, d’être un parent pour lui : « Sois une mère pour moi, répare l’expérience malheureuse que j’ai eue avec mes propres parents, fais-moi vivre que je suis le bon parent d’un bon enfant. » Le parent demande à l’enfant de réparer son histoire infantile d’échec et de détresse. C’est toujours vrai : nous avons tous, toujours, quelque chose à réparer de notre histoire, nous avons tous des blessures, des fractures et des frustrations que nous allons essayer de réparer dans l’expérience parentale. On fait en sorte que l’enfant ait une meilleure vie, ne vive pas les échecs qu’on a connus, réussisse là où l’on a raté. Cela va réparer ses propres blessures, ses propres fractures et les échecs de sa propre histoire infantile. Si l’on imagine que le fait de devenir parent ne va pas suffire, on devient psychologue, médecin, éducateur, puéricultrice : on va passer sa vie à réparer chez les autres ce qu’on a échoué à réparer chez soi.
Il est évident que la façon dont le parent va présenter la réalité, dont il va énoncer les interdits, poser les limites, sera tributaire du niveau de sa propre demande de réparation de ses expériences infantiles. Autrement dit, plus le parent agira en réponse à l’enfant qu’il a été, et non en réponse aux besoins de l’enfant réel, plus il sera en difficulté devant l’enfant réel et plus il mettra en difficulté l’enfant réel. On verra alors un parent qui ne peut pas mettre de limites ou qui ne met de limites que d’une façon cruelle, en sortant lui-même de ses limites, tellement il en veut à l’enfant de le mettre en difficulté, tellement il lui en veut d’attaquer son sentiment d’être un bon parent, de ne pas lui faire vivre qu’il est un bon parent et de ne pas réparer son expérience infantile d’échec.
L’enfant va hériter de ces besoins narcissiques parentaux. Il va hériter non seulement des besoins infantiles narcissiques du parent, mais aussi des fantasmes construits par le parent à partir de ses expériences traumatiques infantiles. L’enfant va se débattre avec cet héritage.
La problématique de l’enfant tyrannique va alors s’éclairer d’une lumière nouvelle. L’enfant tyran résiste : je ne suis pas celui que tu crois, je ne suis pas ton parent, je ne suis pas là pour réparer tes propres blessures, c’est toi qui est là pour m’aider à grandir. L’enfant tyran résiste à la demande narcissique parentale mais, en même temps qu’il résiste devant cet héritage des besoins infantiles du parent, l’enfant s’inscrit dans un scénario fantasmatique parental. L’enfant s’inscrit dans un fantasme qui appartient au parent, que le parent indique et transmet. En effet, l’histoire des parents, notamment l’histoire de leurs expériences traumatiques, organise des fantasmes qui vont colorer les liens, les relations établies entre les parents, entre les parents et leurs enfants, etc. Ces fantasmes seront transmis à l’enfant à qui on demande inconsciemment d’occuper une place dans le scénario fantasmatique.
On peut facilement observer de tels effets de transmission entre un parent et un jeune enfant, voire un bébé, à l’occasion des interactions précoces, des échanges interactifs. On peut facilement observer, par exemple, la façon dont un parent, qui se plaint d’un comportement d’un enfant, va en même temps induire le comportement qu’il craint, pour satisfaire des exigences fantasmatiques. De telles inductions seront véhiculées en particulier à travers ce qu’on appelle « la communication paradoxale » : un parent demande une chose à son enfant par le discours verbal et conscient et, par son discours non verbal et inconscient, lui demande autre chose. L’enfant est soit sidéré par le message paradoxal, soit répond préférentiellement à la demande inconsciente. Il y répond directement ou à travers la production d’un symptôme.
Par exemple, une mère consulte avec un bébé de dix mois dont elle se plaint qu’il est méchant, violent, sadique avec elle : il l’empêche de vivre, il l’empêche de respirer, dit-elle. « Il m’étouffe. » Elle raconte tout un tas de choses, elle a notamment une expérience qui a construit chez elle un fantasme masochiste de corps sans cesse violenté, avec des histoires de maladies, d’interventions chirurgicales, dans lesquelles son corps est tout le temps violenté. À un moment, on observe l’interaction suivante : le bébé s’approche de la mère avec un mouvement de fouissage, comme s’il essayait d’entrer dans le corps maternel : il se met sur les genoux, puis il fouisse avec sa tête comme s’il voulait rentrer dans le corps de sa mère. Elle le repousse en disant qu’il froisse sa robe. L’enfant revient, fait la même chose, la mère est angoissée par cette séquence et décide de la briser, parce que le visage de l’enfant est sale. Elle sort un gant de toilette de son sac et elle essuie le visage de l’enfant de manière énergique. L’enfant s’étouffe, il fait une crise de colère, la mère le prend, le secoue pour qu’il se calme, l’enfant attrape les oreilles de la mère, plaque sa tête contre la tête de la mère et lui mord le nez. La mère dit : « Vous voyez comme il est insupportable, il ne m’aime pas. » On peut voir comment la mère transmet ce fantasme de corps violenté : quand la mère l’étouffe, quand elle l’empêche de respirer, elle lui indique qu’elle le craint comme violeur et elle lui montre en même temps comment il doit la violenter, comment il doit violer son corps, l’étouffer, l’empêcher de respirer. L’enfant s’identifie à l’agresseur et va faire à la mère ce qu’il vient de subir. On voit comment on peut transmettre, par le discours non verbal, un fantasme.
Autre exemple : un enfant joue tranquillement dans son coin pendant la séquence, avec des Lego, un enfant tyran, qui pousse à bout, insupportable, etc. Là, il est calme. La mère explique que dimanche, c’est l’anniversaire de sa sœur. Elle se tourne vers l’enfant : « Tu as bien compris ? C’est l’anniversaire de ta sœur, dimanche. » L’enfant ne l’écoute pas et continue son jeu. « Tu as bien compris ? On va fêter l’anniversaire de ta sœur, dimanche ! » L’enfant la regarde, continue son jeu. « Tu as bien compris ? Il y aura plein de copines de ta sœur. Et puis elle aura des cadeaux ! Toi, tu n’auras pas de cadeaux ! Tu as bien compris ? Tu n’auras pas de cadeaux, dimanche ! » Au bout d’un moment, l’enfant s’énerve, s’excite, balance ses Lego, et la mère dit : « Vous voyez comme il est insupportable ? Il est jaloux ! » On voit comment le parent peut transmettre, induire ce dont il se plaint.
Le symptôme que va développer l’enfant peut ainsi souvent s’envisager comme le témoin d’une transmission, mais aussi comme le témoin de la façon dont l’enfant lutte contre cet héritage transmis, dont l’enfant se débat avec l’héritage, le fantasme transmis. Le symptôme témoigne de la manière dont l’enfant s’approprie l’héritage, devient sujet de cet héritage qui lui est transmis et indiqué par les parents. C’était une deuxième façon de comprendre, une deuxième série d’hypothèses : la lutte contre l’héritage narcissique, l’héritage des besoins infantiles des parents et l’héritage des fantasmes parentaux.
La troisième série d’hypothèses, la troisième façon de comprendre le lien tyrannique qui se développe avec un enfant qui pousse à bout, concerne la limite interne à la pulsionnalité, la question de la limite à la vie pulsionnelle. On dit souvent que ce sont des enfants qui n’ont pas de limites, qui cherchent la limite. On dispose de plusieurs métaphores pour parler de la limite.
Une première métaphore est celle de l’enveloppe psychique. On va dire que l’enfant qui déborde de destructivité, de violence, est un enfant qui n’a pas intégré, construit une enveloppe psychique contenante, qui n’a pas construit et intégré un objet qui contient. Geneviève Haag, une psychanalyste qui a travaillé sur les origines de la violence chez l’enfant, dit que les enfants violents ne vivent pas une absence d’enveloppe, mais ont plutôt la sensation d’une peau qui brûle, comme disait cette mère : « Ça le brûle, quand on le touche. » Une expression courante parle d’ailleurs d’« écorché vif », c’est une façon de parler d’une enveloppe trouée, qui ne peut pas contenir la pulsionnalité. L’enveloppe psychique est une première métaphore.
Une autre métaphore de l’enveloppe psychique est celle de l’objet support. On dira que le sujet, l’enfant, n’a pas intériorisé un objet support, qui donne la sécurité que donnent les bras maternels qui portent le bébé, la sécurité que donnent les bras maternels quand ils soutiennent le dos du bébé. Le sujet n’a pas intériorisé le holding, pour dire les choses en termes « winnicottiens ». Certains auteurs parlent d’« objet d’arrière-plan », d’« identification primaire », de « sécurité du dos », différentes manières de parler de l’intériorisation de cet objet contenant, de ces bras maternels qui soutiennent le dos, qui doivent être intériorisés pour que l’enfant puisse se lever et avoir le sentiment d’avoir une colonne vertébrale qui le tient, et se lancer dans le monde. Ces enfants n’ont pas construit un objet support sécurisant, une sécurité intérieure.
Une autre métaphore est celle de l’objet combiné bon. C’est un objet interne qui donne la sécurité et qui articule les pôles de la bisexualité psychique, c’est-à-dire qui articule les fonctions maternelles et les fonctions paternelles. Il faut que l’enfant, que le sujet, ait intériorisé cette articulation des fonctions maternelles et paternelles. Le pôle maternel est tout ce qui concerne la contenance, la réceptivité, la circularité, la compréhension. Le pôle paternel est ce qui concerne la fermeté, la verticalité, la structuration. Le pôle maternel, ce sont les bras qui enveloppent ; le pôle paternel, c’est la fermeté des bras qui tiennent, sinon le bébé passe à travers et tombe. Il faut des bras qui enveloppent et qui, en même temps, soient fermes : c’est l’articulation des fonctions maternelles et paternelles.
On peut voir qu’un enfant n’a pas intégré cela à travers le suçotement de certains enfants ou de certains bébés, qui ont une manière de sucer leur pouce consistant non pas à téter le pouce, mais à appuyer fortement le pouce derrière l’arcade dentaire, sur le palais. Plutôt que de téter, l’enfant éprouve la dureté du palais : il appuie avec son pouce derrière le palais, comme s’il essayait de sentir la dureté du palais. Il fait aussi souvent autre chose : il forme une sorte de pince avec son pouce et son index. Avec le pouce, il appuie derrière le dos de l’arcade dentaire ; avec l’index, il éprouve l’arête du nez ; avec le majeur, il se caresse la lèvre. Avec cette technique de pince, tout se passe comme si l’enfant essayait d’articuler les pôles paternels et maternels : la colonne vertébrale est projetée dans le palais et l’arête du nez. La pince doit être dure, et au milieu du « dur », il faut qu’il y ait le « mou » du maternel. Par son suçotement, l’enfant montre qu’il essaye d’articuler ces pôles de la bisexualité psychique pour construire un objet interne sécurisant qu’aura un autre enfant au suçotement plus ordinaire. Cette modalité de suçotement montre que quelque chose de l’articulation de la bisexualité des fonctions maternelles et paternelles ne s’est pas fait et que l’enfant essaye de le faire. Les enfants qui manquent de limites n’ont souvent pas construit cet objet interne articulant les fonctions maternelles et paternelles de façon sécurisée.
Autre métaphore de la limite, c’est l’objet attracteur. Le manque de limites provient aussi d’une attraction vertigineuse, non amortie par l’autre, par l’objet. Qu’est-ce qui amortit l’attraction du bébé pour la mère, le regard maternel, le visage maternel ? Ce qui amortit l’attraction, c’est le langage, la parole, le fait que la mère lui parle. Cela amortit cette attraction vertigineuse. Un enfant qui n’a pas de limites n’est pas seulement un enfant qui déborde, qui se répand, qui s’éparpille, qui n’a pas d’enveloppe, qui ne peut pas se retenir, qui n’a pas d’appui interne, d’objet support, c’est aussi un enfant qui est violemment et vertigineusement attiré par l’objet, attiré par l’autre. On peut même dire que l’objet est d’autant plus attirant qu’il est défaillant, jusqu’à l’objet rejetant, la mère rejetante qui, en même temps qu’elle rejette, attire d’une façon redoutable. Quand on observe des bébés de mères rejetantes, ce sont ceux qui se cramponnent le plus, ceux qui sont le plus accrochés. Plus la mère les rejette, plus ils se cramponnent, plus ils s’accrochent. Les corps à corps violents avec ces enfants ne sont pas seulement des attaques destructrices – ce n’est pas seulement une manière d’attaquer le corps de l’autre que cherche l’enfant dans le corps à corps –, ils peuvent aussi se comprendre comme des attractions non amorties, des répétitions d’attraction violente par un objet qui n’a pas reçu les mouvements de désir que le sujet lui a adressés. Il n’y a pas eu de communication : ce que répète l’enfant, c’est cette attraction vertigineuse violente sans amorti, sans communication qui amortisse.
Cette confrontation à la pulsionnalité destructrice qu’il faut contenir, à laquelle il faut mettre des limites, commence très tôt. La nécessité d’un travail de limitation, d’un travail de contenance, d’intégration de cette pulsionnalité, s’impose très tôt, pas seulement à l’adolescence dans les banlieues où les adolescents brûlent des voitures, mais très tôt, dès la première année de la vie, en particulier dans le deuxième semestre de la première année de la vie, là où commence à s’exprimer de façon manifeste la destructivité chez le bébé. Si le travail d’intégration de la violence s’impose très précocement, on voit comment le rôle de l’environnement dans ce travail est primordial : le bébé ne peut pas intégrer tout seul sa pulsionnalité, il ne peut le faire qu’avec le recours d’un autre qui va effectuer ce travail psychique pour lui, avant que celui-ci ne puisse le faire lui-même, tout seul, avant qu’il ne puisse le reprendre à son propre compte, ne puisse intérioriser cette fonction contenante transformatrice. La rencontre avec la violence interne du sujet, le processus de liaison de cette destructivité commence très tôt, dès bébé. L’intégration de la violence est une histoire qui concerne déjà le bébé et son entourage.
Comment se débrouille un jeune enfant, un bébé, pour traiter cette violence ? On peut dire que le traitement, la liaison de la destructivité, donc le renoncement à la violence, à la tyrannie, s’opère du fait de et grâce à l’éprouvé d’un sentiment particulier : le sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité suppose l’intériorisation d’une instance particulière qu’on appelle « le surmoi », c’est ce qui dit : « Ce que tu as fait, c’est bien, ce n’est pas bien ».
Je vais juste proposer quelques réflexions sur la manière dont on peut observer très précocement les indices de l’intégration d’un surmoi de façon précoce chez le bébé, sur le rôle que devrait jouer l’environnement dans ce travail psychique intrasubjectif et intersubjectif. Voici une observation de bébé qui peut vous éclairer sur cette intégration précoce. Il s’agit d’un bébé de cinq mois. La séquence se déroule pendant un change. Le bébé est sur la table à langer, il a un échange ludique avec la mère qui a son visage très proche de lui et qui lui parle. Brusquement, le bébé lance ses mains et attaque le visage maternel : il griffe, met les doigts dans l’œil, essaie de tirer le nez, les cheveux. La mère prend les mains du bébé et dit : « Non, non, caresse, comme cela ! » Et elle se caresse le visage. Le bébé recommence, la mère donne la même réponse, le bébé est étonné, regarde intensément la mère, il recommence, la mère répond de la même manière, etc. Au bout d’un moment, le bébé se met à caresser le visage maternel et il jubile, il rit et il y a tout un échange ludique entre les deux. À un moment, la mère s’éloigne pour se saisir d’un objet, le bébé suit son mouvement du regard, puis on voit le bébé qui lance une main devant lui et qui attrape sa main de l’autre main, comme s’il essayait de retenir la main qui partait en direction de la mère qui s’éloigne, tout cela en vocalisant.
On observe là une mère qui transforme l’attaque du bébé en un contact tendre. C’est l’inverse de la séquence de tout à l’heure, où le bébé venait chercher un contact et où la mère le rejetait. Là, la mère transforme une attaque en contact tendre, elle aide ainsi le bébé à réaliser ce qu’on appelle « une intégration pulsionnelle », à lier l’agressivité, à lier la haine à la mère. La mère a pu le faire parce qu’elle n’a pas été détruite par l’attaque du bébé. Tout se serait passé autrement si la mère avait été agacée, si elle avait dit : « Arrête de me griffer comme ça ! Qu’est-ce que tu es méchant avec maman ! » La mère n’a pas été détruite, donc elle a pu faire ce travail de transformation. Elle a transformé la destructivité, parce qu’elle a résisté à la destructivité. Le bébé a ainsi pu intérioriser, montrer un début d’intériorisation de cette fonction transformatrice, qui est d’abord une fonction limitante. On peut dire que la main qui retient traduit, représente le surmoi qui contient la pulsionnalité. Un surmoi qui contient, qui limite, est d’abord un surmoi qui retient, qui doit retenir la pulsionnalité. C’est ensuite un surmoi qui transforme. On voit le rôle essentiel de l’environnement pour que l’enfant puisse intégrer la limite. On peut souligner combien une attitude ferme et sans hostilité, sans cruauté, peut être rassurante pour l’enfant, lui faire vivre une expérience selon laquelle sa destructivité n’a pas détruit et peut donc être contenue et transformée.
On peut voir aussi combien une telle attitude favorise la symbolisation. Par exemple, on peut facilement observer, dans une famille ordinaire, les filières destructrices dans le comportement d’un bébé, dès la fin de la première année, dès le deuxième semestre de la première année de la vie. Par exemple, on va voir un bébé qui s’excite, qui jette des objets, la mère intervient pour l’arrêter, puis le bébé va avoir une exigence à laquelle la mère ne répond pas, il veut mettre la tête dans le four à micro-ondes, la mère dit « Non, ce n’est pas un jeu ! » Le bébé est alors frustré, cela le rend furieux, agacé, agité, la mère le prend dans les bras et le contient fermement. Le bébé hurle, se débat, attaque le visage, donne des coups de pied, griffe. La mère reste ferme, elle amène l’enfant dans sa chambre tout en lui parlant de la colère, elle se fait relayer par le père qui passe par là, elle lui dit : « Tiens, c’est aussi ton fils, débrouille-toi ! » Au bout d’un moment, une fois apaisé, le bébé revient, va s’approcher de la mère, va faire le lion. La mère va dire : « Oh là ! Qu’est-ce qu’il est méchant, ce lion ! » Un jeu s’instaure autour de ce lion qui rugit. Ou bien l’enfant regarde son biberon, il se met à le réprimander avec beaucoup de colère. On va passer, dans le cours de cette filière destructrice, de l’agir destructeur au symbolisé dans le jeu. Entre les deux, il y a l’attitude ferme du parent, éventuellement relayé par l’autre, sans rejet, sans rétorsion.
Geneviève Haag, dont je parlais tout à l’heure, qui a essayé d’étudier cette genèse de la violence chez l’enfant, souligne très bien la triple action du parent, dans la première année de la vie, face à la pulsionnalité destructrice du bébé. La première action consiste à limiter la destructivité en imposant la limite de la peau. C’est l’interdiction d’effracter la peau, l’interdiction d’arracher les cheveux, de crever les yeux : cela, c’est interdit. On peut explorer l’intérieur de la bouche : souvent, quand les bébés tètent, ils explorent l’intérieur de la bouche. Des explorations peuvent être permises, mais crever les yeux est interdit, l’effraction de la peau est interdite. La deuxième action de l’environnement pour intégrer cette pulsionnalité destructrice consiste à transformer une pulsion destructrice, une attaque, en un contact tendre. Enfin, la troisième action consiste à théâtraliser la violence pulsionnelle, cela veut dire jouer, parce que si l’agir est destructeur, le fantasme, lui, est permis : on a le droit de jouer au lion qui dévore le bébé. On n’a pas le droit de manger le bébé en vrai, mais jouer au lion qui dévore, on a le droit. Il s’agit de théâtraliser la violence pour la symboliser et la contenir, éviter qu’elle ne s’exprime d’une manière meurtrière. Limiter, transformer et théâtraliser sont les trois actions que doit faire l’environnement pour aider le bébé à intégrer sa propre violence.
Lorsque ce travail échoue, lorsque l’environnement ne fait pas ce travail, lorsque cette fonction intégratrice est en faillite, lorsque la transmission d’un surmoi secourable fait défaut, c’est la voie de la violence qui s’ouvre. Les enfants violents, qui font partie des enfants qui poussent à bout, sont des enfants qui n’ont pas pu profiter d’un travail de transformation de leur destructivité ou qui n’ont pas pu suffisamment en profiter. Cette destructivité non transformée, débordante, a des effets de confusion, met l’enfant, le bébé, dans un état de confusion qui s’accompagne d’un débordement émotionnel. Le déferlement destructeur aura alors paradoxalement pour fonction de trouver une issue à la confusion. C’est parce que l’enfant est en état de confusion qu’il va exploser de violence. Ce déferlement destructeur a pour fonction de trouver une issue à la confusion et au débordement émotionnel qu’il crée lui-même. Un cercle vicieux se met en mouvement. Cette destructivité pourra prendre la forme d’un agir violent chez l’enfant plus âgé et l’agir violent va propager une émotion débordante. C’est une manière de projeter la confusion au-dehors.
Par ailleurs si la pulsionnalité et l’émotionnalité qui débordent, qui ne sont pas contenues et transformées, conduisent l’enfant à l’agir violent pour échapper à la confusion, on peut dire aussi que l’enfant va chercher la contenance par la violence. Il va chercher au-dehors une limite qu’il ne peut pas trouver au-dedans. On pourra alors facilement voir l’enfant chercher à s’accrocher d’une main et à détruire de l’autre. On peut facilement faire l’expérience de tenir un enfant qui vient d’agir violemment et le voir s’agiter et hurler pour qu’on le lâche et, en même temps, s’installer, se cramponner et s’accrocher à soi. L’agir violent est une manière de mettre fin à un débordement émotionnel, d’éviter un vécu de détresse. C’est aussi une façon de trouver au-dehors une contenance défaillante au-dedans. Par exemple, dans un hôpital de jour, un adolescent extrêmement violent qui avait des explosions tout à fait spectaculaires de destructivité et de violence, disait à son infirmier quand il sentait venir la violence : « Tiens-moi et si je te dis de me lâcher, tu ne me lâches pas. » Il demandait de l’aide pour contenir sa destructivité. Il disait aussi, par exemple : « Mets-toi loin parce que j’ai peur de te taper. » Aide-moi à ne pas exciter ma pulsionnalité. Ou alors : « Laisse-moi te taper une fois, comme ça, après, je pourrai rester sans te taper. » Son infirmier lui répondait : « Non, mais tu peux taper sur ma main comme si on passait un contrat pour ne pas se taper. » Vous voyez la transformation de la destructivité ? « Non, tu ne me tapes pas, par contre, tu peux taper sur ma main, ce sera un contrat pour ne pas se taper. » Voilà comment on transforme une pulsionnalité destructrice en un contact constructif socialisé. C’est une tentative de transformation.
Pour terminer, dans un groupe d’enfants, quelles sont les causes de ces crises de violence ? Qu’est-ce qui les déclenche ? On peut dire, à la lumière de tout ce que j’ai raconté, que ce sont toujours des blessures narcissiques qui déclenchent les crises de violence. Elles sont minimes pour l’observateur, elles passent inaperçues, mais elles sont essentielles pour l’enfant. Ce peut être, par exemple, l’effet d’un regard qui s’est détourné quelques instants pour se tourner vers un autre ou vers une pensée. L’enfant s’est senti lâché. Il y a des enfants qu’on ne peut pas quitter des yeux, dans un groupe, sans qu’ils enfoncent leurs doigts dans les yeux d’un autre ou un compas dans les fesses du voisin. Ces blessures, apparemment anodines, reçoivent la charge traumatique d’une blessure primordiale qui n’a jamais été cicatrisée et qui infiltre ce microtraumatisme pour se réactualiser. Cette blessure narcissique peut générer des angoisses persécutoires confusionnantes. Je parlais de la confusion chez le bébé, on la retrouve chez l’adolescent. Ces angoisses persécutoires confusionnantes vont déclencher des crises de violence. Ces angoisses concernent en particulier le regard. Le regard de l’autre peut être très intrusif, très persécuteur pour certains enfants : il y a des enfants qu’on ne peut pas regarder. C’est Claude Baguet [?] qui décrivait un criminel qui avait tué un passant simplement parce qu’il l’avait regardé : « Il m’a regardé donc je l’ai tué. » Le regard peut véhiculer des angoisses extrêmement confusionnantes, persécutoires. La jalousie, la rivalité sont aussi très dévastatrices pour ces enfants qui ne peuvent pas ou ne veulent pas partager l’adulte avec un autre. Pour ces enfants, le groupe est un lieu de souffrance intolérable. Un des effets de la blessure narcissique fondamentale qui déclenche la violence est l’envie destructrice qui se traduit par des explosions de rage, de cruauté. Les enfants violents sont des enfants envieux des qualités dont ils ont manqué, c’est-à-dire des qualités d’investissement, d’attention, de compréhension, de contenance, etc. Ils vont essayer de s’approprier ces qualités, de ce dont ils ont manqué, de façon prédatrice. Et si l’on veut pouvoir aider ces enfants violents et maltraitants, il faut toujours chercher à retrouver la peur, l’angoisse et le désespoir qui se cachent derrière la violence, la provocation et la tyrannie. Voilà quelques réflexions sur les enfants qui poussent à bout, j’espère ne pas vous avoir trop poussés à bout et tyrannisés et je vous remercie de votre attention !
Débat
Albert Ciccone.- Il y a une question écrite, j’ai déjà répondu directement à la personne. La question porte sur l’idée selon laquelle l’enfant tyran cherche à retrouver la mère aimante qu’il a perdue. Est-ce que cela implique que ce type de lien soit toujours secondaire, qu’il y ait forcément eu quelque chose de bon qui a ensuite été perdu ? Que se passe-t-il dans les situations où l’enfant n’a jamais connu un bon lien et a eu affaire à un environnement dépressif, maltraitant, qui n’investit pas l’enfant, sans amour, et cela dès le début, dès la naissance ?
Ma réponse consiste à dire que si l’enfant n’a jamais connu un bon environnement, c’est encore pire que s’il a connu quelque chose de bon qu’il a perdu. C’est la théorie de Winnicott dans « la tendance antisociale » : il faut qu’il y ait eu quelque chose de bon, dont l’enfant ne peut pas avoir le souvenir, puisque ce « bon » a été perdu avant qu’il puisse en garder une trace vivante à l’intérieur de lui. Pour lui, il n’a jamais rien connu. Il faut bien avoir à l’idée que ce sont des processus inconscients. Le bébé ne se dit pas : « J’ai perdu une bonne mère, je vais la retrouver. » Tout cela fonctionne de manière inconsciente.
Le deuxième aspect consistait à dire que ce n’est pas possible qu’un enfant n’ait jamais rien connu de bon. S’il n’a jamais rien connu de bon, cela ne donne pas seulement un enfant qui pousse à bout ou un enfant tyran, cela donne un enfant mort psychiquement. Même si l’environnement premier est toxique, défaillant, l’enfant a trouvé des ressources dans l’environnement élargi, chez une grand-mère, une tante, une gardienne. Il a forcément fait des expériences suffisamment contenantes pour qu’il puisse construire un minimum de sentiment d’être et un minimum de continuité d’être pour pouvoir ensuite développer ce type de lien. Un enfant qui n’a jamais rien connu de bon dès le début, cela donne l’exemple que j’ai donné tout à l’heure de ce bébé anorexique, qui se retire du monde.
Question du public.- Où est le père dans cette histoire ? Intervient-il ? Parce qu’il est absent, j’ai du mal à le trouver.
Albert Ciccone.- Vous n’avez pas bien écouté mon discours !
Le père est là, bien sûr. D’ailleurs, je dis rarement « la mère », je dis « le parent », c’est le père ou la mère. Je peux vous parler du père. D’abord, il faut bien être plusieurs pour élever un enfant. C’est plus compliqué quand on est tout seul. En cela, le père et la mère sont importants tous les deux. Ils le sont aussi parce qu’ils proposent des expériences différentes. On sait maintenant que le bébé repère très tôt les différences de stimulation. Il établit des liens différents entre père et mère. Le bébé repère, par exemple, la voix maternelle : il la reconnaît avant même la naissance. Dès six mois de grossesse, le fœtus a des réactions différentes selon que c’est la mère ou un autre interlocuteur qui parle, une autre personne de l’entourage. Il discrimine, il reconnaît la voix maternelle. La voix paternelle est reconnue 15 jours après la naissance : ce n’est pas mal, c’est moins bien que la voix maternelle !
On sait aussi qu’un bébé va établir des liens différenciés avec père et mère. Il n’y a pas la mère, et puis le père qui serait là comme figurant ou juste pour être un tiers, pour séparer la mère et le bébé. Le père est d’emblée investi comme un être de relation et un être différent. L’enfant établit des modalités interactives, des modalités de jeu différentes avec le père et la mère, il va réagir de façon différente avec les différents protagonistes. Personnellement, je pense qu’il est important – c’est ce que je fais depuis très longtemps – de revoir l’idée de la fonction paternelle et de remettre en cause l’idée, longtemps développée par la psychanalyse, selon laquelle le père est celui qui interdit, qui met du tiers, qui frustre, qui énonce la Loi. Si c’est cela, être père, ce n’est vraiment pas drôle. Le père a d’emblée une importance pour le bébé, il est d’emblée investi comme être de relation par le bébé, il est différencié de la mère. Certains disent qu’en même temps que la dyade mère-bébé, l’enfant est d’emblée dans une triade. Il n’y a pas d’antériorité de la dyade, la triade est là d’emblée.
Il faut d’ailleurs rajouter à cela la fratrie. On parle toujours des parents et du complexe d’Œdipe, mais on n’a pas encore suffisamment mesuré l’importance du complexe fraternel, de ce que cela fait à un bébé d’avoir un frère qui est toujours là, toujours en train d’embêter, de casser la relation mère-enfant, qui va toujours se mettre au milieu pour casser la relation du parent avec le bébé ; à quel point cela peut être violent pour un bébé d’avoir des frères et sœurs et comme cela peut être violent, pour des aînés, d’avoir un bébé qui débarque dans l’environnement familial. On n’a pas encore accordé suffisamment d’importance au complexe fraternel et à l’importance de la fratrie dans le développement psychique du bébé et de l’enfant. Même s’il y a de plus en plus de travaux sur ce sujet, on reste focalisé sur le lien à la mère et maintenant au père (depuis une dizaine d’années), on n’est pas encore arrivé à la fratrie.
Par ailleurs, je différencie le père et la fonction paternelle, tout comme je différencie la mère et la fonction maternelle, ce n’est pas la même chose. Les fonctions maternelles et paternelles sont des fonctions psychiques, la mère et le père sont des êtres sexués, des individus différents, des objets d’investissement. Père et mère ne se superposent pas aux fonctions paternelles et maternelles. La mère doit avoir une fonction paternelle, tout comme le père a une fonction maternelle, une fonction psychique. Je dis d’ailleurs souvent qu’il est rare que ce soit le père qui ait la fonction paternelle. En général, le père a plutôt une fonction infantile ! Les mères disent souvent : « J’ai trois enfants à la maison : mes deux garçons et mon mari. » Je dis toujours : « Si vous en avez un qui a une fonction paternelle, il faut le garder, parce que c’est rare ! » Par ailleurs, ces fonctions doivent s’articuler – c’est ce que j’appelais tout à l’heure la bisexualité psychique – pour donner cette sécurité intérieure. Ce n’est pas que la fonction maternelle, ce n’est pas que la fonction paternelle, ce sont les deux, articulées à l’intérieur de chaque protagoniste, à l’intérieur de la mère et du père.
Question du public.- Vous avez beaucoup parlé de l’enfant tyran au sein de la cellule familiale. Je vous ai entendu prononcer le terme de « maîtresse » une seule fois. J’aimerais comprendre ce qui fait que ce lien tyrannique perdure au sein d’une école, d’une classe.
Albert Ciccone.- J’ai précisé tout à l’heure que je ne travaillais pas dans l’école, donc il ne m’est pas possible de parler de ce qui se passe dans l’école autrement que par le travail d’analyse de la pratique que je peux faire avec des enseignants. Bien sûr, j’ai accès à ce qui se passe dans l’école par ce biais et par tout ce que racontent les enfants et les parents, mais je n’ai pas d’observation directe dans les écoles. Pourquoi cela se répète-t-il dans les écoles ? Parce que c’est un des destins de la réalité psychique que de se répéter. C’est ce qu’on appelle « le transfert ». La base du transfert, c’est cela : ce que le sujet a vécu comme expérience première, les expériences en général qu’il n’a pas pu métaboliser, intérioriser, faire siennes, subjectiver, il va les répéter. Ce n’est pas étonnant que cela se répète ailleurs que dans le milieu familial, que ce type de lien construit d’une manière plus ou moins adéquate se rejoue ailleurs. C’est une première raison : la répétition est inéluctable, surtout la répétition de modalité de lien insatisfaisante.
On peut dire aussi que ce qui va se répéter, ce qui va se jouer dans un milieu autre que le milieu familial a aussi pour but de protéger le milieu familial. Il vaut bien mieux exprimer la haine, la tyrannie, la violence, le sadisme ailleurs, cela protège. D’ailleurs, les parents le disent : « On me dit ça à l’école, mais moi, je ne le reconnais pas, il n’est pas comme ça, à la maison. » Il y a souvent beaucoup de déni de la part des parents, mais il n’y a pas que du déni. Il y a aussi, chez l’enfant, une manière d’aller jouer, d’aller traiter ailleurs l’hostilité et l’ambivalence qu’il ne peut pas traiter dans le milieu familial.
Une autre façon de comprendre le fait que cela soit traité ailleurs, paradoxalement, c’est aussi quand l’enfant pense qu’il peut le faire ailleurs, c’est-à-dire qu’il peut le traiter, au sens plein du terme. Il fait l’expérience que là, il a une réponse, une contenance à cette expérience qu’il n’a pas dans le milieu familial. Par exemple, dans un autre registre, mais pour réfléchir à ce même type de processus, la mère amène un bébé à la crèche ou un enfant à l’école ; ils se séparent sans problème, tout va bien ; la mère revient le chercher et, dès que l’enfant voit la mère, il fait une crise de rage. L’institutrice ou l’accueillante de la crèche dit : « Je ne comprends pas, ça s’est très bien passé, il n’a pas bougé de la journée, il allait très bien mais dès qu’il vous voit… » La mère dit : « Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? » Évidemment, elle va se sentir coupable que l’enfant lui fasse vivre cela à elle. Si on réfléchit, ce que l’on doit transmettre à la mère, c’est : « Il sait que vous, vous allez le consoler, que vous pouvez le consoler. C’est parce qu’il a confiance en vos capacités de consolation qu’il peut vous montrer à quel point cela a été terrible pour lui toute la journée, ce qu’il ne peut pas faire avec l’accueillante de la crèche qui n’est jamais là, qui ne l’écoute pas, qui s’occupe du groupe et pas de lui. » C’est aussi là où l’enfant sent qu’il peut traiter ce type d’expérience qu’il va les montrer. Ce n’est pas seulement une répétition parce qu’il n’a pas pu l’élaborer, c’est aussi une répétition parce qu’il va tenter d’élaborer ce qu’il ne peut pas montrer à d’autres endroits.
Enfin, cela se joue aussi à l’école parce qu’il y a le groupe. Encore une fois, ce sont souvent des enfants pour qui le groupe est un lieu de terreur et d’angoisse dont on n’imagine pas, parfois, à quel point c’est insupportable. Cela excite beaucoup de pulsionnalité destructrice, d’envie, de jalousie, de rivalité. C’est aussi là que se montre et s’exprime cette violence.
Question du public.- Dans les écoles, on voit de plus en plus ces enfants qui n’arrivent pas à supporter le groupe et le moment de regroupement dans les classes. L’objectif doit-il être d’aider l’enfant à supporter le groupe et comment ? Faut-il parfois, pour qu’il puisse s’apaiser et peut-être apaiser ses angoisses, avoir le réflexe de le sortir intelligemment du groupe, de façon réfléchie ? Que se joue-t-il exactement pour ces enfants ? Il est vrai que, dans les classes, l’objectif est plus de supporter le groupe. Est-ce cela qu’il faut viser ? Aide-t-on l’enfant en l’amenant à supporter ou faut-il relâcher ?
Albert Ciccone.- Ce que je retiendrai dans votre proposition, c’est le terme « intelligemment ». Quelle que soit la réponse que l’on va donner, il faut que ce soit une réponse réfléchie, intelligente, qui soit faite pour l’enfant et non pour soi. Le problème est souvent celui-là : quand on donne une réponse, il n’est pas sûr que la réponse soit pour l’autre et non pour sa propre tranquillité, la tranquillité du groupe, de l’institution, du soignant, du pédagogue. Même si c’est fait pour l’autre, il n’est pas sûr que l’enfant soit convaincu. L’enfant peut vivre cela comme une exclusion. Toute la question est de donner une réponse qui montre qu’elle est pour l’autre et qui soit suffisamment convaincante. Par exemple, prenons une situation beaucoup plus simple, mais qui permet de comprendre ce type de processus. Dans une famille ordinaire, un enfant demande quelque chose : « Je veux un scooter, je veux passer mon permis, je veux ceci, je veux cela, je veux une Nintendo, je veux le dernier jeu vidéo. » Le parent refuse. L’enfant va faire une crise de colère. Derrière la demande manifeste de l’enfant se trouve toujours une demande d’amour : « Est-ce que tu m’aimes ? » L’enfant va établir une équation entre la réponse à sa demande manifeste et la réponse à sa demande sous-jacente : « Si tu me dis non, c’est que tu ne m’aimes pas. Tu vois bien que tu ne m’aimes pas, puisque tu me refuses la satisfaction que je demande. Donc, tu ne m’aimes pas. » Toute l’intelligence parentale, pour reprendre votre terme, la difficulté de la réponse parentale, est de transmettre deux réponses en même temps : « Non, ça, je te l’interdis, oui je t’aime. » Il y a des manières de dire non qui vont transmettre que le non est pour l’autre : « C’est parce que je t’aime, que j’ai confiance en toi, que je sais que tu peux trouver des ressources en toi, que je te demande de dormir dans ta chambre et de ne pas venir me sortir du lit pour que je dorme sur le canapé et que tu dormes avec maman » ; « C’est parce que j’ai confiance en toi que je te dis non » ; « C’est parce que je t’aime que je te dis non. » Il y a des manières de dire non qui vont transmettre cela et d’autres qui vont transmettre : « Fiche-moi la paix, c’est pour ma tranquillité à moi que je te dis non, je ne veux plus te voir ; si c’est comme ça, tu vas ailleurs. »
C’est pareil, pour toute réponse à ce type de comportements, le problème n’est pas la réponse en soi, il n’y a pas une recette que l’on va appliquer comme cela. La question est de savoir comment répondre pour transmettre que c’est la préoccupation de l’enfant qui nous mobilise. Cela va être d’aider à l’intégration dans le groupe, de créer des petits groupes pour qu’il se sente moins menacé, de prendre un temps individuel avec lui, de trouver une personne qui va s’occuper de lui individuellement… Quelle que soit la réponse, la question est : comment transmet-on cette réponse ? Cela dit, d’une manière générale, plus on fonctionne en petit groupe, mieux c’est ; plus l’adulte est disponible pour l’enfant mieux c’est. Évidemment, être disponible pour un enfant est extrêmement compliqué quand il y en a 30 à côté. Je ne vois pas bien comment on peut faire.
Intervention du public.- Dans les exemples que vous venez de donner et tout au long de la conférence, on a plutôt l’impression que l’on voit des petits garçons.
Albert Ciccone.- J’ai donné l’exemple d’une fille aussi.
Question du public.- Est-ce plus fréquent ? Y a-t-il plus de garçons ?
Albert Ciccone.- Je n’ai pas fait de statistiques mais je vous assure qu’il y a des filles tyranniques aussi. C’est sûrement différent, cela se joue sûrement différemment. J’ai essayé d’extraire des éléments suffisamment communs, mais chaque situation est différente. En particulier, un garçon et une fille, ce n’est pas pareil, mais le lien tyrannique se retrouve chez des bébés, des jeunes enfants, des adolescents garçons et filles.
Question du public.- Mais il n’y a pas particulièrement plus de garçons ?
Albert Ciccone.- Je n’ai pas d’études statistiques, je ne peux pas vous répondre.
Question du public.- Vous parliez de la transformation de la pulsion destructrice par le parent. En crèche, quand un enfant veut faire un câlin à un autre enfant et le mord, que faire par rapport à ce type de problème ?
Albert Ciccone.- Sa manière de lui montrer son amour est de le mordre. C’est un amour vorace, cannibale.
Question du public.- Quand c’est un adulte, il peut le transformer. Quand ce sont deux enfants, quelle réaction avoir ?
Albert Ciccone.- Il faut déjà être là. Ce n’est pas normal de laisser deux enfants s’entredéchirer et se mordre mutuellement ou laisser l’un mordre l’autre sans intervenir, sans être là. Il est important d’être là et de faire ce travail d’interdiction, de limitation et de transformation. S’il n’y a que la sanction, les centres éducatifs fermés et la réponse sarkozyste, cela n’aide personne et ne fait qu’entretenir la violence. Bien sûr, il faut la limitation, l’interdiction, mais il faut la transformation, c’est-à-dire la réponse à la demande. Vous avez dit : « Il veut faire des câlins et il mord ». La réponse doit contenir l’idée qu’on va essayer de rencontrer celui qui va faire des câlins. Celui qui mord doit se taire et arrêter de mordre, mais la partie de l’enfant qui demande un câlin, un partage, n’est pas nourrie, elle n’a pas eu suffisamment de réponse. Il faut chercher à atteindre cette partie-là. On entend parfois cette réponse pour traiter ce genre de choses : « Il faut lui faire la même chose : si tu me mords, je te mords. Si tu me tapes, je te tape. » On est là exactement dans le modèle de la rétorsion et non de la transformation. On indique à l’enfant comment il doit faire, il va bien sûr s’identifier à ce que l’on fait. Si on le tape parce qu’il fait une bêtise, la prochaine fois, c’est lui qui va taper : on lui donne le modèle et on lui fait vivre une expérience de rétorsion, c’est-à-dire de confirmation de sa destructivité.
Question du public.- Cet enfant qui pousse à bout est devenu un adolescent qui pousse à bout. On a un peu vu le travail de transformation de la mère vis-à-vis de l’enfant pour le renoncement à la tyrannie. En tant qu’enseignante dans une classe, face à un adolescent qui pousse à bout, à part l’attitude ferme et non agressive, quelle réponse peut-on apporter à cet adolescent pour essayer de le faire renoncer à la tyrannie ?
Albert Ciccone.- Je vous le disais, je n’ai pas fait d’observations directes à l’école, je ne suis pas dans le milieu scolaire, mais j’ai l’idée de ce qui se passe dans l’école, parce que j’ai fait, pendant plusieurs années, des groupes d’analyse de la pratique avec des enseignants. En particulier, j’ai eu une expérience qui a été extrêmement formatrice pour moi et qui, je pense, peut être intéressante pour les participants. C’est une expérience dans laquelle, pendant plusieurs années, j’ai reçu les enseignants d’un secteur. Dans le groupe, il y avait à la foi des enseignants de maternelle, de primaire et de collège du même quartier. C’était la première fois qu’ils se rencontraient et, à l’occasion de ces groupes, c’était la seule fois qu’ils se rencontraient et qu’ils pouvaient partager leur expérience. Ils avaient, au début, l’idée que ce qu’ils vivaient les uns et les autres n’avait rien à voir. Le groupe s’est rapidement aperçu qu’ils étaient confrontés au même type de problématique. C’était tout à fait étonnant d’entendre raconter l’expérience d’une enseignante de maternelle et de voir ensuite comment un enseignant de collège employait les mêmes mots, était confronté aux mêmes mouvements, aux mêmes processus, aux mêmes difficultés. Il y a eu une vraie communauté, un vrai partage, qui a permis de réfléchir et notamment de suivre le parcours, l’évolution de ces comportements-là depuis le bébé jusqu’à l’adolescent, et de voir, au fond, le type de réponse du même ordre qu’on pouvait inventer, chercher. Évidemment, dans le manifeste, cela va s’exprimer de façon différente : on ne va pas répondre de la même façon, on ne va pas tenir dans les bras un adolescent de la même manière qu’un bébé qui vient d’en mordre un autre, pour le contenir, parce que c’est un adolescent. Il est plus grand et plus fort que nous : si on s’approche de lui, il nous donne deux gifles. Autant, dans un groupe de petits enfants, on peut se mettre devant la porte et dire : « Non, tu ne sors pas », on peut contenir la violence ; autant, dans un groupe d’adolescents de 14 ou 15 ans, si on se met devant la porte, il nous met son poing dans la figure et il passe quand même. C’est plus difficile de le contenir. Il faut trouver des équivalents de la contention physique, mais le principe est le même : on va toujours s’adresser à la partie « bébé », c’est celle-ci qui est en souffrance. Évidemment, on ne va pas s’adresser à elle de la même manière, il faut inventer des façons de faire, des pratiques, qui ne sont pas forcément transposables d’une expérience à une autre, qui sont la création même du groupe d’adulte, des protagonistes de la situation. Il faut inventer des pratiques qui s’adressent, qui répondent aux mêmes types de demandes, aux mêmes types de difficultés.
Cela dit, ce n’est pas tout à fait les mêmes types d’expériences. Le problème, chez l’adolescent – je le disais aussi pour l’enfant –, c’est qu’il y a des bénéfices secondaires qui se greffent là-dessus, notamment toute la jouissance : il y a une jouissance à mettre l’autre en déroute qui va être un enjeu à elle seule. Il y a l’organisation délinquante en groupe, en bande qui va, à elle seule, apporter des complications. Autant un enfant de quatre ans qui nous agresse, on peut se dire : « Oui, c’est parce que tu m’aimes que tu me fais ça et que tu veux que je te montre que je t’aime », autant un adolescent qui brûle votre voiture, c’est difficile de dire : « Oui, c’est une demande d’amour que tu m’adresses. » C’est plus compliqué, parce qu’il y a d’autres logiques qui viennent complexifier la situation, se greffer dessus et faire taire la demande primaire qui, au fond, est la même que celle du petit enfant, mais qui est plus difficile à atteindre.
Une réponse proposée dans ce collège était le tutorat, que j’ai d’abord pris pour une invention locale avant de m’apercevoir que ce type de dispositif était proposé ailleurs également : ce sont des choses que vous élaborez vous-mêmes quand vous pensez vos pratiques. Pour des enfants, des adolescents difficiles, des problématiques de violence, d’échec scolaire, un enseignant devenait tuteur. En général, c’était un enseignant qui n’avait pas l’élève dans la classe. Il n’avait pas de fonction pédagogique, mais c’était extrêmement intéressant et on a vu des évolutions tout à fait spectaculaires chez certains enfants qui avaient enfin quelqu’un qui les écoutait et qui prenait du temps. C’était du temps pris sur leur temps personnel, la supervision qu’ils venaient faire chez moi était faite sur leur temps personnel, payée avec leur argent personnel, parce que pour entrer dans l’éducation nationale, dans une école, et faire de l’analyse de la pratique, je sais pas comment il faut faire. Peut-être les psychologues scolaires peuvent-ils le faire ou savent-ils le faire, mais les portes sont fermées. Les gens venaient sur leur temps personnel et sur leurs deniers personnels et nous réfléchissions à ces situations. Nous avons vu des évolutions spectaculaires chez des enfants qui ont pu faire alliance avec ce tuteur. Nous avons bien sûr travaillé sur le tuteur, sur la façon de supporter la violence et l’échec, de supporter que l’adolescent ne réponde pas à ce qu’on attend de lui. C’était cela le plus dur : de supporter, de tolérer, c’est-à-dire de ne pas laisser tomber. La réaction la plus fréquente à laquelle on est confronté, c’est l’envie de laisser tomber, de dire : « Il n’y a qu’à l’envoyer chez le psychiatre, chez le psychologue, il faut le placer. » Il faut donc supporter, ne pas laisser tomber. C’est une expérience que ces enfants n’ont jamais faite : ils n’ont eu affaire qu’à des adultes qui ont toujours laissé tomber tellement leur violence était insupportable, les premiers qui ont laissé tomber étant les parents.
Question du public.- Je voudrais vous interroger sur le moment où ce comportement devient celui d’un groupe : dans les écoles, on connaît des groupes, des classes qui, certaines années, font craquer une succession d’adultes les uns après les autres, qui racontent des comportements de jouissance de certains élèves disant : « On en a déjà fait pleurer trois avant toi ; d’ici peu, on t’aura aussi. » Ces comportements sont fréquents. Comment le groupe se transforme-t-il et évolue-t-il vers ce type de position ? Comment un adulte pourrait-il s’y prendre pour aider un groupe à sortir de ce processus, pour entrer dans autre chose et pouvoir recommencer ?
Albert Ciccone.- J’ai parlé tout à l’heure d’un auteur, un psychanalyste anglais qui s’appelait Donald Meltzer. Il avait fait tout un travail pour montrer ce qu’il y avait de commun et de différent entre ce qu’on appelle le « sadomasochisme » et ce qu’il appelait la « tyrannie et soumission ». Je vous ai un peu parlé de la tyrannie et de la réponse aux angoisses dépressives, mais un autre élément est important et différencie le sadomasochisme de la tyrannie soumission. Dans le sadomasochisme, il y a beaucoup de liens, c’est un ciment social qui fait tenir ensemble un couple très longtemps. L’une des différences avec la tyrannie est que c’est un « jeu » qui peut aller très loin dans la violence, mais cela reste un jeu intime, qui reste dans le cercle de la relation à l’autre et, en général, de la sexualité. En revanche, la tyrannie et soumission, c’est une affaire sérieuse, selon Meltzer : si le premier est un jeu, l’autre est une affaire sérieuse qui engage des processus beaucoup plus primitifs et archaïques, et qui s’extrapole en permanence dans le champ social. La tyrannie soumission concerne deux individus, un parent et un enfant, un mari et une femme, mais s’extrapole facilement dans le social, dans un groupe, dans l’institution et à l’échelle d’un pays. Il existe des pays qui sont gouvernés par des tyrans. Cela peut facilement s’extrapoler parce que cela met en jeu des mécanismes très primitifs dont le groupe est friand : le groupe est plein de liens, de modes d’action très archaïques. Dans le sadomasochisme, l’enjeu est le plaisir : tirer un plaisir de ce que la douleur autorise, c’est-à-dire « Maintenant que j’ai eu mal, je peux jouir », « Maintenant que tu m’as fait mal, la maîtresse-bourreau m’a fouetté, je peux tirer une jouissance », « Puisque j’étais puni, je peux maintenant jouir. » On voit bien cela dans les familles avec un enfant porteur de handicap, où les liens incestuels dont je parlais tout à l’heure et la manière dont ils s’établissent sont encore plus flagrants : ce qui fait tenir ce lien incestuel, c’est l’idée qu’on a déjà été puni. « Puisque j’ai déjà été puni, je peux maintenant jouir, je peux garder cet enfant pour toujours, je peux avoir un lien incestuel avec cet enfant, il reste une partie de moi, je ne m’en séparerai jamais. » Quand on annonce à des parents un handicap grave, lourd, la première question qu’ils posent est : « Que va-t-il devenir quand on ne sera plus là ? » C’est une vraie question, mais elle sous-entend l’idée d’un enfant pour toujours, dont on ne va jamais se séparer. Cela produit des jouissances terribles : l’incestualité est une source de jouissance très forte.
Si, dans le lien sadomasochique, le plaisir et la jouissance sont recherchés, dans le lien de tyrannie et soumission, c’est la survie. Ce n’est pas une problématique de plaisir, mais de survie. La jouissance va être extrêmement dévastatrice, c’est une jouissance annale. Le monde de la tyrannie est un monde anal. C’est, par exemple, le monde des romans de science-fiction, des bandes dessinées ou des dessins animés de science-fiction dans lesquels un héros est dans son antre, derrière ses ordinateurs, et contrôle et maîtrise le monde en appuyant sur des boutons : il est dans un cloaque, « dans le derrière », pourrait-on dire, dans un monde anal, et il va détruire le monde. C’est le bébé qui envoie son caca partout pour détruire le monde. Ce sont des logiques très archaïques et le groupe est plein de logiques barbares et archaïques qui peuvent se répandre très facilement : on fait en bande, en tribu, des choses qu’on ne ferait jamais tout seul. C’est l’analité, le côté le plus barbare, le plus destructeur de l’être humain qui se répand très facilement dans un groupe. Ce n’est pas le cas du sadomasochisme, que l’on fait tout seul avec son partenaire.
L’autre particularité du lien de tyrannie et soumission, c’est le renversement : la crainte du tyran est de devenir victime et que l’esclave se rebelle. Un groupe, c’est pareil : la crainte du groupe, qui fait que le groupe devient tyran, est que l’esclave fasse vivre la dépendance à l’autre. L’un des enjeux de la tyrannie est de se débarrasser des émotions infantiles, notamment la culpabilité, la honte : c’est l’autre qui va les porter. L’enjeu de la tyrannie est de trouver un « porte-affects » : quelqu’un qui va porter les affects que le sujet ne veut pas ressentir, comme la culpabilité, la honte. Donc, on se trouve un esclave qui va héberger cette vie émotionnelle et on s’arrange pour que les émotions restent chez lui : on l’humilie, on le violente, on l’indigne, pour que la vie affective, les angoisses de dépendance, jusqu’à l’humanité, restent chez l’autre et que, soi-même, on en soit préservé. L’angoisse du tyran est de voir l’esclave se rebeller parce qu’il se retrouverait face à son impuissance, à ses angoisses, à sa culpabilité. Plus on se protège de la culpabilité et de la honte, plus on va humilier pour faire vivre la honte et la culpabilité à l’autre. Plus l’autre risque de se rebeller, plus on va être violent dans sa barbarie pour ne surtout pas être confronté à ses angoisses, aux anxiétés humaines banales qui deviennent intolérables pour un tyran ou pour un groupe tyran.
Pour Meltzer, la tyrannie est un processus extrêmement violent et destructeur, qui consiste à tuer un objet interne chez l’autre pour en prendre la place. L’objet interne est en général le surmoi. On va rendre dépendant l’esclave pour assurer sa propre domination et ne pas être soi-même confronté à la dépendance.
Albert Ciccone.- Meltzer définit la tyrannie comme un processus extrêmement violent et destructeur. Elle consiste à tuer un objet interne chez l’autre pour en prendre la place. L’objet interne est en général le surmoi. On va rendre dépendant l’esclave ; on va s’assurer de sa propre domination ; on va s’assurer de ne pas être soi-même confronté à la dépendance.
Question du public.- Je me range surtout du côté des maîtres [inaudible]. Quand on est personnel de l’Éducation nationale, on ne s’autorise pas à parler de ses limites. Je dis souvent aux maîtres de poser leurs limites. C’est bien aussi de dire que l’on ne peut plus. Est-ce que, justement, en posant nos propres limites d’adultes, on aide l’enfant à construire ses limites propres ? L’enseignant encaisse. Inévitablement, à un moment donné, il craque et cela peut vite mener au « clash ». Ne vaut-il pas mieux alors parler de ses limites ? Peut-on s’autoriser cela, même si on est personnel de l’Éducation nationale ?
Albert Ciccone.- Je n’en sais rien, mais je parlerai du monde des soignants que je connais mieux. On retrouve la même problématique. Quand on est soignant, on ne peut pas aider tout le monde. On a des limites. Probablement, quand on est enseignant, on ne peut pas enseigner à tout le monde. Il est extrêmement important de connaître ses limites, pour au moins deux raisons : la première, pour ne pas craquer, cela n’aiderait personne. La seconde, pour ne pas être dans l’imposture ou dans le « faux self » qui consisterait à utiliser la théorie [selon laquelle] : « voilà comment il faut faire : il faut que je te punisse, il faut que je donne telle réponse ».
Dans le milieu soignant, c’est le cadre. Il faut respecter le cadre. On s’agrippe au cadre pour ne pas avoir à reconnaître ses propres limites. Quand on donne une réponse, on la donne pour l’autre ou pour soi. Le pire est quand on fait semblant de la donner pour l’autre, au nom du cadre, de la loi, du règlement. En fait, c’est pour soi qu’on la donne.
Winnicott avait un très bel article qui s’appelle « la haine dans le contre-transfert ». Pour parler de la haine dans le soin au patient, il faisait le détour par la haine qu’éprouve le parent vis-à-vis de l’enfant, du bébé. Il est important de reconnaître la haine qu’on peut éprouver vis-à-vis de son bébé. Il est important de le reconnaître pour ne pas l’agir de façon sournoise, détournée, sous prétexte d’amour. Des tas d’actes éducatifs d’un parent sont donnés sous prétexte d’amour et, en fait, sont l’expression de la haine. Je dis toujours que l’on a construit des tas de manières d’éponger la haine quand on ne veut pas la reconnaître.
C’est vrai pour les parents et pour les enseignants aussi. Beaucoup d’humiliations sont utilisées comme procédés éducatifs. Par exemple, dire les notes des copies à haute voix, devant tout le monde, avec des petits commentaires sadiques : « Aujourd’hui, tu n’as eu que 8, tu n’as pas bien réussi ». Il s’agit bien d’une humiliation utilisée comme procédé social éducatif et qui, en fait, est l’expression de la haine.
C’est pareil pour les parents qui font acte d’exigence éducative et qui exigent qu’un enfant reste à table jusqu’à la fin du repas ; exiger qu’il ne mange son fromage que s’il a fini sa viande ; qu’il ne touche au dessert que s’il a fini son assiette de fromage. Je ne vois pas pourquoi on exigerait cela, si ce n’est pour éponger les affects de haine, c’est-à-dire pour essayer de lier, d’éponger cette haine afin qu’elle ne s’exprime pas de façon directe et de façon potentiellement meurtrière. Il existe plein de façons, socialement admises, d’exprimer la haine vis-à-vis des enfants. Par exemple, on peut leur faire des implants, leur mettre des diabolos ; on peut leur enlever les végétations, les amygdales, l’appendice. Les ORL sont très bien placés dans l’exercice socialement admis du sadisme des adultes vis-à-vis des enfants. Très souvent, on se rend compte que toutes ces choses ne servent à rien. Les pédiatres sont souvent contre. On ne va pas dire à une mère qui a fait enlever les végétations de son enfant qu’elle est une mauvaise mère. Elle l’a fait pour le bien de son enfant. Il est important de reconnaître ses limites, de reconnaître ce que l’on ressent, de reconnaître l’agacement, la haine, pour ne pas l’agir.
C’est valable pour les enseignants comme pour les autres (les parents, les soignants…), pour ne pas l’agir au nom du cadre, de son métier, de la loi, de la profession, du professionnalisme. De nombreux actes violents insupportables sont posés par des assistantes sociales, des éducateurs, au nom du professionnalisme. Avez-vous déjà vu comment on arrache un bébé à une mère maltraitante avec les forces de l’ordre, pour faire le bien des bébés, des enfants ? Mais c’est d’une violence ! Il faut l’avoir vécu pour savoir à quel point cela peut être violent, au nom du professionnalisme. Quand on demande à une mère d’accueil de ne surtout pas se faire appeler « maman » par un enfant qu’elle garde depuis l’âge de six mois et que l’enfant a huit ans, au nom du professionnalisme, vous voyez comment on peut être très violent et comment la haine peut s’exprimer à travers l’éducation, à travers un tas de principes socialement admis, mais qui ne sont que des tentatives d’intégrer cette haine non reconnue ! Il est donc important de la reconnaître, avant tout de reconnaître ses limites.
Deuxième point important : on n’est pas obligé d’éduquer, de sauver, de soigner tout le monde. Le peu d’enfants à qui on va apporter notre aide, ce n’est déjà pas mal, c’est même déjà beaucoup ! On n’est pas obligé de tout faire. Mais si on veut essayer de le faire, c’est important de penser les limites. Plus on pense la limite, plus la limite recule. C’est vraiment une expérience quotidienne. Je parlais des groupes d’analyse de la pratique : quand des gens en groupe d’analyse de la pratique apportent des situations insupportables, comme par hasard, cela devient un peu moins insupportable. Ils reviennent à la séance suivante en disant : « Je ne comprends pas ; on dirait que l’enfant était derrière la porte quand je parlais de lui. Il a changé ». Ce n’est pas l’enfant qui a changé, c’est notre regard qui a changé. C’est notre façon de penser la limite qui, par conséquent, rend la limite un peu plus supportable, pousse un peu la limite. Cela donne de l’espace à l’enfant et lui permet de s’exprimer d’une façon différente, lui qui a toujours cru qu’il ne pouvait s’exprimer que de cette façon, sinon il n’aurait jamais été entendu.
Penser la limite ne se fait pas comme cela. Je parlais des groupes d’analyse de la pratique : j’y crois beaucoup. C’est extrêmement important ; ce sont vraiment des lieux de partage, d’échanges, de pensées, de trouvailles et d’inventions de solutions. Je pense que l’on invente, on trouve plus les solutions qu’on ne les adopte. Si elles sont bonnes pour d’autres, elles ne le seront pas forcément pour soi. La première chose à faire pour le travail d’un groupe d’analyse de la pratique est d’observer ce qui se passe. Je pense que l’on ne sait pas faire. Observer s’apprend, ce n’est pas donné de façon naturelle. On ne voit que ce que l’on veut voir dans une situation. Il faut vraiment apprendre ; il faut vraiment une exigence importante, que ce soit pour les enseignants, les paramédicaux et les éducateurs. Faire une observation clinique s’apprend : il faut vraiment observer ce qui s’est passé, ce que l’enfant a fait.
Vous allez vous arrêter cinq minutes dans votre pratique pour observer ce qui se passe. Comment a-t-il agi ? Que s’est-il passé avant ? Que lui a-t-il été dit avant ? Qu’a-t-il dit ? Qu’a-t-il fait après ? On retrouve la séquence de l’agir violent. Que l’agir violent ne soit pas imprévisible, insensé, débordant et qu’il ne nous rende pas impuissants ! Les choses changent du moment où l’on commence à faire des observations. Si l’on commence à prendre le temps d’observer, de façon attentive, pour ensuite retravailler cette observation dans un séminaire, dans un groupe, le fait de prendre une position d’observation attentive change les choses. Évidemment, ce n’est pas magique ; c’est pour vous transmettre l’expérience de praxis, de dispositifs qui peuvent aider. Cela dit, il existera toujours des limites, des enfants dont on ne pourra pas s’occuper. Il faudra bien que les autres s’en occupent parce que l’on ne peut pas s’occuper de tout le monde.
Question du public.- Que pensez-vous de la pédagogie Freinet ?
Albert Ciccone.- Je serais incapable de vous répondre parce que ce n’est pas mon domaine. Je pense que c’est très bien, mais je ne suis pas du tout spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie Freinet.
Quelles réponses apportent ces pédagogies à ce type de problèmes ?
Intervention du public.- On aborde les choses différemment. Je trouve que c’est intéressant parce que cela apporte certaines réponses.
Albert Ciccone.- Je ne connais pas le champ de la pédagogie mais cela me fait penser, dans le domaine du soin, à ce que l’on appelle le soin institutionnel : la psychiatrie institutionnelle. Il y a des dispositifs qui ont été au goût du jour, à une époque, qui sont réhabilités après avoir été critiqués. Deux idées sont intéressantes dans ce type de dispositif – cela se retrouve peut-être dans vos dispositifs pédagogiques. D’une part, il y a l’idée du « vivre avec », de l’accompagnement. Ce sont des institutions dans lesquelles les soignants sont avec les patients, mais pas derrière leur bureau à prescrire des conduites orthopédiques : ils vivent, ils mangent avec. Ce sont des endroits où les patients ont la clef de la maison, mais pas les soignants. Les patients sont plus chez eux que les soignants. Ils partagent des temps de repas, c’est-à-dire un vrai accompagnement. Je crois beaucoup en cela. Je ne sais pas si on peut dire la même chose de la pédagogie, mais pour le soin, les soignants font de l’accompagnement : on accompagne les gens dans la rencontre avec leurs propres difficultés et dans la trouvaille des solutions à leurs difficultés. C’est un travail d’accompagnement.
D’autre part, le deuxième point qui me paraît important et qui, peut-être, peut se retrouver dans ces dispositifs, est le fait de partir de là où en est l’autre. Vous devez sûrement vous poser ce genre de question : les élèves doivent-ils s’adapter à l’école ou l’école doit-elle s’adapter aux élèves ? Vous avez sûrement ce type de réflexion dans ce soin institutionnel, on part de là où en est l’autre, le patient, l’enfant, pour l’aider à cheminer, à rencontrer sa propre partie souffrante et à trouver ses propres solutions.
Question du public.- Que nous disent les enfants qui ne poussent pas à bout, mais qui sont jusqu’au-boutistes ? Il y a cette violence, mais ils se la retournent contre eux. Comment peut- on les aborder ?
Albert Ciccone.- Ma prochaine conférence portera sur les automutilations. Il est extrêmement important d’essayer de comprendre ce qui se joue dans l’automutilation, l’autodestructivité. On retrouvera des choses communes, mais ce n’est pas la tyrannie de soi à soi. Plein de choses ont à voir avec l’objet. La trace faite sur son corps, le coup porté sur son corps, ce n’est pas à soi qu’il est porté, c’est bien à l’autre, mais à l’autre à l’intérieur de soi. Il y a une dimension de quête, comme je le disais dans le lien tyrannique : on cherche l’objet, on cherche dans le corps. Comme on l’a perdu au-dehors, on le cherche dans le corps : c’est la scarification, l’automutilation, le fait de se frapper, l’inscription sur le corps. Par exemple, beaucoup de scarifications se font dans le milieu carcéral. La sortie du parloir est un moment particulier de la vie en prison. Les gens ont une visite ; la personne qui rend visite s’en va ; le détenu entre dans l’isolement ; il se scarifie. On peut dire que la coupure devient la trace de l’objet. « Je perds l’objet, mais je ne le perds pas puisque je le garde sur mon corps. En même temps, c’est un objet que j’abîme, que je mutile, que je tue ».
Le paroxysme de l’automutilation est le suicide. Le suicide n’est pas se tuer soi, c’est tuer. Ce n’est pas que tuer soi, c’est aussi tuer l’autre. Comme chez l’enfant qui pousse à bout, cette trace peut être investie d’une façon héroïque, fétichisée. Si certains adolescents cachent leurs scarifications, d’autres arrivent en séance et remontent tout de suite leurs manches. On constate une espèce de jouissance, d’exhibition à montrer jusqu’où on est allé, jusqu’où on a gardé l’objet en soi, jusqu’où on est allé vers une trace, une permanence de cet objet. Même chose avec le tatouage : c’est une façon de garder l’objet, de garder une perception permanente, une trace fétichisée de l’objet. On pourrait dire que tous les tatouages, quels qu’ils soient, se résument, au bout du compte, au même sens, à la même phrase : « J’aime maman ». D’ailleurs, lorsque les gens évoluent, souvent ils ne supportent plus le tatouage. Le tatouage vient rappeler l’état de non-intégration ou le manque d’intégration intérieure ; ils essaient de se l’enlever. Comme trace fétichisée de l’autre, de l’objet en soi, on peut parler encore du piercing, des boucles d’oreille. C’est une façon de garder l’objet en soi.
Question du public.- Il y a des enfants qui se masturbent en classe de façon à ce que cela se voit. Est-ce que cela rentre [dans ce cadre] ? De quelle manière ?
Albert Ciccone.- Bien sûr. La masturbation en classe n’est pas une masturbation : il y a différentes manières de se masturber. La vraie masturbation érotique est secrète, elle s’accompagne de fantasmes. C’est pour celle-là qu’on peut dire à un enfant, à un adolescent : « Monte dans ta chambre, cela te regarde ». On a souvent affaire, dans les équipes de pédopsychiatrie, à ce type de comportement. On entend très fréquemment ce genre de réponse, parmi les infirmiers, médecins, psychologues. « Non, il faut lui dire qu’il peut le faire, mais dans sa chambre ou aux toilettes ». Ils prennent ce comportement comme un vrai acte auto-érotique, ce qui n’est pas le cas. C’est un acte omnipotent qui n’est pas génital, mais qui est anal. Ce n’est pas parce que cela se passe au niveau du pénis que c’est génital ; c’est de l’analité. C’est exactement l’exemple que je donnais du monstre tout-puissant qui, derrière ses ordinateurs, contrôle le monde. Au lieu d’être dans le derrière, il est dans le phallus ; il y a un retournement anal phallique. Le phallus exhibé ou l’analité exposée, c’est le même monde. Ce n’est pas du tout un monde génital ni érotique, mais un monde narcissique destructeur. Le phallus de celui qui se masturbe en public, c’est justement un phallus, un objet tout-puissant. Ce n’est pas du tout un objet érotique, au sens génital du terme. C’est montrer la supériorité et écraser l’autre de sa supériorité phallique.
Question du public.- Même pour une fille ?
Albert Ciccone.- Le phallus n’a pas de genre. Le phallus intéresse aussi bien la fille que le garçon.
Question du public.- Certains enfants tyrans à la maison s’enferment dans le mutisme quand ils vont à l’école et ne livrent rien d’eux-mêmes ; n’est-ce pas une sorte de pouvoir ?
Albert Ciccone.- Le mutisme est un comportement extrêmement tout-puissant qui met l’autre dans l’impuissance. Chaque fois que l’on est mis dans l’impuissance, on a affaire à un comportement omnipotent : mutisme, violence… D’ailleurs, on dit bien que les enfants inhibés sont des enfants très agressifs, comme si c’était à ce prix-là qu’ils pouvaient empêcher leur agressivité de devenir meurtrière. La timidité masque souvent une très grande agressivité.
Question du public.- Je suis professeur en collège et je voudrais vous poser une question par rapport aux pauvres moyens disciplinaires face à un enfant tyran, c’est-à-dire « l’échelle des sanctions ». On a pris récemment un élève en commission de vie scolaire (juste avant le conseil de discipline). Cela s’est conclu en lui disant : « Fais attention, la prochaine étape, c’est le conseil de discipline ». C’est ce qui est dit à chaque fois en commission de vie scolaire. Je me demande si cela ne va pas à l’encontre du but recherché. Est-ce qu’en disant cela, on ne précipite pas le conseil de discipline, ce qui est peut-être le but recherché.
Albert Ciccone.- Cela peut être le but recherché, aussi bien par l’enfant que par l’institution.
Question du public.- Quelle alternative proposer en commission de vie scolaire ?
Albert Ciccone.- Je ne suis pas sûr de savoir comment fonctionnent les commissions de vie scolaire. L’idée de sanction reconnaît la transgression : il y a en effet quelque chose qu’on ne peut pas admettre. Toute la question est de savoir comment on propose la sanction. On sanctionne pour aider une vie et non pas pour protéger l’institution scolaire. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas protéger l’institution scolaire, mais quand la sanction n’est donnée que pour protéger l’institution scolaire ou si la sanction n’est donnée par les parents que pour protéger la tranquillité du parent, cela excite encore plus l’enfant et le pousse à aller encore plus loin. Quand la punition donnée par le parent ou la sanction donnée par l’institution est transmise d’une façon suffisamment convaincante quant à son objectif, qui est d’aider l’enfant, cela peut faire la différence. La question est comment convaincre l’autre pour lui et pas pour soi ? La punition ne doit pas seulement viser sa tranquillité narcissique personnelle. L’exemple frappant est d’entendre dire d’un parent, dans une famille ordinaire (il n’est pas nécessaire de chercher des enfants violents pour cela) : « Ne me mets pas en colère », lorsqu’un enfant vaque à son activité et fait des bêtises. Cela signifie : « Je suis là pour t’aider à contenir ton débordement ; sois un adulte qui contienne ma propre colère et veille à ce que je ne sois pas confronté à ma propre pulsionnalité destructive ». Vous voyez ce qu’une simple phrase banale peut transmettre comme inversion générationnelle. L’enfant va entendre que la parole de l’adulte n’est pas pour lui, enfant, mais qu’elle est pour l’adulte. Ce n’est pas un « non » pour aider l’enfant à se contenir, mais pour protéger le parent afin qu’il n’ait pas à confronter sa propre colère intérieure. Cela ne va pas aider l’enfant à se contenir. Au contraire, cela va l’exciter pour aller encore plus loin.
Question du public.- J’ai en tête l’exemple d’un enfant tyrannique. Quand on discute avec la maman, c’est un enfant en grande section, a priori, en recherche d’identité. C’est un petit garçon qui veut mettre des robes, qui prend des crayons roses. Il existe un paradoxe quand on discute avec la maman, visiblement cela ne la dérange pas, mais, en même temps, elle nous a raconté qu’elle lui avait acheté une robe, l’avait habillé en fille et l’avait pris en photo en lui disant : « Si tu continues, je te montre avec la robe à tes copains et je montre les photos ». À l’occasion de Noël, quelqu’un de la famille a demandé ce qu’il pouvait lui acheter et la maman a répondu : « Tu n’as qu’à lui acheter un bouquet de fleurs ». Par rapport à cette construction identitaire, y a-t-il un problème avec la maman ? Je ne sais pas si elle voulait une petite fille. Cela l’obsède. Peut-on faire un lien entre cette recherche d’identité et le fait que cet enfant, a priori, soit tyrannique ? Est-ce une cause, un effet ?
Albert Ciccone.- Premièrement, cela rejoint ce que j’ai essayé de dire sur la manière dont l’enfant va traiter l’héritage, c’est-à-dire ce qui est projeté, transmis, attendu de lui. On voit bien comment on peut induire ce dont on se plaint.Deuxièmement, cela rejoint ce que j’essayais de dire sur la manière dont la haine infiltre le lien à l’enfant et dont l’enfant va réagir à la haine. On voit bien toute l’humiliation qui est utilisée : « Si c’est comme cela, je vais montrer la photo à tout le monde ». On utilise l’humiliation comme méthode éducative ce qui entretient d’une manière redoutable, les liens tyranniques. Les liens tyranniques sont basés sur une haute humiliation. Ce sont des attaques narcissiques en permanence. L’identité, au sens de l’identité narcissique, est tout le temps remise en jeu, fragilisée par le lien tyrannique.
Troisièmement, il faut aussi se garder d’accuser les parents d’avoir des positions d’accusation parce qu’un enfant tyran peut pousser à des actes extrêmes. Quand on n’en peut plus, on peut arriver à être violent : à secouer un bébé hurleur, inconsolable. Cela attaque vraiment les capacités de penser, les capacités de contenance, les capacités parentales. Cela peut vraiment conduire à des actes extrêmes. Il faut donc se garder d’avoir des liens de cause à effet et d’accuser l’un en prenant partie pour l’autre. Votre quotidien est de travailler avec les enfants. S’occuper des familles (des parents et des enfants) est un travail extrêmement difficile parce que l’on a très vite fait de s’identifier à l’un contre l’autre, de prendre le parti des enfants, d’accuser les parents. On a très vite fait de s’identifier aux parents et de trouver cet enfant monstrueux, insupportable, et d’avoir envie de le jeter par la fenêtre. Toute la difficulté est d’arriver à une position qui reste à égale distance de tout le monde. Si l’on veut aider un couple lié par un lien tyrannique, que ce soit un parent – un enfant ou un couple d’adulte, il faut pouvoir s’identifier au bourreau et à la victime. Il faut pouvoir s’identifier aux deux. Si l’on n’est identifié qu’à la victime ou qu’au bourreau, on n’aidera personne. Il faut pouvoir s’identifier aux deux et rester à égale distance des deux pour comprendre ce qui se passe dans le lien et ne pas prendre parti pour l’un contre l’autre. Chaque fois que l’on accuse, on n’aide pas. Parfois, on ne peut pas – on a ses propres limites –, mais si on ne le peut pas, il faut que quelqu’un d’autre le fasse. Chaque fois que l’on prend des positions d’accusation, cela rajoute de la cruauté là où il y a déjà de la souffrance.
Si je ne veux pas me sentir complètement tyrannisé, il va falloir que l’on s’arrête…
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 09:40
article issu de : http://www.psycho-ressources.com/bibli/attachement.html

.L'attachement
Par Eric Brabant
Gestalt Thérapeute et Formateur
Toulouse, France
| Voir ma page Psycho-Ressources |.
L'attachementLa plupart des gens succombent à l’attachement, relique de la petite enfance parce qu’au départ vital pour la survie du nourrisson. L’attachement est défini comme lien que l’enfant, dépendant, établit avec sa mère au début de sa vie avec le but d’être nourri dans ses besoins fondamentaux de base et de trouver en ce lien une « base de sécurité ». La qualité de l’attachement à la mère conditionne la sensation de sécurité, la sociabilité et les troubles de l’attachement mènent à l’angoisse de séparation ou d’abandon ainsi qu’à divers troubles psychologiques :
· troubles alimentaires : anorexie, boulimie (KOBAK, 1996)
· conduites addictives : toxicomanie, alcoolisme, jeu, internet, etc. (FONAGY, 1996)
· troubles de l’humeur (TYRELL – DOZIER, 1997)
· troubles anxieux (FONAGY, 1996 ; WARREN, 1999)
· troubles limites de la personnalité sous forme de troubles fonctionnels dissociatifs (dépersonnalisation, troubles de mémoire, pensée désorganisée, impulsivité mal contrôlée). (ZANARINI 1989, LIOTTI 1999).
En fonction de l’attitude de la figure maternelle à son égard, l’enfant développe un modèle d’attachement qu’il intériorise et dont il se servira ultérieurement au cours de sa vie dans toutes ses relations sociales et intimes.
Toujours est-il que si l’attachement est indispensable au début de la vie dépendante, il devient pathologique pour un adulte qui se voudrait autonome (Cf. L’autonomie – Eric Brabant). Pour une espèce, la satisfaction des besoins fondamentaux conditionne la survie puis la vie en société. La préoccupation envers eux est donc avantageuse mais l’attachement à ceux-ci est nettement préjudiciable et se fait terreau de toutes les souffrances sous toutes les formes.
L’attachement chez l’adulte, dit « upādāna » en Pali et qu’on nomme « tchac » en tibétain, est synonyme de convoitise et ramène exclusivement à soi. Il représente une saisie sur l’objet et c’est le corollaire de l’envie égocentrique. Contrairement au désir, l’envie est anxiogène et toujours accompagnée de force et de tension. On s’accroche. Lorsqu’un désir n’est pas assouvi, cela entraîne une frustration puis on passe à autre chose. Lorsqu’une envie n’est pas rassasiée, cela conduit à une frustration intolérable, un vide, une souffrance notable et souvent des réactions de violence relationnelle.
L’attachement consiste à vouloir, à orienter les choses, à se lier à l’objet d’amour, à le conditionner, à ne pas vouloir le perdre et à s’attendre qu’il dure éternellement. Le plus souvent on est en activité pour le futur afin que la situation devienne ce qu’on veut qu’elle soit. L’attachement consiste à ne pas supporter que les choses soient différentes de la façon dont on les a imaginées. C’est donc une intolérance à la frustration. Il y a attachement lorsqu’il y a intérêt personnel, égocentrisme, anxiété, excès, maîtrise et contrôle, projection dans le futur et ignorance totale de l’impermanence.
.Au sujet des objets d’attachement, celui-ci se fixe sur ce qui nous sécurise, ce que nous savons de nous, nos attentes, nos valeurs, nos considérations, nos images mentales et notre petit moi.

Il s’arrime à ceux qui nous étayent : nous reconnaissent, nous confirment et nous consolident tels que parents, amis, amours, conjoint, enfants… Il saisit des qualités qu’on aime et qui semblent nous revaloriser comme abnégation, amitié, amour, santé ou traits de personnalité. L’attachement offre seulement pour que les avantages lui reviennent plus nombreux en retour.
Il s’accroche également sur des poisons auxquels on tient comme à de vieilles habitudes qui nous personnalisent, tels tristesse ou souffrance, jalousie, impulsivité, regard d’autrui, timidité, peurs et doutes, flegme, boulimie, sexe, tabac, alcool, maladie, etc. A l’inverse de l’Être et de l’intégrité, il se lie aussi bien à l’Avoir qu’à l’Agir : attachement à des biens matériels, à son patrimoine, à des personnes, protection des autres, envies de faire plaisir ou d’aider, engagement dans une cause humanitaire ou sociale, etc.
En fait il se scelle aux besoins psychologiques fondamentaux : plaisir des sens, communication, sécurité, reconnaissance, opinions et valeurs, appartenance, superstitions et rituels, croyances, attachement à un soi. Or chacune de ces notions est contestable ou révisable. Par exemple, la sensation de sécurité diffère d’un individu à un autre ; ce qui parait juste pour l’un ne l’est pas pour l’autre ; les besoins de reconnaissance sont rapidement satisfaits pour les uns et jamais pour les autres et, d’une manière générale, on ne sait jamais bien pour chacun ou commencent et finissent ces notions. Où fixons-nous la satiété ?
La philosophie bouddhique parle de quatre types d’attachement : attachement sensuel, attachement aux opinions ou aux conceptions erronées, attachement aux croyances et rituels, attachement à la personnalité ou à l’idée d’un moi.
Si je suis attaché à mes amours ou à mes enfants, ce n’est pas leur bien que je veux mais le mien.
Si je suis attaché à des concepts ou à des idées, cela pourra être source d’auto-souffrance et je pourrais être considéré comme personne psychorigide, sans dire que des événements pourront les démentir.
Si je suis attaché à ma santé, je ne supporterais pas les tensions, les symptômes ou les douleurs, je voudrais les fuir immédiatement et c’est le meilleur moyen de leur donner de l’importance ou de les renforcer. Si je refuse absolument ma tension douloureuse ou ma dépression, que je veux en sortir immédiatement, je ne suis pas prêt à voir ce qu’elle cherche à exprimer, c'est-à-dire ce qui se cache en amont et qui l’amène.Je peux être attaché à ma souffrance chronique pour au moins trois raisons. Soit j’y trouve bénéfice dans l’empathie et l’intérêt des autres à mon égard, soit elle me caractérise depuis de longues années et constitue véritablement un pan de ma personnalité. Or pour l’ego, rien n’est pire que l’inconnu et l’incertitude changement. En tant qu’humains, le changement nous inquiète toujours. C’est pourquoi on peut être attaché à sa souffrance. Ce n’est surement pas très rationnel mais ce n’est certainement pas le rationnel qui nous gouverne (Récemment j’ai écrit un article intitulé Pensées folles ou folie cohérente ?).
L’attachement à la souffrance peut être aussi une manière de me singulariser ou de me définir. Je peux bâtir toutes mes relations autour d’elle : devenir bourreau ou terroriste, partir en croisade idéologique, me marier avec une infirmière, côtoyer médecins et sauveurs, œuvrer dans l’humanitaire, devenir psychologue… Lorsque je m’aperçois que c’est un jeu psychologique qui cache des motivations égocentrées devenant conscientes, je peux tout chambouler y compris mon couple et mes relations. La conscientisation crée une prise de recul, on voit que ce n’était pas juste. Les conséquences font peut être souffrir les autres mais mettent de la justesse et de la clarté pour tout le monde.On confond souvent amour (vers l’Autre) et attachement (vers soi). Dans les relations, l’attachement vient contaminer l’amour pour les raisons ci-dessus décrites. Il mène à la possessivité, à la perversité (déviation du but ou de l’objet) et à la jalousie. Il y a certaines personnes qu’on ressent comme des aspirateurs d’énergie. On se sent aspiré, pénétré, bouffé par elles et notre premier réflexe est de nous en distancier.
L’attachement est une énergie plus tournée vers soi que vers l’autre. Donc ce n’est pas de l’amour.
Ce serait plutôt une énergie destinée à combler un manque, une envie de contrôle, de maîtrise sur les choses ou les gens, une envie de toute-puissance et, dans le pire des cas, une recherche inconsciente de confirmation de l’échec et de sa nullité personnelle. Dans l’attachement, on aime seulement nos perceptions et nos projections (Lire : Aimez-vous une sirène ou une chimère ?). C’est une tension avide, une soif centrée sur le manque et la mort plutôt qu’un plaisir joyeux articulé autour de la consommation et la pleine jouissance de la vie.
« Faisons la distinction entre le véritable amour et l'attachement. Le premier idéalement, n’attend rien en retour et ne dépend pas des circonstances. Le second ne peut que changer au gré des évènements et des émotions ». Tenzin Gyatso, XIVeme dalaï lama..
.
L’attachement mène à la conséquence directe de perdre la liberté de soi et de l’autre. Saisir les choses condamne la liberté de mouvement. Lorsque je promène mon chien, je perds l’usage d’un bras : celui qui est attaché à la laisse. Si on me confie dans la rue une mallette de billets de banque, je ne vais plus penser qu’à elle et à sa sécurité, je vais donc perdre ma liberté de penser et d’agir.
Problème d’accoutumance et de conditionnement, l’attachement est comme une drogue, il voile l’esprit et réalise un filtre sur la conscientisation..
Le fait de s’attacher fixe, condamne les choses. Plus on saisit, plus on entrave le libre court naturel, plus on bloque les choses et plus elles nous échappent. Tout change, tout mute, tout est en perpétuel mouvement à l’instar des poussières qui volent dans le rai de lumière traversant une pièce. J’aime un être cher et suis attaché à cet amour, sans me rendre compte qu’il change, qu’il mute, qu’il vieillit, qu’il se transforme. Il change d’idées et de cellules à chaque seconde et moi aussi. A un moment, je vais m’apercevoir que cet amour n’a plus rien à voir avec celui du premier mois et l’attachement va cisailler carrément la relation. Notre attitude va toujours provoquer quelque chose chez l’autre. Je vais exiger qu’il reste ou redevienne comme avant.Qu’il se fixe sur poisons ou qualités, l’attachement nie le caractère impermanent des phénomènes et de la vie séquentielle, cache toujours au moins un voile de la conscience, une motivation plus ou moins égocentrique et une méconnaissance de soi qui finiront toujours par desservir de façon relativement douloureuse ou désastreuse. S’attacher, c’est vivre avec des œillères, rivé sur son besoin et fermé à l’accueil du mouvement de tous les possibles.
Le corollaire de l’attachement est donc la souffrance, toujours issue de l’attachement et à ne pas confondre avec la douleur. La douleur est le fruit de la vie ; la souffrance est le fruit de l’ego.
L’attachement entraîne souffrance par l’anxiété de perdre et la force anxiogène qu’il suppose. La souffrance à la séparation ou à la perte d’un objet ou d’une personne est à hauteur du degré d’attachement.Comme si on était encore petit enfant, on s’attache à quelque chose de toujours extérieur à soi car on l’assimile au bonheur. Nous sommes attachés à notre bonheur, c’est donc un attachement pour soi, conférant à la notion de propriété. Nous ne voyons absolument pas que le bonheur repose uniquement sur nous-mêmes, sur la façon dont nous utilisons notre tête et aucunement sur les objets ou personnes extérieures.
En nous rivant au passé, l’attachement n’est qu’une chimère qui nous promet le bonheur futur mais qui nous guide inévitablement au malheur à court ou moyen terme. Vous vivez bien avec votre compagnon. Imaginez maintenant lui annoncer que vous partez en week-end sans lui, seule pour vous ressourcer, avec des amies pour faire du ski ou en groupe de développement personnel. La vie avec lui change soudainement. Votre compagnon devient insupportable, fait son cirque en alternant reproches, moralité, jalousie, exigences et chantage.
Quand on est collé et que la personne dépendante est attachée tout va très bien, mais dès que le lien se distend rien ne va plus et se révèlent les vraies qualités d’Être. Envisagez une fin brutale avec la personne qui partage votre vie : l’attachement vous plonge dans la douleur. Dans ce cas, les voici à peine séparés que certains se précipitent dans un nouveau coup de foudre destiné à combler leur vide. Je n’appelle pas cela de l’amour d’autrui mais seulement de la préoccupation égocentrique de soi.
En cas de deuil, la souffrance est terrible. Lorsqu’on perd un être cher, on ne peut pas dire qu’on souffre pour lui. Cette souffrance est inutile et peut être contournée en travaillant les antidotes à l’attachement. Comme pourraient dire les japonais en 2011, suite aux séismes, au tsunami et à ses conséquences nucléaires, « inutile de rajouter de la douleur à la douleur ».
Donc, comme indiqué quelques paragraphes plus haut, l’attachement n’est pas de l’amour.L’antidote à l’attachement est la générosité. L’essence de la générosité est le non-attachement qui confère aux notions de partage et de lâcher-prise. Dans le non-attachement il y a non attente, l’esprit est placé dans l’ici et maintenant, libre donc les possibilités d’ajustement à ce qui se passe sont multiples. Il ne s’agit pas d’être détaché ou indifférent, soumis ou résigné mais de quitter les attachements afin de redevenir libre et ce n’est pas la même chose. Dans la générosité, il y a l’empathie qui consiste à ressentir ce que l’autre ressent et la compassion qui réside en le désir d’aider ceux qui souffrent.
Quand il n’y a plus d’attachement il y a éveil, on devient un(e) Saint(e) ou un(e) Bouddha, qualités qu’on détient tous en nous mais qui sont rapidement recouvertes par des tendances préjudiciables.Qui ne possède pas ne perd rien mais jouit de tout.
Plus on relâche l’attachement plus l’Amour est grandiose. La bonne nouvelle est qu’on peut changer. La mauvaise est que personne ne le fera à notre place et que faire à la place d’autrui est invalide.
Vous saurez véritablement aimer et savourer lorsque vous serez autonome (Lire : L’autonomie), prêts à perdre l’objet ou l’être cher, ce qui est inévitable. A ce moment, vous pourrez prendre véritablement soin de la relation, et vous réjouir de chaque moment dans la plénitude de l’instant présent.
« Ceux qui s'aiment avec maturité se libèrent mutuellement, ils s'aident à détruire toutes sortes de liens factices, d'attachements. L'amour qui est donné avec la liberté devient un art. » Bahgwan..

Par Eric Brabant
Gestalt Thérapeute et Formateur
Toulouse, France
| Voir ma page Psycho-Ressources |. votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 09:34
article issu de : http://psychoenfant.jimdo.com/pourquoi-aller-chez-le-psy/eloge-de-la-frustration/
Éloge de la frustration

Armand a 2 ans. Il est 21 heures et le rituel du coucher est bien parti pour durer une bonne partie de la soirée. Armand a voulu finir son jeu de construction, ce que sa mère a accepté pour éviter une crise. Il a ensuite demandé une histoire que son papa lui a lu avec plaisir puis une deuxième que son papa lui a lu pour éviter la crise. Armand semble prêt à accepter de s’endormir sous réserve que sa mère reste allongée près de lui, ce qu’elle fait depuis qu’il est tout petit. Ce soir, la mère fatiguée, refuse, ce qui déclenche « la crise ». Armand pleure, hurle, se tape la tête, se relève, « s’étrangle de rage », donne l’impression qu’il va vomir. Les parents sont anxieux, la mère craque et accepte de se coucher près de lui pour qu’il s’endorme. Une demi-heure après, « le petit ange » dort. Il est 22h30. Les parents, fatigués, vont eux-mêmes se coucher sans avoir eu de temps pour se retrouver. Une ou deux fois dans la nuit, Armand se réveille, hurle parce qu’il a perdu sa tétine, veut des bras réconfortants puis se rendort. Vers 7 heures, il est debout, exigeant sur le champ, son biberon puis quelqu’un pour jouer avec lui. Ce scénario qui se répète presque toutes les nuits depuis des mois, génère des tensions dans le couple mais également une fatigue et un ras-le-bol qui s’expriment parfois par des cris et gestes brutaux envers Armand. Ces parents qui aiment leur enfant plus que tout, sont choqués de sentir monter en eux cette violence à son égard et culpabilisés de leur impuissance et de la perte de contrôle de leurs gestes. Ils décident donc de consulter un psychologue...
Les parents débordés par leurs enfants, entre 1 et 5 ans, sont de plus en plus nombreux. Des enfants qui, comme le témoignent les nombreux articles, ouvrages ou émissions sur ce sujet, malmènent les parents qui, épuisés et las, cèdent souvent devant leurs exigences. La fréquence de ces situations interroge d’autant plus que l’on observe également un désarroi des professionnels de la petite enfance, en crèche et à l’école maternelle, face à des enfants agités, hyperactifs et allergiques à la frustration. Cette évolution dépasse les problématiques individuelles et s’inscrit dans un mouvement global de société qu’il importe de comprendre afin de redonner aux parents et aux adultes, de façon plus générale, la capacité de guider et de contenir enfants et adolescents.
Des parents si bienveillantsNotre société a fait un travail considérable pour informer les parents des besoins du bébé et favoriser ainsi la bientraitance des tout-petits. La majorité des couples ont moins d’enfants, les font plus tard et par choix. Ils s’en occupent avec attention, amour et tendresse et s’inquiètent de leur développement physique et intellectuel. Ils se préoccupent des conséquences sur leur psychisme d’une séparation, de l’arrivée d’un cadet, de la mort d’un proche, achètent des ouvrages sur le sujet et n’hésitent pas à frapper à la porte d’un psy si besoin. Cet accueil attentionné du bébé lui procure une enveloppe protectrice et chaleureuse, fondement de l’estime de soi et de la confiance dans la vie. Tous les clignotants semblent donc au vert pour que l’enfant se développe bien. Et pourtant, cette attention ne suffit pas. Après une première année, fatigante mais enchantée, l’ambiance se gâte. L’enfant commence à marcher, son territoire s’agrandit et sa capacité à explorer et à communiquer également. Les parents sont émerveillés de ses progrès et de sa volonté à vouloir faire « tout seul » et à choisir. Le monde s’avère un terrain d’aventures terriblement excitant mais également effrayant… Du coup, l’enfant oscille entre la protection (maman, doudou, tétine, biberon…) et la nouveauté (jouets, personnes, lieux…) : il veut grandir et rester bébé. Pour tenter de concilier les joies de l’exploration avec la sécurité de la matrice, l’enfant cherche à soumettre son entourage. Progressivement, les parents, qui étaient au service de façon juste et adaptée aux besoins du bébé, se retrouvent sous l’emprise de l’enfant qui impose ses désirs et ses refus avec une puissance déconcertante. En effet, si ses progrès sont bien réels, l’enfant reste cependant très dépendant de ses pulsions et ce que les parents interprètent comme de l’autonomie ressemble plutôt au désir de dominer le monde. Les dégâts occasionnés ne sont pas négligeables : d’un côté, des parents qui s’inquiètent, s’épuisent et se culpabilisent, de l’autre côté, l’enfant qui, comme nous allons le voir, est freiné dans son développement psychique et relationnel.
La frustration : étape incontournable
Pourquoi tant de parents, en bonne santé physique et psychologique, sont-ils actuellement malmenés par ces « bouts de choux » ? Parce qu’ils se refusent à utiliser la contrainte, de peur de blesser l’enfant, voire de le traumatiser. Toute injonction ou pression envers l’enfant leur rappelle l’autoritarisme des générations précédentes dont ils redoutent les dégâts psychiques et physiques. Respectueux de leur enfant, ils sont émus par ses pleurs et ses cris et tentent de lui atténuer les épreuves. Ils interprètent comme une souffrance insupportable ce qui n’est le plus souvent qu’une frustration que l’enfant est capable de traverser. Rechignant à s’imposer en force, les parents cherchent à se faire entendre en utilisant d’autres leviers plus compatibles avec leurs valeurs. Ils tentent de raisonner l’enfant : ils expliquent une fois, deux fois, dix fois, en espérant que l’enfant comprenne et donne son assentiment avec le sourire. Leurs demandes prennent d’ailleurs souvent cette forme : « tu va faire … parce … D’accord ? ». Le « D’accord ? » final signe la demande d’acquiescement et laisse la porte ouverte au désaccord : « « Non », peut répondre l’enfant, pour qui la logique du discours a bien peu de poids face à un psychisme gouverné par le principe du plaisir immédiat. L’enfant choisira toujours ce qui est le plus facile, le plus accessible parce qu’il n’a pas encore la capacité à intégrer les bienfaits à long-terme que cette frustration immédiate pourrait lui procurer. Autre piste pour se faire entendre : l’empathie. Les parents espèrent que l’amour qu’ils éprouvent pour leur enfant l’incitera à en faire preuve à son tour. Las, le petit enfant est encore bien incapable de se mettre à la place de l’autre. Il commence tout juste à sortir de la fusion émotionnelle qui le relie à sa mère, découvre le puissance du « Je » et est nécessairement égocentrique. Ces tentatives de s’appuyer sur la raison et sur l’amour pour éviter la frustration et la crise qui en découle se révèlent donc peu efficaces. Elles s’achèvent souvent par la victoire de l’enfant qui obtient ce qu’il veut ou à l’inverse, par une perte de contrôle de l’adulte qui s’impose violemment. Dans les deux cas, l’adulte éprouve de la culpabilité et du découragement et l’enfant peine à grandir.
L’adulte qui cherche à épargner l’enfant, l’empêche de trouver sa force intérieure et de devenir le héros qui « survit » aux frustrations, séparations et autres épreuves de la vie. Ce souci de protéger l’enfant se transforme alors en nasse affective dans lequel l’enfant est retenu inconsciemment dans le nid. Ce qui donne cet étonnant mélange d’enfants qui développent une bonne estime d’eux-mêmes (ils se savent aimés et ont conscience de leur valeur) mais deviennent de jeunes adultes ayant peu confiance en eux face aux épreuves et difficultés.En confondant autorité et maltraitance, les adultes se privent d’un levier essentiel au développement de l’enfant : un ordre et des règles qui, parce qu’ils frustrent, obligent l’enfant à passer progressivement d’attitudes égocentriques, propres au bébé, à des attitudes plus élaborées, qui prennent en compte son avenir et le collectif. Dès lors, la question essentielle, pour les parents, n’est plus d’éviter à l’enfant toute frustration mais de trouver des repères les aidant à différencier la frustration qui fait grandir de la souffrance destructrice.
Différencier frustration et souffrance
La souffrance se confond avec la frustration car les symptômes sont proches : cris, pleurs, bras tendus pour demander de l’aide… qui sont comme des signaux d’alarme, invitant le parent à réagir. Comment les distinguer ?
La souffrance naît d’une épreuve (accident, maladie, échec, agression, humiliation, rejet) qui dépasse les capacités d’intégration de la personne. Elle est accentuée lorsque l’entourage, qui est censé protéger, ne la voit pas, la nie ou, plus grave encore, est la source de souffrance, comme c’est le cas dans des situations de maltraitance, d’harcèlement et d’inceste. Vécue dans la solitude, l’impuissance ou la honte, elle atteint profondément la personne et nécessitera un accompagnement et des soins pour permettre à la personne de retrouver une estime d’elle-même et une confiance dans la vie.A l’inverse, la frustration est l’expérience d’un manque, d’une limite qui est à la hauteur des capacités de l’enfant. Elle l’oblige à quitter le principe de plaisir immédiat, privilège du tout-petit pour traverser la difficulté en s’appuyant sur ses propres ressources. Elle est parfois imposée par la vie comme, par exemple, l’impossibilité financière des parents à pouvoir offrir à leurs enfants ce qu’ils désirent (Heureuses familles où la frustration est incontournable…) mais le plus souvent ce sont les parents qui doivent assumer de frustrer en appliquant des règles de vie qui semblent répondre aux besoins et capacités de l’enfant (sommeil, nourriture, jeux, rythme, propreté..). Ces règles donnent à l’enfant des repères, fixes et donc fiables, qui canalisent sa vitalité impulsive. Elles sont comme un mur d’escalade dont le niveau de difficulté correspond à l’âge de l’enfant. L’adulte guide et protège l’enfant tout en l’incitant à traverser ses peurs et à trouver ses points d’appui qui l’aident à s’élever. L’enfant ne peut modifier le mur d’escalade et doit s’en sortir avec les prises qui sont là. C’est ainsi qu’il intègre et intériorise le « principe de réalité » qui est une phase normative structurante car elle lui permet de se dépasser. C’est grâce à cette intégration des règles posées par ses parents, qu’il pourra ensuite, grâce à sa réflexion, questionner l’intérêt de ses règles, les négocier et proposer des alternatives.
Pour frustrer de façon éducative, les adultes doivent donc évaluer les capacités de l’enfant, imposer et contenir sans violenter mais aussi remettre en question les règles posées pour qu’elles restent justes et adaptées aux besoins de l’enfant.
Evaluer les capacités de l’enfantLe désir de protéger son enfant et la peur de le traumatiser incitent parfois les parents à sous-estimer les capacités psychiques de leur enfant à s’en sortir sans eux… C’est pourquoi, il est important que les parents puissent échanger entre eux, avec d’autres parents ou des pédiatres ou pédo-psychiatres pour mieux cerner si leurs demandes et exigences correspondent aux capacités physiques, cognitives, émotionnelles des enfants de cet âge. Savoir que l’enfant est capable de traverser la difficulté aide le parent à tenir même si l’enfant hurle son incapacité à le faire….
Frustrer l’enfant ne veut pas dire devenir psychorigide : certes, l’adulte a la responsabilité de poser le cadre et les règles répondant au mieux aux besoins de l’enfant et à ses propres besoins, mais, à l’intérieur de ce cadre auquel il ne déroge pas, il peut laisser un peu de marge de manœuvre à l’enfant et éviter ainsi de s’enfermer dans un duel. Par exemple, l’enfant peut choisir entre lire telle ou telle histoire (mais pas les deux), mettre tel ou tel vêtement (mais un vêtement de saison), manger la purée puis le dessert ou arrêter le repas là…. C’est ainsi qu’il développe progressivement sa capacité à articuler la gestion de la frustration et l’exercice de la liberté.
Frustrer et contenir sans violenter
La frustration entraîne parfois des crises spectaculaires (cris, pleurs, vomissements, coups…), tentatives désespérées de faire pression pour obtenir ce que l’on veut, mais également décharge énergétique face à l’impossibilité d’obtenir satisfaction. La crise n’est pas en soi un problème, l’entourage doit simplement éviter que l’enfant ne se blesse, ne blesse autrui ou ne mette en pièces son environnement. Gérer la frustration, ça s’apprend, comme marcher, parler ou lire… L’enfant s’y reprend à plusieurs fois et on a besoin d’être guidé et entouré. Il traverse une épreuve difficile, point n’est besoin d’en rajouter en le frappant, le brutalisant ou l’humiliant. Expliquer ou chercher à entrer en relation n’est pas non plus pertinent car l’enfant, sous l’emprise de l’émotion, n’entend plus rien et n’est pas accessible à la raison. En revanche, la présence calme et bienveillante de l’adulte qui accueille l’émotion de l’enfant avec empathie sans pour autant céder, ne génère ni refoulement ni traumatisme, mais à l‘inverse, augmente la confiance en soi.
Si cette crise est insoutenable pour l’adulte, au point qu’il risque de céder ou de basculer dans la violence physique ou psychique, il est préférable qu’il s’éloigne, en passant le relais à un autre adulte, ou en occupant son esprit à autre chose. En prenant de la distance, il sort de l’emprise psychique dans laquelle il est et aide l’enfant à faire de même.Adapter les règles et les faire évoluer
Toutefois, contraindre l’enfant et obtenir qu’il obéisse, n’est qu’une étape dans le développement mais n’est, bien évidemment, pas le but ultime. Au fur et à mesure qu’il intègre la capacité psychique à gérer les frustrations, il est important d’inviter l’enfant à questionner le sens et la justesse des valeurs sous-jacentes aux règles. C’est la fonction d’instances formelles tel le « conseil de famille », qui de façon régulière et cadrée, permet d’évoquer et de gérer les désaccords, d’écouter et de consulter les enfants et de faire évoluer les règles. Les désaccords sont parlés, le sens des règles est réexaminé, et chacun est invité à proposer des solutions susceptibles de respecter les valeurs et besoins de chacun. Il ne s’agit pas pour autant de tomber dans la confusion actuelle qui voudrait que la démocratie annule toute hiérarchie et différence de statut alors qu’elle invite uniquement à l’égalité des droits et au respect de chacun. Le parent a un statut qui lui confère une responsabilité envers l’enfant et donc le droit et même parfois l’obligation de le contraindre. L’enfant, de son côté, a le droit d’être protégé, voire retiré à ses parents, si ceux-ci le maltraitent ou le négligent.
En conclusion, les parents, qui frustrent leur enfant, dans les conditions énoncées ci-dessus, ne sont ni autoritaristes, ni maltraitants. A l’inverse, ils assument l’inconfort d’être temporairement détestés par leur enfant qu’ils privent d’un plaisir immédiat. Cette fermeté bienveillante offre une structuration psychique à l’enfant, qui lui permettra de faire face aux turbulences pulsionnelles et émotionnelles de l’adolescence, de façon plus sereine et moins réactive.Véronique Guérin, psychosociologue, auteure de « A quoi sert l’autorité ? » et réalisatrice du DVD « je pleure ou je tape ? le développement relationnel de l’enfant de 0 à 3 ans ».
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 09:27
article issu de : http://lesvendredisintellos.com/2014/09/20/viens-que-je-te-croque-ou-un-enfant-qui-mord/
Je me suis intéressée au sujet de l’enfant qui mord suite aux morsures infligées par M.. Sur mon blog je raconte mon voyage dans le monde des morsures. Dans notre famille de trois, la non-violence éducative fait partie de nos valeurs. On ne veut pas le punir, on ne veut pas le frapper, on ne veut pas l’engueuler… mais on ne veut pas qui morde ! Il a mordu* et une moijesaistout a sifflé « il faut qu’ils le punissent !« ,
Je m’interroge donc sur ce cas pratique : l’enfant et la morsure. Est-ce que nous sommes des mauvais parents puisqu’il mord ? Est-ce qu’on doit accepter qu’il soit une terreur ? Va-t-on être obligé de le punir pour qu’il comprenne ?
Non, non et non ! Ce n’est mon humble avis de maman avec un premier enfant et les neurones en ébullition, mais non, nous ne sommes pas des mauvais parents. Mordre est un geste non tolérable mais naturel, ça arrive. Ne pas le diaboliser ni le banaliser ! A nous de lui montrer d’autres façons de gérer cet excès de frustration / colère. Non M. n’est pas une terreur. Parfois ce petit garçon par ailleurs adorable n’arrive pas encore à communiquer autrement mais ça viendra. A nous de l’accompagner. Et non on n’est jamais obligé d’utiliser la violence pour contrer la violence.
Si mon chef et des copains m’ont dit « Mords-le, y’a que comme ça qu’il comprendra » et « S. aussi à mordu, dès que B. le papa l’a mordu, elle n’a plus jamais recommencé », est-ce que la littérature nous donne d’autres pistes, notamment non-violentes ?
Sur Internet, les sites de parentalité type doctissimo, infobebes, magicmaman… ont tous un billet dans le genre « Que faire si notre enfant mord ? », « L’enfant qui mord », « Au secours, mon enfant mord », « Pourquoi un enfant mord ? »… Trois catégories de conseils : trouver et comprendre les causes de la morsure, réagir face à son enfant qui mord et comment l’empêcher de mordre de nouveau.

1. Comprendre les causes de la morsure
L’âge a son importance : mordre à un an ou mordre à 8 ans n’a pas la même explication.
Autour d’un an, un bébé teste sa mâchoire et les effets de ses morsures sur les objets… et les êtres vivants.
Puis après 2 ans (ça dépend des enfants car M. a 14 mois est déjà dans cette phase) Doctissimo nous dit : « pour attirer l’attention, défendre son territoire, obtenir ce qu’on lui refuse, manifester sa colère ou, plus étonnant, une pulsion d’amour. » Idem chez Magic maman qui nous parle de la « phase d’opposition« .
Une explication « à la Freud » se trouve sur le site d’une psychologue de Nice : « Avec sa bouche, l’enfant non seulement mange mais pense » ou encore de e-santé « l’enfant est encore au stade dit « oral », c’est-à-dire qu’il appréhende le monde par sa bouche. Certains décrivent l’envie de mordre comme le « stade oral sadique »« . Sauf qu‘Isabelle Filliozat nous dit bien que « « phase orale », implique une dimension psychanalytique très importante, qui selon Freud est relative à la jouissance et au pouvoir. Comme si l’enfant était un pervers polymorphe ! Il faut cesser d’utiliser cette expression de « phase orale », elle nous enferme dans une vision psychanalytique totalement erronée. Elle sous-entend que l’enfant a une jouissance à utiliser sa bouche, qu’il cherche à prendre le pouvoir. Tout cela est complètement faux.«
Dans la même dynamique « l’enfant est foncièrement méchant », seul un pédiatre est convaincu « Mord-t-il ses parents sans le faire exprès ? Evidemment NON !« . Je ne partage pas son point de vue et me conforte dans celui d’Isabelle Filliozat sur les enfants qui mordent ou tapent : « pas de méchanceté », « pas une décision consciente mais une prise en charge corporelle de son expression » (J’ai tout essayé, p88)
Beaucoup d’auteurs convergent vers l’idée que l’enfant ne mord pas volontairement pour faire mal.
Naître et grandir donne une liste exhaustive de ce qui peut pousser un enfant à mordre : « il est en colère, il veut reprendre un objet ou il convoite le jouet d’un autre, il est fatigué, il le fait pour s’amuser, sans mesure sa force, il vit un évènement stressant, il veut attirer l’attention des adultes, il se défend, il sait que c’est un moyen efficace d’obtenir ce qu’il veut, il est dans un environnement qui ne lui convient pas, il a été témoin ou victime de geste agressifs ».
Comprendre est une chose. Mais quand ça arrive…

2. Réagir face à son enfant qui mord
Dans le cas pratique « l’enfant qui mord » (p146), Catherine Dumonteil Kremer dans « Une nouvelle autorité sans punition ni fessée » nous confie son expérience : « quand mon enfant en agresse un autre, cela blesse deux personnes : l’enfant et le parent présent. Il y a donc deux victimes à écouter. J’écoutais l’enfant blessé […] pour qu’il se sente reconnu : « Montre-moi, oh elle t’a fait mal ! » Je m’excusais auprès des parents de l’enfant concerné ; j’écoutais les sentiments qui les traversaient à ce moment-là. Cela me demandait beaucoup d’énergie, mais c’était très efficace. »
Oui ne pas s’emporter contre son enfant alors que le parent du mordu est agacé demande de l’énergie et de la maîtrise de soi. On a envie d’hurler « non mais ça va pas non ?! faut pas mordre » et que l’enfant « obéisse ». Rester calme soi-même est la première étape et ce n’est pas la plus simple. Mais avec de l’entraînement, ça fonctionne.
De nouveau j’apprécie les pistes de Naître et grandir. En voici quelques unes :
« Prenez tout d’abord soin de l’enfant qui a été mordu et consolez-le. Si votre enfant a mordu pour attirer votre attention, il verra que ça ne fonctionne pas […]
Veillez à ce que personne ne rie […]
Evitez les longues explications. Essayez de lui expliquer les conséquences de son geste avec des mots simples « Regarde, tu lui as fait mal. Elle pleure. » […]
Incitez l’enfant qui a mordu à réparer son geste […] Ne demandez pas à votre enfant de faire un câlin à sa petite « victime » pour le consoler. L’enfant mordu n’en a probablement pas envie.
Ne dites pas […] « tu es méchant » ou « tu es un bébé » car elles peuvent nuire à son estime de soi
Si votre petit mord de nouveau, éloignez-le immédiatement des autres enfants […] »Concernant la réparation, c’est un geste que l’on suggère à chaque expérience malheureuse. Dernièrement, M. m’a remordue pendant une tétée alors que ça faisait plusieurs mois qu’il n’y avait plus eu de souci. J’ai crié par réflexe. Il est parti en courant et est revenu avec un pansement en me disant « bobo »… Même si j’ai trouvé le geste super mignon, je me suis forcée à rester « neutre » en lui disant « merci » suivi des explications concernant les conséquences de son geste.
Le pédiatre sus-cité insiste sur un « non convaincant » et propose le retrait ou la rupture : « Dire le mot NON ne suffit pas, il faut le dire avec CONVICTION. Avec la mimique qui va avec, les gros yeux, le visage mécontent, et sans montrer de faille, ni de désir de ne pas se fâcher. Dans le bain affectif chaleureux de votre famille, vous êtes en droit de vous fâcher (momentanément) avec votre enfant et de vous séparer de lui en le mettant dans sa chambre derrière une porte fermée.
Se fâcher c’est se séparer de l’enfant momentanément. Se fâcher ainsi c’est montrer à votre enfant que vous êtes convaincu de votre idée ( je ne veux pas que tu tapes), que vous avez confiance dans le lien affectif qui vous relie à lui, et que vous savez qu’il y aura évidemment réconciliation par la suite.
Cette attitude qu’on appelle « faire la rupture », est très bien comprise de lui si elle est motivée par une raison claire (ne pas taper ni mordre), et cohérente (refaite si l’enfant recommence). Elle est très bien reçue et se montre très efficace, contrairement à l’absence de réponse laissant l’enfant dans un vide angoissant et le conduisant vers la surenchère.
Quelques minutes plus tard, votre enfant s’étant calmé derrière la porte, vous retournerez dans sa chambre et le trouverez tout gentil, affectueux et au fond de lui serein : il a aura eu la réponse qu’il attendait. »
Coup de pouce va dans le même sens : « On peut aussi mettre l’enfant en retrait sur une chaise à raison d’une minute par année d’âge en lui disant simplement pourquoi il se retrouve là (ex.: « tu n’es pas habilité à jouer avec les amis parce que tu les frappes »)«Je parle de ces solutions pour citer de nouveau Catherine Dumonteil-Kremer, même livre, p. 186 :
« Avec les dernières découvertes sur les effets nocifs des fessées et des punitions, le time-out ou mise à l’écart est apparu comme une solution possible à toutes sortes de comportements indésirables des enfants. Comme il est bien difficile d’isoler un bambin qui ne veut pas l’être, l’immobilisation est aussi utilisée, de même que le retrait de l’attention du parent. […] C’est bel et bien une punition qui fait souffrir l’enfant. Rien n’est plus inquiétant pour lui que le retrait de l’attention et de l’amour de ses parents. L’isolement ne lui permet nullement de réfléchir et de prendre conscience. […] Un enfant qui est isolé rumine sa colère et son chagrin seul ; et va faire tout ce qui lui est demandé pour sortir de cet état où il se sent exclu de la famille.
Quand votre enfant est en proie à des émotions difficiles, il ne peut les gérer seul. Il est très important de l’accompagner, d’être solidaire […] »Il y a donc une solution intermédiaire entre autoritarisme (« va dans ta chambre ») et laxisme (« il a mordu, ce n’est pas si grave »). On essaie d’aller dans cette direction de « bienveillance », « parentalité positive » ou encore « discipline positive » mais nos réactions ne sont pas toujours comprises. C’est comme si l’absence de cri et de réponse violente était vu comme le fait qu’on n’accorde pas d’importance à la morsure. C’est une réponse différente mais valable et qui me semble efficace.
Après des morsures, je pouvais lire sur le visage de notre fils qu’il comprenait, même sans cri et sans punition que son geste n’était pas acceptable. Quelques jours après l’épisode de la « morsure tétée », il a pointé du doigt le sein qui avait eu « bobo » et m’a montré ses dents et m’a dit « non » en faisant « non » avec son index. Puis « bobo ». Le lien de cause à effet avait été compris.
Enfin, tous les sites sont d’accord sur un point : ne pas mordre en retour. Ce n’est que dans la vraie vie et sur les forums de vrais gens que j’ai entendu « mords-le ». Séquelles d’une éducation passée à la dure, autoritaire et violente ?
Deux raisons sont évoquées :
– ça n’empêche pas les tout-petits de mordre de nouveau
– l’enfant pourrait en déduire que ce comportement est acceptable puisque un adulte le fait. Nous sommes leurs exemples!Il paraît même que certains parents rinceraient la bouche de l’enfant au savon… mais ça ne va pas la tête ?
3. Eviter que l’enfant recommence
Catherine Dumonteil-Kremer, même livre, p. 145 propose l’observation et un objet sur lequel il ne risque pas d’abîmer ses gencives ou ses dents : « Je savais que cela risquait à tout moment de se reproduire, aussi me suis-je mise en mode surveillance rapprochée », de façon à intervenir avant la morsure. Empêchée de réaliser ses plans, ma fille pleurait ou trépignait, ce qui l’aidait à récupérer de la frustration éprouvée. Le problème a été résolu en quelques jours. Je lui ai proposé un objet à mordre, et lui ai même donné à titre préventif« .
Naître et grandir nous propose en plus de la vigilance :
– de se poser les bonnes questions : qui ? quand ? où ? dans quel contexte ? … pourquoi ?
– de valoriser l’enfant lorsqu’il pose un geste positif
– de l’aider à nommer ses sentiments pour qu’il puisse mettre des mots sur ses émotions.Héloïse Junier, psychologue et journaliste rajoute de favoriser un recentrage calme de l’enfant : « Si vous sentez l’enfant particulièrement à fleur de peau ces derniers temps, n’hésitez pas à cultiver avec lui des activités apaisantes telles que la lecture, le chant, le dessin, les massages.«
Notre réaction à la morsure de notre fils citée en introduction a été de nous interroger sur pourquoi il avait mordu. On s’est rendu compte que tous les deux étions mals à l’aise au milieu de nos amis « en famille » (choix éducatifs très différents) et que si on avait pu les mordre… on l’aurait fait… Du coup on a décidé de partir le soir même au lieu du lendemain.

Et vous, si votre enfant s’est fait mordre, comment avez-vous réagi ?
Et vous, si votre enfant a mordu, comment avez-vous réagi envers lui et les autres ?
Vos témoignages m’intéressent grandement !Pour conclure, je vous souhaite de croquer la vie à pleines dents !
En bonus, d’autres articles des VI qui abordent plus ou moins ce sujet (que je vais maintenant lire plus attentivement car je ne voulais pas être influencée !) :
Retour sur les enfants mordeurs par deux psychologues cliniciennes Marie Léonard-Mallaval et Jaqueline Wendland
Retour sur les enfants mordeurs par Isabelle Filliozat
L’introduction de ce mini-debrief de Drenka
Tape, tape petite main de Chrystelle (sur le thème des coups et non de la morsure mais c’est la même thématique !)* et mordra peut-être encore, qui sait…
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 09:21
article issu de : http://www.les-supers-parents.com/interdits-frustrations-et-limites-ne-donnent-pas-un-sentiment-de-securite-interview-isabelle-filliozat/
NON ! Les interdits, frustrations et limites ne donnent pas un sentiment sécurité à l’enfant ! (Interview d’Isabelle Filliozat)
En pleine “relecture” des Fiches Outils que nous sommes en train de créer (principalement celles dédiées à la parentalité positive) et en pleine préparation d’une tournée de conférences, Isabelle Filliozat a quand même trouvé le temps de répondre à quelques-unes de nos questions de parents “imparfaits”, mais toujours aussi convaincus des bienfaits que peuvent apporter à nos enfants la démarche de parentalité positive !

Camille et Olivier de Supers Parents : Bonjour Isabelle, vous nous faites l’immense honneur de relire certaines des Fiches Outils que nous sommes en train de créer (notamment celles traitant de la parentalité positive)… et nous nous rendons compte que, malgré toutes nos lectures, nos formations, notre implication dans l’apprentissage de la parentalité positive… nous faisons encore beaucoup d’erreurs !
Comme beaucoup d’autres parents, nous sommes encore (selon vos termes) « trop enfermés dans le paradigme psychanalytique de la théorie des pulsions (Freud) » qui voit l’enfant comme une petit être tyrannique qu’il faut canaliser en lui imposant des règles et limites strictes. Comment en sortir une bonne fois pour toutes ?Isabelle Filliozat : Notre culture est si imprégnée de ces croyances et de ces habitudes de réaction qu’il me parait illusoire de se débarrasser de ces idées une bonne fois pour toutes. Nous avons à être vigilants sur cette tendance à interpréter les comportements des enfants comme dirigés contre nous. Mais au fur et à mesure que les informations scientifiques sur le fonctionnement du cerveau de l’enfant seront diffusées, je pense que cela changera radicalement notre perspective. Nos interprétations nous permettent de donner du sens à des réactions que nous ne comprenons pas. Or, Les neurosciences explorent le cerveau de l’enfant comme jamais avant. Nous n’en sommes plus réduits à devoir interpréter, nous pouvons décoder.
NON ! Les interdits, frustrations et limites que nous donnons à l’enfant ne lui donnent pas un sentiment sécurité. Et ne lui donnent pas non plus les « bonnes » bases de la socialisation. Passons sur cette connotation morale « bonnes » bases, ceci est le dada de la psychanalyse (française) avec sa théorie des pulsions qui a fait tant de mal à l’éducation des enfants.
Ce qui donne le sentiment de sécurité aux enfants, c’est l’attachement, l’attention du parent à ses besoins, le respect, etc… c’est aussi la liberté, les permissions et les consignes qui aident à savoir comment faire ceci ou cela en toute sécurité. Les seules limites qui donnent de la sécurité sont celles de l’enfant. Il se sent en sécurité si nous lui enseignons qu’il a des limites et qu’il a le droit de les faire respecter par ses frères et sœurs, par les gens, et même par nous. » Ton corps est à toi, et si ce qu’on te fait te fait non à l’intérieur, tu as le droit de dire Stop. », « ce stylo est à toi et si tu ne veux pas que ta petite sœur joue avec, tu as le droit de le mettre sur cette étagère en hauteur ».
Un interdit est toujours dangereux parce que le cerveau de l’enfant est un cerveau humain, c’est à dire avec un lobe frontal qui veut diriger ses propres comportements (donc risque de mobiliser de la rébellion). De plus, il est formulé en négatif le plus souvent et donne donc une mauvaise direction au cerveau de l’enfant.
Qu’est ce qui donne le plus de sécurité : “Il est interdit de courir sur la chaussée. Tu dois me donner la main en traversant.” Ou “Tu peux marcher et courir sur le trottoir, sur la chaussée, tu marches en me tenant la main.” ?
Il suffit de sentir le léger stress que nous éprouvons tous, les humains, lorsqu’on nous donne un ordre ou un interdit pour vérifier que cela ne nous met pas du tout en sécurité.
Rythme cardiaque accéléré = peur
Rythme cardiaque ralenti = sentiment de sécuritéA noter aussi : la liberté donne davantage de sécurité que les limites. Est ce que je me sens plus en sécurité si je dois lever le doigt pour demander la permission d’aller faire pipi ? Ou si je sais que j’ai la liberté d’aller faire pipi quand j’en ai besoin parce que c’est un besoin naturel, et que la consigne est que je préviens la classe et j’emmène avoir moi un copain ?
La sécurité, le plaisir, sont des conséquences de la satisfaction des besoins d’attachement et de liberté.
Camille et Olivier de Supers Parents : Un autre point est ressorti de nos échanges à propos des Fiches Outils : notre difficulté à différencier sentiments et émotions. Pourriez-vous nous expliquer les différences fondamentales entre les deux ?
Isabelle Filliozat : Une émotion est une réaction physiologique de l’organisme. Nos émotions nous aident à nous adapter à notre environnement. La peur nous permet de faire face au danger, la colère de protéger notre espace, notre territoire, de restaurer la justice et de réparer notre intégrité quand elle a été blessée. La honte nous maintient dans une certaine conformité au groupe auquel nous appartenons, et nous évite de blesser autrui. La tristesse est l’émotion de l’acceptation de la perte. La joie nous indique notre direction de vie et favorise l’apprentissage. L’amour nous rapproche les uns des autres. Les émotions sont universelles. Tous les humains les ressentent dans les mêmes circonstances. Les sentiments, eux, sont individuels et fonction de notre histoire. Un sentiment nécessite une élaboration mentale. Nombre de nos réactions émotionnelles (et de celles de nos enfants) ne sont pas des émotions, mais des sentiments ou des réactions émotionnelles parasites. Un enfant qui pleurniche par exemple parce que l’eau est trop chaude, puis trop froide, puis que la serviette ne couvre pas ses orteils… n’éprouve pas de la tristesse ! Il est dans une réaction parasite camouflant une autre émotion. En l’occurrence, de l’anxiété par rapport à l’école ! Eh oui, les réactions émotionnelles parasites n’ont souvent rien à voir avec le problème sous-jacent. C’est pour cela qu’elles sont incompréhensibles pour le parent et qu’il les classe un peu rapidement dans la catégorie « caprice ». Les caprices, c’est tout ce que l’adulte ne comprend pas.
Camille et Olivier de Supers Parents : Nous savons que l’émotion est au centre de votre expertise, notamment à travers votre « Ecole des intelligences relationnelles et émotionnelles », et nous sommes ravis de très bientôt passer le stage « la grammaire des émotions », dont un des objectifs est de guérir nos blessures d’enfant et de « nous libérer des émotions que nous retenons et qui nous détruisent ». La question que nous souhaitions vous poser depuis longtemps est la suivante : est-il possible d’entamer une démarche de parentalité positive sans avoir fait ce « retour sur notre propre enfance » au préalable ? Nous pensons notamment aux personnes qui ne peuvent (faute de temps ou d’argent) ou ne souhaitent pas faire cette démarche. Y a-t-il des pistes à suivre pour tenter de faire ce travail par soi-même ?
Isabelle Filliozat : Oh oui, il est possible d’entrer dans la parentalité positive sans guérir son passé ! Heureusement. Nombre de gens ayant lu un de mes livres ou même m’ayant juste entendu en conférence m’ont dit avoir cessé de frapper leur enfant ou de le punir et avoir radicalement transformé leur attitude et l’atmosphère familiale. Ceci dit, clairement, nous sommes parfois pris par notre passé, happés dans notre histoire à notre insu et cela déclenche des réactions excessives. Nous entrons dans des fureurs hors de proportion avec le problème ou sommes démunis devant une situation pourtant relativement simple. Dans ce cas, il est utile de commencer une démarche. Tous mes livres comportent des exercices, car il me parait important depuis toujours que chacun puisse s’approprier son chemin. Le livre « trouver son propre chemin » peut être un bon début.
Camille et Olivier de Supers Parents : Si la « guérison de nos blessures d’enfant » est la première étape de la démarche de parentalité positive, quels sont, selon vous, les suivantes ?
Isabelle Filliozat : La guérison de nos blessures d’enfant est une étape parmi d’autres. Pas forcément la première, comme je vous le disais ci dessus, on peut déjà avancer beaucoup sans avoir encore guéri. Le travail de guérison se fait au moment où l’on est prêt. Si l’on a été profondément blessé dans son enfance, ce peut être un parcours difficile et douloureux. La première étape, est pour moi de s’entourer. Avoir un bon réseau relationnel, des amis pour nous soutenir, des relais pour garder nos enfants, des copains et des copines pour nous donner des idées et partager des expériences… des gens autour de nous pour échanger, se nourrir, et tenir le coup face aux inévitables remarques des personnes « bien intentionnées » qui nous entourent et ne partagent pas notre vision de l’éducation.
Puis, il me parait important d’installer les nouvelles compétences une à une. Par exemple cette semaine, je m’exerce à l’écoute. La semaine suivante, je décris les situations… etc. Et dès qu’on se surprend à entrer dans un jeu de pouvoir avec l’enfant, se souvenir que nous sommes l’adulte et donc celui qui a la responsabilité d’en sortir ! Nous pouvons respirer profondément, relativiser l’importance de ce sur quoi nous nous disputons (mettre les bottes, l’assiette verte ou les devoirs) et nous souvenir de tout l’amour que nous portons à notre enfant. Nous pouvons commencer par lui faire un câlin pour remplir son réservoir d’amour et recommencer du début. Oh oh… on dirait qu’on se dispute là ! tu as vu ça ? On a du louper un truc. D’abord on se fait un câlin (ou une bagarre affectueuse sur le lit si la dispute était déjà bien avancée) puis on recommence et cette fois le parent pense à donner un choix ou à poser une question au lieu de donner un ordre.
Camille et Olivier de Supers Parents : Un autre point dont nous avons discuté : la difficulté, pour certains parents s’initiant à la parentalité positive… de partager cette philosophie avec leur conjoint. Quelle piste pouvez-vous proposer à ces personnes ?
Isabelle Filliozat :
1. Le non-jugement ! C’est efficace pour les enfants, mais aussi pour les adultes ! Un conjoint qui se sent jugé s’enfermera dans sa position.
2. L’empathie. C’est aussi à l’empathie que nous lui fournirons que notre conjoint pourra mesurer le non-jugement ! Faire une phrase du type : « J’ai vu combien tu étais énervé par le comportement de Julien, c’est dur de voir son fils rapporter de telles notes (être le plus précis possible) » ou « ça te met hors de toi de voir ton fils sur l’ordinateur alors qu’il n’a pas fini ses devoirs. » (Attention au ton de la voix, qui reste plein de tendresse, de respect et de compréhension… si, si…!)
3. L’écoute. Qu’est-ce qui est le plus dur pour toi quand il rapporte des notes inférieures à la moyenne / quand tu le vois sur son ordinateur…
4. Et écouter aussi le passé… et ton père, comment il réagissait quand… c’est en incitant le conjoint à faire le lien avec sa propre enfance, qu’on va vraiment l’aider à ne plus mobiliser le comportement excessif.
Il est fondamental de ne pas se sentir « supérieur » à l’autre, parce que nous aurions plus raison que lui, ou autre. Nous n’avons pas été plongés dans la même culture enfantine, nous n’avons pas eu la même expérience en tant qu’enfant. Voir notre conjoint enfermé dans un nœud dont il n’arrive pas à sortir seul peut nous aider à l’accompagner sans le juger comme incompétent, dur, méchant, laxiste…
Camille et Olivier de Supers Parents : Vous nous avez aussi évoqué le fait que des études récentes avaient prouvé que les « devoirs à la maison » n’étaient pas forcement bons pour l’apprentissage de nos enfants… pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Isabelle Filliozat : Oui, les devoirs non seulement n’aident pas l’apprentissage mais le ralentissent. Les devoirs consistent le plus souvent à faire des exercices sur des leçons apprises en classe. Or les enfants qui ont compris s’ennuient à faire des exercices dont ils ne perçoivent pas le sens. De plus quand on s’ennuie, on a tendance à faire des erreurs…
et les enfants qui n’ont pas compris vont buter, et se buter. Ils risquent de prendre des voies erronées pour tenter de répondre à la question posée et risquent donc d’installer de mauvaises habitudes.
Parce que les enseignants et les chercheurs en pédagogie savent que les devoirs n’aident pas l’apprentissage, en france, ils ont été interdits dans le primaire. Hélas la conviction devoir = succès est bien ancrée dans la tête des parents qui se plaignent quand le prof ne donne pas de devoirs !
les internautes qui désirent en savoir plus peuvent lire en anglais le livre très documenté d’Alfie Kohn The homework myth ou écouter sa conférence en ligne No grades + no homework = better learning.
Camille et Olivier de Supers Parents : nous profitons aussi de cet interview pour vous demander votre avis sur un des sujets « chauds du moment » : que pensez-vous de la réforme des rythmes scolaires en préparation ?
Isabelle Filliozat : C’est une minuscule réforme par rapport à celle qui serait nécessaire. Les rythmes, ce sont aussi les horaires. On sait par exemple que les adolescents ne devraient pas se coucher avant 11h le soir et ne pas se lever avant 9h du matin… mélatonine oblige. Qui pense à adapter les horaires ? Aujourd’hui les ados et les préados dorment en classe. On accuse les écrans, certes, il y a un problème avec ces écrans, mais ce n’est pas le seul. Les rythmes sont conçus pour les adultes, pas pour les enfants. D’ailleurs, si cette réforme au service des enfants rencontre tant d’hostitilité c’est parce qu’elle bouscule les convenances des adultes, enseignants et parents.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par vaeeje le 11 Décembre 2015 à 09:15
La frustration chez l’enfant - Isabelle Filliozat
Depuis peu, Isabelle Filliozat poste sur sa page Youtube plusieurs videos pour répondre à des question. Cette video sur la frustration est assez intéressante. Qu’en retenir ?
- Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas capable d’attendre. Il est difficile pour eux de résister, de gérer la frustration. Cela prend du temps. (A 12 ans, seul 60% des enfants sont capable d’attendre 25 minutes.)
- Penser que de confronter l’enfant à la frustration va lui apprendre à la supporter est faux. Il ne peut intellectuellement pas le faire (le lobe frontal qui aide, entre autres, à gérer la frustration n’est pas encore totalement mature). Pour les aider, il faut leur donner des stratégies. “Ne mange pas ce bonbon. Imagine qu’il est dans un cadre comme une photo que tu regarde”. Avec ces consignes stratégiques, presque tous les enfants, même avant 4 ans, arrivent à résister.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
-
-
-
Par vaeeje le 7 Décembre 2015 à 09:05
article issu : http://apprendreaeduquer.fr/10-regles-pour-faire-des-jeux-de-bagarre-des-moyens-de-renouer-le-contact-et-redonner-confiance-a-lenfant/
10 règles pour faire des jeux de chahut des moyens de renouer le contact et redonner confiance à l’enfant
Jouer à la bagarre avec un enfant en proie à la frustration, à la colère, à la perte de contrôle de soi peut l’aider à renouer avec sa vraie personnalité. Le genre de bagarre dont il est question vise à donner de l’assurance à l’enfant, à l’aider à prendre conscience de son pouvoir personnel.
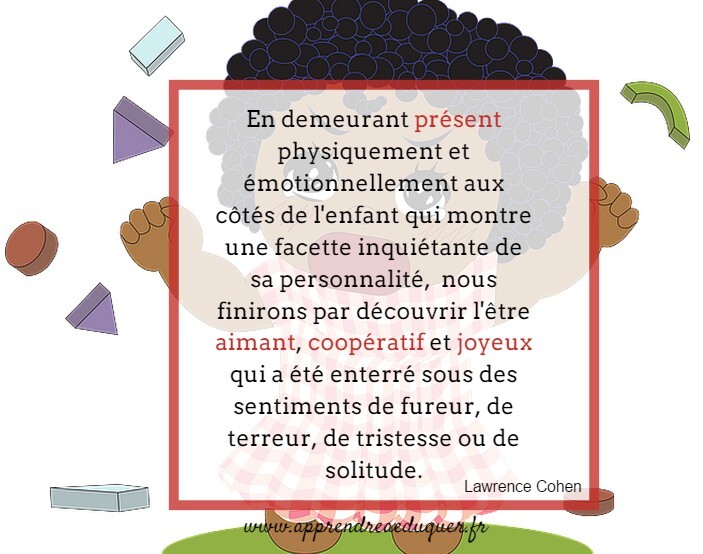 Dans Qui veut jouer avec moi ?, Lawrence Cohen nous livre 10 règles pour faire des jeux de chahut des moments susceptibles de donner de l’assurance à un enfant et de renouer le contact.
Dans Qui veut jouer avec moi ?, Lawrence Cohen nous livre 10 règles pour faire des jeux de chahut des moments susceptibles de donner de l’assurance à un enfant et de renouer le contact.Commander Qui veut jouer avec moi ? sur Amazon.
1. Veiller à la sécurité de tout le monde
Des règles à poser pour que personne ne se blesse (enfants et parents inclus) d’un point de vue physique et affectif :
- interdiction de frapper, de mordre, de serrer le cou, de donner des coups de pied…
- interdiction de se moquer, d’humilier, de rabaisser…
- mise en place d’un signal auquel le jeu cessera aussitôt (« stop » ou des mots absurdes comme « tarte à la banane », « crotte de nez » ou « carabistouille »)
- la moindre blessure stoppe le jeu immédiatement
Les règles devront sûrement être répétées plusieurs fois au cours du jeu : savoir si le jeu peut continuer avec un simple rappel des règles du jeu dépend de votre appréhension de la situation (est-ce possible de continuer le jeu de chahut tout en assurant la sécurité de chaque joueur ?).
Le respect des règles est un apprentissage qui sera bénéfique à l’enfant dans toute autre sorte de situations.
2. Saisir la moindre occasion de contact.
Lawrence Cohen écrit :
La différence entre jouer à la bagarre et taper dans un punching-ball tient en deux mots : contact humain.
Cette connexion physique peut prendre plusieurs formes :
- une pause câlin en cours de chahut,
- un regard droit dans les yeux (« Respectons l’antique coutume des guerriers de se regarder droit dans les yeux avant de se battre. »,
- au moment de reposer calmement les règles du jeu.
3. Chercher la moindre occasion d’accroître la confiance de votre jeune adversaire en son pouvoir personnel.
Il s’agit de jouer à la fois le rôle de l’entraîneur et de l’adversaire, c’est-à-dire permettre à l’enfant de déployer sa force pour gagner plutôt que la ruse.
Le message fondamental à communiquer est :
Ta puissance est bienvenue, tu peux être fort et en contact, sans faire mal à qui que ce soit.
4. Saisir toutes les occasions de revenir par le biais du jeu sur des blessures anciennes.
Lawrence Cohen explique qu’un enfant confronté à un défi qu’il n’a pas su relever appréciera de revenir dessus en se mesurant à ses parents. Le parent incarne alors la difficulté, l’agresseur, l’obstacle à surmonter. L’essentiel est que l’enfant montre ce qu’il a dans le ventre afin de se libérer de sa frustration, de son sentiment d’impuissance ou de sa honte.
La réactivation d’une blessure profitera à l’enfant, à condition que ni la peur ni l’impression de se retrouver démuni ne le paralysent.
5. Résister à l’enfant autant qu’il en a besoin, ni plus ni moins.
Votre objectif ne consiste ni à l’emporter ni à forcément laisser l’enfant gagner, mais à lui fournir l’occasion de donner sa pleine mesure sans blesser quiconque. L’idéal est de lui résister assez pour qu’il ait conscience de votre présence et se sente fort, sans pour autant l’écraser ou le pousser à renoncer.
C’est donc une question de dosage, de feeling au cas par cas :
- certains enfants, peu confiants en eux-mêmes et en leur corps, ne pourront pas accepter de résistance : vous pourrez donc tomber en poussant des cris (de karatéka par exemple), en exagérant votre souffrance, en tombant théâtralement à la renverse dès qu’ils vous toucheront;
- d’autres enfants voudront trouver un adversaire plus coriace pour que leur victoire leur coûte un réel effort;
- les enfants qui essayent de faire mal ont besoin de beaucoup de résistance (douce mais ferme).
6. Rester très attentif.
Quelque chose cloche quand l’enfant détourne le regard, renonce à la lutte, explose d’une rage aveugle ou cherche à faire mal. Dans ce cas là, plusieurs manières de réagir :
- mettre l’accent sur le contact (par le toucher et le regard),
- construire une plus grande confiance,
- ajuster le niveau de résistance,
- marquer un temps de pause.
La bagarre va souvent ouvrir des le portes à de nombreuses tensions refoulées et l’évacuation des émotions pénibles peut prendre du temps : la lutte peut alors devenir agressive, presque violente. Il s’agira de tenir bon , d’utiliser vos forces avec raison pour assurer que personne ne se blesse.
Une fois que les émotions négatives ont été libérées, la plupart des enfants changent du tout au tout : ils auront un regard franc, souriront et voudront essayer ce qu’ils refusaient auparavant sous prétexte que c’était trop dur.
7. Laisser l’enfant l’emporter (la plupart du temps).
Il est envisageable de demander à l’enfant s’il veut qu’on utilise toute notre puissance ou pas :
- si la réponse est positive, on fera en sorte que l’enfant sache qu’on s’est défendu du mieux qu’on pouvait, quitte à ce que la victoire nous revienne,
- si la réponse est négative, on laissera l’enfant gagner.
On peut aussi lui dire qu’il n’y a pas de perdant ou de gagnant dans ces jeux : on s’amuse et c’est tout.
8. Arrêter dès que quelqu’un se fait mal.
Continuer à jouer quand on a mal ne forge pas le caractère mais une cuirasse, une carapace.
Personne, enfant ou adulte, garçon ou fille, ne devrait jamais entendre le message selon lequel il vaut mieux ignorer la douleur. Et c’est le rôle du parent d’assurer la sécurité de tous les membres de la famille.
On préférera reprendre le jeu après une pause, d’écoute active (« ça fait mal quand/ tu as l’air de souffrir/c’est désagréable de… ») et de câlin.
Pour autant, on n’hésitera pas à encourager les enfants à reprendre le jeu après un petit bobo : une petite difficulté (qui n’est pas à nier) ne doit pas non plus devenir un prétexte pour baisser les bras systématiquement.
9. Interdiction formelle de chatouiller un enfant contre son gré !
Les chatouilles peuvent être amusantes mais il arrive qu’elles donnent à l’enfant l’impression de se retrouver à la merci d’un tiers, de perdre le contrôle.
Lawrence Cohen conseille de :
- circonscrire les chatouilles à un bref moment avant de laisser l’enfant reprendre son souffle (au lieu de le chatouiller sans le laisser reprendre son souffle),
- faire mine d’avancer pour le chatouiller avant de reculer au dernier moment (rires garantis sans effets secondaires),
- proposer une autre forme de contact physique (inventer des manières de « toper » dans les mains, fesse contre fesse, différentes manières de le porter, danser le rock acrobatique…).

J’ai d’ailleurs une anecdote personnelle à ce sujet : quand on se lance dans des séances de chatouilles avec ma fille de 5 ans, on définit d’abord un signal qu’elle prononcera et qui signifiera que je dois arrêter de la chatouiller (et je reste figée comme une statue) puis un autre qui signifie que je peux recommencer (l’autre jour, le mot de départ était Mickey et le mot de stop était chevreuil). J’en ai profité pour lui dire que c’est important que je respecte son non et que je le respecterai toujours.
L’autre jour, elle avait les mains froides et s’amusait à me les poser dans le dos. Comme je trouvais ça particulièrement désagréable, je le lui ai dit et lui ai demandé d’arrêter. Mais elle trouvait ça particulièrement amusant pour sa part… du coup, je lui ai rappelé nos jeux de chatouilles en lui disant que je m’attendais à ce qu’elle respecte mon « non » et mon corps autant que je respecte les siens.
Autant vous dire qu’elle a arrêté sur le champ : un bel apprentissage de la vie
 !
!10. Ne pas laisser s’interposer nos états d’âme.
C’est pour l’enfant qu’on joue aux jeux de chahut, pas pour soi.
Quand les adultes jouent à la bagarre, ils peuvent être envahis par des émotions anciennes liées aux traumatismes mal digérés de leur enfance. Ils peuvent éprouver une impulsion à humilier, chatouiller, taquiner ou dominer, reproduisant ainsi leur propre histoire. A moins qu’ils ne se sentent faibles ou démunis.
Il s’agit donc de mettre de côté nos états d’âme d’adulte pour se concentrer sur les 9 premières règles (par exemple, de refuser de jouer à des jeux de chahut quand on est fatigué, en colère, quand on est frustré, triste, inquiet…).
Pour connaître d’autres bénéfices du jeu dans la relation parents/enfants, je vous propose de lire cet article :
4 situations que le jeu parents/ enfants peut aider à dénouer
Je vous recommande vivement la lecture du livre Qui veut jouer avec moi ? Jouer pour mieux communiquer avec nos enfants
 (qui aborde non seulement l’intérêt du jeu dans la relation parents/enfants mais aussi dans les conflits au sein de la fratrie) :
(qui aborde non seulement l’intérêt du jeu dans la relation parents/enfants mais aussi dans les conflits au sein de la fratrie) : votre commentaire
votre commentaire
-
-
-
Par vaeeje le 7 Décembre 2015 à 08:42
article issu de : http://babybaboo.com/education/les-comportements-agressifs-chez-les-touts-petits-13-ans/
Les comportements agressifs chez les tout-petits (1/3 ans) :

«L’agressivité fait partie de la condition humaine. Elle joue un grand rôle dans le développement de l’enfant. Un rôle aussi grand que l’amour. La violence intérieure donne l’énergie et la motivation nécessaires au dépassement de soi. Elle favorise la réussite tant qu’elle reste dans des limites contrôlées par l’enfant. L’éducation ne consiste donc pas à l’annihiler mais à la canaliser, pour mobiliser l’énergie au service d’objectifs positifs pour soi-même et pour les autres». Edwige Antier.
Il est très fréquent d’observer des comportements, gestes agressifs chez les jeunes enfants (frapper, mordre, griffer, hurler…) et cela génère bien souvent de l’incompréhension, de la culpabilité et parfois une forme d’impuissance de la part de parents qui se sentent bouleversés.
Il est important de comprendre qu’un enfant qui pose des actes agressifs n’est pas pour autant un enfant agressif, méchant ou violent. Il ne fait pas réellement de lien entre son acte et la souffrance de l’autre, il n’y a pas d’intention de faire mal.
Il est capital de ne pas faire de confusion entre le comportement de l’enfant et l’enfant lui-même. L’enfant ne peut être défini et réduit à son comportement. (ex : « c’est un enfant mordeur », « tu es méchant »…) Son comportement ne reflète pas ce qu’il est mais représente une modalité d’expression, de décharge de ses émotions, sentiments, frustrations, peurs, difficultés… qu’il ne parvient pas encore à libérer autrement.Plusieurs raisons à cela :
- Une immaturité neurologique.
- Des habiletés langagières émergentes.
- De la maladresse sociale.
- Une grande impulsivité*.
- Une capacité naissante à intégrer les interdits.
- Un fort besoin d’opposition. (voir mon article sur la phase du “NON”)
Un exemple concret :
Votre enfant de 2 ans et demi a un comportement agressif depuis l’arrivée de son petit frère. Il frappe, pousse et essaie de s’en prendre également au bébé, et cela vous inquiète :
1ère question à se poser : quelles sont les raisons sous-jacentes à ce comportement ?
L’arrivée d’un petit frère ou sœur est souvent source d’un gros bouleversement émotionnel. Il est difficile de partager sa maman et son papa, surtout lorsqu’on était habitué à être leur seul centre d’attention auparavant. L’enfant est tiraillé entre l’envie de grandir et celle de régresser pour redevenir lui aussi un bébé. Il est inquiet parce qu’il craint que ce petit frère prenne tout l’amour de ses parents. Il peut alors ressentir de la jalousie, de la colère, de la tristesse… Un tourbillon d’émotions très compliquées à gérer.Que faire :
- Fixer le cadre et rappeler les règles : mettre votre enfant à l’écart et lui expliquer, en s’agenouillant à sa hauteur et en le regardant dans les yeux quels sont les règles, les interdits : « on ne frappe pas, ce n’est pas acceptable, c’est interdit »
- Faire preuve d’empathie, valider ses sentiments : accepter et reconnaître ses sentiments de colère, de frustration, de jalousie et y poser des mots. Lui expliquer que vous comprenez sa colère, qu’il a parfaitement le droit d’être triste, en colère, de pleurer. Le rassurer sur vos sentiments : le serrez fort dans vos bras et lui dire que vous êtes là pour lui et que vous l’aimez toujours aussi fort.
- Lui permettre de décharger ses sentiments au travers du jeu : passer du temps seul(e) avec lui pour jouer. Laissez lui le choix de l’activité. Le jeu est un formidable outil pour mieux communiquer avec ses enfants, pour les aider à prendre confiance en eux, à dépasser leurs blocages affectifs, à gérer leurs émotions, à resserrer le lien avec eux…* « Jouer pour nourrir le réservoir d’attachement de l’enfant, jouer pour l’aider à construire sa confiance en sa personne propre, jouer pour lui donner de la liberté, jouer pour l’écouter, jouer pour l’aider à dépasser les moments difficiles de sa vie, jouer pour partager du plaisir et du bonheur » I. Filliozat.
- L’aider à trouver des stratégies pour exprimer sa colère autrement, pour la déplacer: au travers de jeux de rôle, d’histoires, de dessins, de marionnettes, avec de la pâte à modeler, en lançant des balles en mousses…
De façon plus générale, l’attitude à adopter reste la même: lorsque l’enfant pose un acte agressif, il est toujours nécessaire de chercher à comprendre ce qui déclenche ce type de comportement (frustration, colère, peur, jalousie…). Ensuite, sur le modèle des différentes étapes précitées, il va s’agir de redéfinir le cadre et l’interdit de l’acte. Puis, de valider ses sentiments en y posant des mots. («Tu as ressenti de la colère parce que le petit garçon t’as pris la voiture » « tu as le droit d’avoir de la colère, mais tu ne peux pas l’exprimer de cette façon. Il est interdit de mordre, cela fait très mal »). Ensuite, rediriger sa colère vers un autre objet pour qu’il puisse évacuer son trop plein d’émotion et essayer de lui enseigner des compétences sociales telles que l’écoute et l’empathie.
A propos des morsures**, j’entends assez fréquemment des parents conseiller de mordre l’enfant en retour pour lui montrer la douleur que cela provoque. C’est une pratique à proscrire absolument : il faut toujours garder en tête que le modèle de l’enfant, c’est VOUS. D’autre part, il se pose ici une question de cohérence pour l’enfant : on ne peut pas expliquer à un enfant qu’il est interdit de taper, mordre, pincer, pousser et adopter ce type de comportement à son égard!En grandissant, les enfants vont progressivement apprendre à maitriser leur agressivité physique et trouver d’autres façons d’interagir avec les autres. Les comportements agressifs vont commencer à décroitre vers les 3 ans de l’enfant.
* Impulsivité: en dessous de 4 ans les enfants n’ont pas encore la capacité d’inhiber leurs gestes. Les zones contrôlant les impulsions et celles contrôlant les inhibitions ne sont pas encore bien connectées dans leur cerveau en formation.
**Morsures: elles peuvent parfois être la manifestation d’un amour puissant que l’enfant n’arrive pas à contrôler et qui équivaut pour lui à un gros baiser.
Pour aller plus loin :
Je vous invite à lire mon article intitulé: “Comprendre et accompagner les émotions de l’enfant” ICI
- I. Filliozat, J’ai tout essayé ! Ed. Poche Marabout (voir article de présentation ICI)
- I. Filliozat, Au coeur des émotions de l’enfant, Poche Marabout
- C. Gueguen, Pour une enfance heureuse. R. Laffont
- E. Antier, L’agréssivité. Ed. Bayard
- L. Cohen, « Qui veut jouer avec moi ? » Ed. JC Lattès (Voir mon article sur le sujet ICI ).
Sur les conflits dans la fratrie: E. Crary, « Arrêtes d’embêter ton frère ! Et toi, laisse ta sœur tranquille ! » Ed. JC Lattès.
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
-
-
Par vaeeje le 7 Décembre 2015 à 08:33
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique